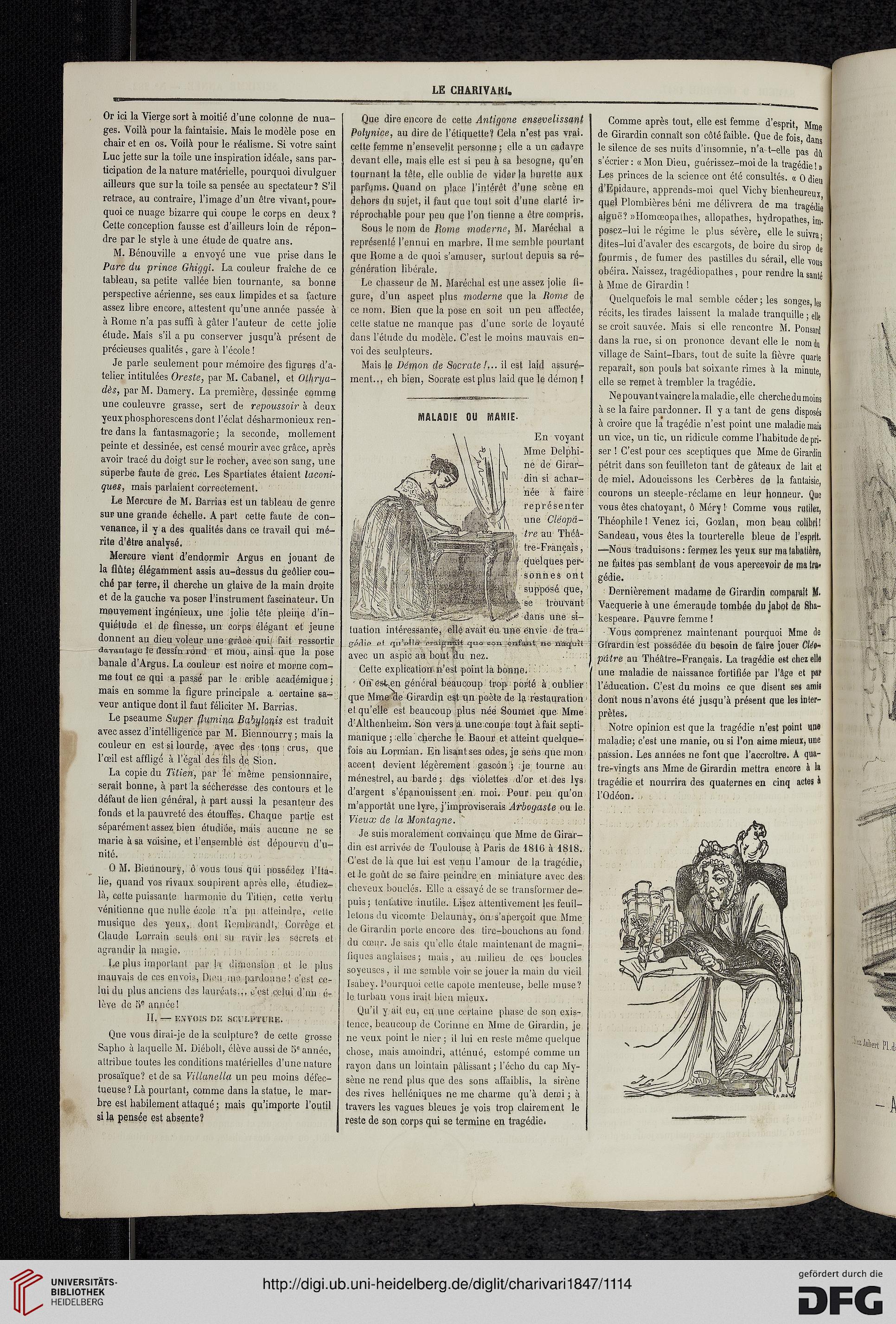LE CHARIVARI.
Or ici la Vierge sort à moitié d'une colonne de nua-
ges. Voilà pour la faintaisie. Mais le modèle pose en
chair et en os. Voilà pour le réalisme. Si votre saint
Luc jette sur la toile une inspiration idéale, sans par-
ticipation de la nature matérielle, pourquoi divulguer
ailleurs que sur la toile sa pensée au spectateur? S'il
retrace, au contraire, l'image d'un être vivant, pour-
quoi ce nuage bizarre qui coupe le corps en deux ?
Cette conception fausse est d'ailleurs loin de répon-
dre par le style à une étude de quatre ans.
M. Bénouville a envoyé une vue prise dans le
Parc du prince Ghiggi. La couleur fraîche de ce
tableau, sa petite vallée bien tournante, sa bonne
perspective aérienne, ses eaux limpides et sa facture
assez libre encore, attestent qu'une année passée à
à Rome n'a pas suffi à gâter l'auteur de cette jolie
étude. Mais s'il a pu conserver jusqu'à présent de
précieuses qualités, gare à l'école !
Je parle seulement pour mémoire des figures d'a-
telier intitulées Oreste, par M. Cabanel, et Olhrya-
dès, par M. Damery. La première, dessinée comme
une couleuvre grasse, sert de repoussoir à deux
yeux phosphorescens dont l'éclat désharmonieux ren-
tre dans la fantasmagorie ; la seconde, mollement
peinte et dessinée, est censé mourir avec grâce, après
avoir tracé du doigt sur le rocher, avec son sang, une
superbe faute de grec Les Spartiates étaient laconi-
ques, mais parlaient correctement.
Le Mercure de M. Barrias est un tableau de genre
sur une grande échelle. A part cette faute de con-
venance, il y a des qualités dans ce travail qui mé-
rite d'être analysé.
Mercure vient d'endormir Argus en jouant de
la flûte; élégamment assis au-dessus du geôlier cou-
ché par terre, il cherche un glaive de la main droite
et de la gauche va poser l'instrument fascinateur. Un
mpuvement ingénieux, une jolie tête pleine d'in-
quiétude et de finesse, un corps élégant et jeune
donnent au dieu voleur une grâce qui fait ressortir
da-rantayu le dessin rond et mou, ainsi que la pose
banale d'Argus. La couleur est noire et morne com-
me tout ce qui a passé par le crible académique;
mais en somme la figure principale a certaine sa-
veur antique dont il faut féliciter M. Barrias.
Le pseaume Super flumina Babylc^is est traduit
avec assez d'intelligence par M. Biennourry ; mais la
couleur en est si lourde, avec des tons crus, que
l'œil est afflige à l'égal des fils de Sion.
La copie du Titien, par le même pensionnaire,
serait bonne, à part la sécheresse des contours et le
défaut de lien général, à part aussi la pesanteur des
fonds et la pauvreté des étouffes. Chaque partie est
séparément assez bien étudiée, mais aucune ne se
marie à sa voisine, et l'ensemble est dépourvu d'u-
nité. ■
0 M. Biennoury, ô vous tous qui possédez l'Ifa^
lie, quand vos rivaux soupirent après elle, étudiez-
là, cotte puissante harmonie du Titien, cette vertu
vénitienne que nulle école n'a pu atteindre, celle
musique des yeux, dont Rembrandt, Corrêge et
Claude Lorrain seuls ont su ravir les secrets et
agrandir la magie.
Le plus important par la dimension et le plus
mauvais de ces envois, Dieu nie pardonne! c'est ce-
lui du plus anciens des lauréats... c'est celui d'un é-
lève de tie année!
IL — ksîvoïs £):■: scii.muiiE.
Que vous dirai-je de la sculpture? de cette grosse
Sapho à laquelle M. Diébolt, élève aussi de 5e année,
attribue toutes les conditions matérielles d'une nature
prosaïque? et de sa Villanella un peu moins défec-
tueuse? Là pourtant, comme dans la statue, le mar-
bre est habilement attaqué ; mais qu'importe l'outil
si la pensée est absente?
Que dire encore de cette Antigone ensevelissant
Polynice, au dire de l'étiquette? Cela n'est pas vrai,
celte femme n'ensevelit personne ; elle a un cadavre
devant elle, mais elle est si peu à sa besogne, qu'en
tournant la tête, elle oublie de vider la burette aux
parfums. Quand on place l'intérêt d'une scène en
dehors du sujet, il faut que tout soit d'une clarté ir-
réprochable pour peu que l'on tienne a être compris.
Sous le nom de Home moderne, M. Maréchal a
représenté l'ennui en marbre. lime semble pourtant
que Rome a de quoi s'amuser, surtout depuis sa ré-
génération libérale.
Le chasseur de M. Maréchal est une assez jolie li-
gure, d'un aspect plus moderne que la Rome de
ce nom. Bien que la pose en soit un peu affectée,
celte statue ne manque pas d'une sorte de loyauté
dans l'étude du modèle. C'est le moins mauvais en-
voi des seulpteurs.
Mais le Démon de Socrate /... il est laid assuré-
ment.., eh bien, Socrate est plus laid que le démon !
MALADIE OU MANIE-
En voyant
Mme Delphi-
ne de Char-
din si achar-
née à faire
représenter
une Cléopâ-
tre au Théâ-
tre-Français ,
quelques per-
sonnes ont
supposé que,
se trouvant
$JP|gP> dans une si-
tuation intéressante, elle avait eu une envie de tra-
rrprlip pt rju'pUn' rraipntîit quo coïi enfant ne naquît
avec un aspic au bout "au nez.
Celte explication-n'est point la bonne. • '
■ Oifôst.en général beaucoup trop porté à oublier
que Mme^e Girardin est un poète de la restauration;
et qu'elle est beaucoup plus née Soumet que Mme
d'Althenhehn. Son vers à une coupe tout à fait septi-
manique ; elle cherche le Baour et atteint quelque-
fois au Lormian. En lisant ses odes, je sens que mon
accent devient légèrement gascon ; je tourne au
ménestrel, au barde ; dçs violettes d'or et des lys
d'argent s'épanouissent en. moi. Pour, peu qu'on
m'apportât une lyre, j'improviserais Arbogaste ou le.
Vieux de la Montagne. "
Je suis moralement convaincu que Mme de Girar-
din est arrivée de Tuulouse à Paris de 181G à 1818.
C'est de là que lui est venu l'amour de la tragédie,
et le goût de se faire peindre en miniature avec des
cheveux bouclés. Elle a essayé de se transformel! de-
puis; tentative inutile. Lisez attentivement les feuil-
letons du vicomte Delaunay., on's'aperçoit que Mme
de Girardin porte encore des tire-bouchons au fond
du cœur. Je sais qu'elle étale maintenant de magni-
liques anglaises ; mais, au milieu de ces boucles
soyeuses, il me semble voir se jouer la main du vieil
Isabey. Pourquoi celle capote menteuse, belle muse?
le turban vous irait bien mieux.
Qu'il y ait eu, eu une certaine phase de son exis-
tence, beaucoup de Corinne en Mme de Girardin, je
ne veux point le nier ; il lui en reste même quelque
chose, mais amoindri, atténué, estompé comme un
rayon dans un lointain pâlissant ; l'écho du cap My-
sène ne rend plus que des sons affaiblis, la sirène
des rives helléniques ne me charme qu'à demi ; à
travers les vagues bleues je vois trop clairement le
reste de son corps qui se termine en tragédie.
Comme après tout, elle est femme d'esprit, Mme
de Girardin connaît son côté faible. Que de fois, dans
le silence de ses nuits d'insomnie, n'a t—elle pas dù
s'écrier: «Mon Dieu, guérissez-moi de la tragédie!»
Les princes de la science ont été consultés. « 0 dieu
d'Epidaure, apprends-moi quel Vichy bienheureux
quel Plombières béni me délivrera de ma tragédie
aiguë? «Homœopathes, allopathes, hydropathes, im-
posez-lui le régime le plus sévère, elle le suivra •
dites-lui d'avaler des escargots, de boire du sirop de
fourmis , de fumer des pastilles du sérail, elle vous
obéira. Naissez, tragédiopathes, pour rendre la santé
à Mme de Girardin !
Quelquefois le mal semble céder ; les songes, |(jS
récits, les tirades laissent la malade tranquille ; elle
se croit sauvée. Mais si elle rencontre M. Ponsard
dans la rue, si on prononce devant elle le nom du
village de Saint-Ibars, tout de suite la fièvre quarte
reparaît, son pouls bat soixante rimes à la minute,
elle se remet à trembler la tragédie.
Nepouvantvaincrelamaladie, elle cherche du moins
à se la faire pardonner. Il y a tant de gens disposés
à croire que la tragédie n'est point une maladie mais
un vice, un tic, un ridicule comme l'habitude de pri-
ser ! C'est pour ces sceptiques que Mme de Girardin
pétrit dans son feuilleton tant de gâteaux de lait et
de miel. Adoucissons les Cerbères de la fantaisie,
courons un steeple-réclame en leur honneur. Que
vous êtes chatoyant, ô Méry ! Comme vous rutilez,
Théophile ! Venez ici, Gozlan, mon beau colibri!
Sandeau, vous êtes la tourterelle bleue de l'esprit.
—Nous traduisons : fermez les yeux sur ma tabatière,
ne faites pas semblant de vous apercevoir de ma tra»
gédie.
Dernièrement madame de Girardin comparait M-
Vaequerie à une émeraude tombée du jabot de Sha-
kespeare. Pauvre femme !
Yous comprenez maintenant pourquoi Mme de
Girardin est possédée du besoin de faire jouer Clée-
pâtre au Théâtre-Français. La tragédie est chez ell«
une maladie de naissance fortifiée par l'âge et par
l'éducation. C'est du moins ce que disent seg amis
dont nous n'avons été jusqu'à présent que les inter-
prètes.
Notre opinion est que la tragédie n'est point une
maladie; c'est une manie, ou si l'on aime mieux, une
passion. Les années ne font que l'accroître. A qua-
tre-vingts ans Mme de Girardin mettra encore à la
tragédie et nourrira des quaternes en cinq actes a
l'Odéon.
Or ici la Vierge sort à moitié d'une colonne de nua-
ges. Voilà pour la faintaisie. Mais le modèle pose en
chair et en os. Voilà pour le réalisme. Si votre saint
Luc jette sur la toile une inspiration idéale, sans par-
ticipation de la nature matérielle, pourquoi divulguer
ailleurs que sur la toile sa pensée au spectateur? S'il
retrace, au contraire, l'image d'un être vivant, pour-
quoi ce nuage bizarre qui coupe le corps en deux ?
Cette conception fausse est d'ailleurs loin de répon-
dre par le style à une étude de quatre ans.
M. Bénouville a envoyé une vue prise dans le
Parc du prince Ghiggi. La couleur fraîche de ce
tableau, sa petite vallée bien tournante, sa bonne
perspective aérienne, ses eaux limpides et sa facture
assez libre encore, attestent qu'une année passée à
à Rome n'a pas suffi à gâter l'auteur de cette jolie
étude. Mais s'il a pu conserver jusqu'à présent de
précieuses qualités, gare à l'école !
Je parle seulement pour mémoire des figures d'a-
telier intitulées Oreste, par M. Cabanel, et Olhrya-
dès, par M. Damery. La première, dessinée comme
une couleuvre grasse, sert de repoussoir à deux
yeux phosphorescens dont l'éclat désharmonieux ren-
tre dans la fantasmagorie ; la seconde, mollement
peinte et dessinée, est censé mourir avec grâce, après
avoir tracé du doigt sur le rocher, avec son sang, une
superbe faute de grec Les Spartiates étaient laconi-
ques, mais parlaient correctement.
Le Mercure de M. Barrias est un tableau de genre
sur une grande échelle. A part cette faute de con-
venance, il y a des qualités dans ce travail qui mé-
rite d'être analysé.
Mercure vient d'endormir Argus en jouant de
la flûte; élégamment assis au-dessus du geôlier cou-
ché par terre, il cherche un glaive de la main droite
et de la gauche va poser l'instrument fascinateur. Un
mpuvement ingénieux, une jolie tête pleine d'in-
quiétude et de finesse, un corps élégant et jeune
donnent au dieu voleur une grâce qui fait ressortir
da-rantayu le dessin rond et mou, ainsi que la pose
banale d'Argus. La couleur est noire et morne com-
me tout ce qui a passé par le crible académique;
mais en somme la figure principale a certaine sa-
veur antique dont il faut féliciter M. Barrias.
Le pseaume Super flumina Babylc^is est traduit
avec assez d'intelligence par M. Biennourry ; mais la
couleur en est si lourde, avec des tons crus, que
l'œil est afflige à l'égal des fils de Sion.
La copie du Titien, par le même pensionnaire,
serait bonne, à part la sécheresse des contours et le
défaut de lien général, à part aussi la pesanteur des
fonds et la pauvreté des étouffes. Chaque partie est
séparément assez bien étudiée, mais aucune ne se
marie à sa voisine, et l'ensemble est dépourvu d'u-
nité. ■
0 M. Biennoury, ô vous tous qui possédez l'Ifa^
lie, quand vos rivaux soupirent après elle, étudiez-
là, cotte puissante harmonie du Titien, cette vertu
vénitienne que nulle école n'a pu atteindre, celle
musique des yeux, dont Rembrandt, Corrêge et
Claude Lorrain seuls ont su ravir les secrets et
agrandir la magie.
Le plus important par la dimension et le plus
mauvais de ces envois, Dieu nie pardonne! c'est ce-
lui du plus anciens des lauréats... c'est celui d'un é-
lève de tie année!
IL — ksîvoïs £):■: scii.muiiE.
Que vous dirai-je de la sculpture? de cette grosse
Sapho à laquelle M. Diébolt, élève aussi de 5e année,
attribue toutes les conditions matérielles d'une nature
prosaïque? et de sa Villanella un peu moins défec-
tueuse? Là pourtant, comme dans la statue, le mar-
bre est habilement attaqué ; mais qu'importe l'outil
si la pensée est absente?
Que dire encore de cette Antigone ensevelissant
Polynice, au dire de l'étiquette? Cela n'est pas vrai,
celte femme n'ensevelit personne ; elle a un cadavre
devant elle, mais elle est si peu à sa besogne, qu'en
tournant la tête, elle oublie de vider la burette aux
parfums. Quand on place l'intérêt d'une scène en
dehors du sujet, il faut que tout soit d'une clarté ir-
réprochable pour peu que l'on tienne a être compris.
Sous le nom de Home moderne, M. Maréchal a
représenté l'ennui en marbre. lime semble pourtant
que Rome a de quoi s'amuser, surtout depuis sa ré-
génération libérale.
Le chasseur de M. Maréchal est une assez jolie li-
gure, d'un aspect plus moderne que la Rome de
ce nom. Bien que la pose en soit un peu affectée,
celte statue ne manque pas d'une sorte de loyauté
dans l'étude du modèle. C'est le moins mauvais en-
voi des seulpteurs.
Mais le Démon de Socrate /... il est laid assuré-
ment.., eh bien, Socrate est plus laid que le démon !
MALADIE OU MANIE-
En voyant
Mme Delphi-
ne de Char-
din si achar-
née à faire
représenter
une Cléopâ-
tre au Théâ-
tre-Français ,
quelques per-
sonnes ont
supposé que,
se trouvant
$JP|gP> dans une si-
tuation intéressante, elle avait eu une envie de tra-
rrprlip pt rju'pUn' rraipntîit quo coïi enfant ne naquît
avec un aspic au bout "au nez.
Celte explication-n'est point la bonne. • '
■ Oifôst.en général beaucoup trop porté à oublier
que Mme^e Girardin est un poète de la restauration;
et qu'elle est beaucoup plus née Soumet que Mme
d'Althenhehn. Son vers à une coupe tout à fait septi-
manique ; elle cherche le Baour et atteint quelque-
fois au Lormian. En lisant ses odes, je sens que mon
accent devient légèrement gascon ; je tourne au
ménestrel, au barde ; dçs violettes d'or et des lys
d'argent s'épanouissent en. moi. Pour, peu qu'on
m'apportât une lyre, j'improviserais Arbogaste ou le.
Vieux de la Montagne. "
Je suis moralement convaincu que Mme de Girar-
din est arrivée de Tuulouse à Paris de 181G à 1818.
C'est de là que lui est venu l'amour de la tragédie,
et le goût de se faire peindre en miniature avec des
cheveux bouclés. Elle a essayé de se transformel! de-
puis; tentative inutile. Lisez attentivement les feuil-
letons du vicomte Delaunay., on's'aperçoit que Mme
de Girardin porte encore des tire-bouchons au fond
du cœur. Je sais qu'elle étale maintenant de magni-
liques anglaises ; mais, au milieu de ces boucles
soyeuses, il me semble voir se jouer la main du vieil
Isabey. Pourquoi celle capote menteuse, belle muse?
le turban vous irait bien mieux.
Qu'il y ait eu, eu une certaine phase de son exis-
tence, beaucoup de Corinne en Mme de Girardin, je
ne veux point le nier ; il lui en reste même quelque
chose, mais amoindri, atténué, estompé comme un
rayon dans un lointain pâlissant ; l'écho du cap My-
sène ne rend plus que des sons affaiblis, la sirène
des rives helléniques ne me charme qu'à demi ; à
travers les vagues bleues je vois trop clairement le
reste de son corps qui se termine en tragédie.
Comme après tout, elle est femme d'esprit, Mme
de Girardin connaît son côté faible. Que de fois, dans
le silence de ses nuits d'insomnie, n'a t—elle pas dù
s'écrier: «Mon Dieu, guérissez-moi de la tragédie!»
Les princes de la science ont été consultés. « 0 dieu
d'Epidaure, apprends-moi quel Vichy bienheureux
quel Plombières béni me délivrera de ma tragédie
aiguë? «Homœopathes, allopathes, hydropathes, im-
posez-lui le régime le plus sévère, elle le suivra •
dites-lui d'avaler des escargots, de boire du sirop de
fourmis , de fumer des pastilles du sérail, elle vous
obéira. Naissez, tragédiopathes, pour rendre la santé
à Mme de Girardin !
Quelquefois le mal semble céder ; les songes, |(jS
récits, les tirades laissent la malade tranquille ; elle
se croit sauvée. Mais si elle rencontre M. Ponsard
dans la rue, si on prononce devant elle le nom du
village de Saint-Ibars, tout de suite la fièvre quarte
reparaît, son pouls bat soixante rimes à la minute,
elle se remet à trembler la tragédie.
Nepouvantvaincrelamaladie, elle cherche du moins
à se la faire pardonner. Il y a tant de gens disposés
à croire que la tragédie n'est point une maladie mais
un vice, un tic, un ridicule comme l'habitude de pri-
ser ! C'est pour ces sceptiques que Mme de Girardin
pétrit dans son feuilleton tant de gâteaux de lait et
de miel. Adoucissons les Cerbères de la fantaisie,
courons un steeple-réclame en leur honneur. Que
vous êtes chatoyant, ô Méry ! Comme vous rutilez,
Théophile ! Venez ici, Gozlan, mon beau colibri!
Sandeau, vous êtes la tourterelle bleue de l'esprit.
—Nous traduisons : fermez les yeux sur ma tabatière,
ne faites pas semblant de vous apercevoir de ma tra»
gédie.
Dernièrement madame de Girardin comparait M-
Vaequerie à une émeraude tombée du jabot de Sha-
kespeare. Pauvre femme !
Yous comprenez maintenant pourquoi Mme de
Girardin est possédée du besoin de faire jouer Clée-
pâtre au Théâtre-Français. La tragédie est chez ell«
une maladie de naissance fortifiée par l'âge et par
l'éducation. C'est du moins ce que disent seg amis
dont nous n'avons été jusqu'à présent que les inter-
prètes.
Notre opinion est que la tragédie n'est point une
maladie; c'est une manie, ou si l'on aime mieux, une
passion. Les années ne font que l'accroître. A qua-
tre-vingts ans Mme de Girardin mettra encore à la
tragédie et nourrira des quaternes en cinq actes a
l'Odéon.
Werk/Gegenstand/Objekt
Titel
Titel/Objekt
Maladie où Manie
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Le charivari
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
R 1609 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsdatum
um 1847
Entstehungsdatum (normiert)
1842 - 1852
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
Public Domain Mark 1.0
Creditline
Le charivari, 16.1847, Octobre (No. 274-304), S. 1110
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg