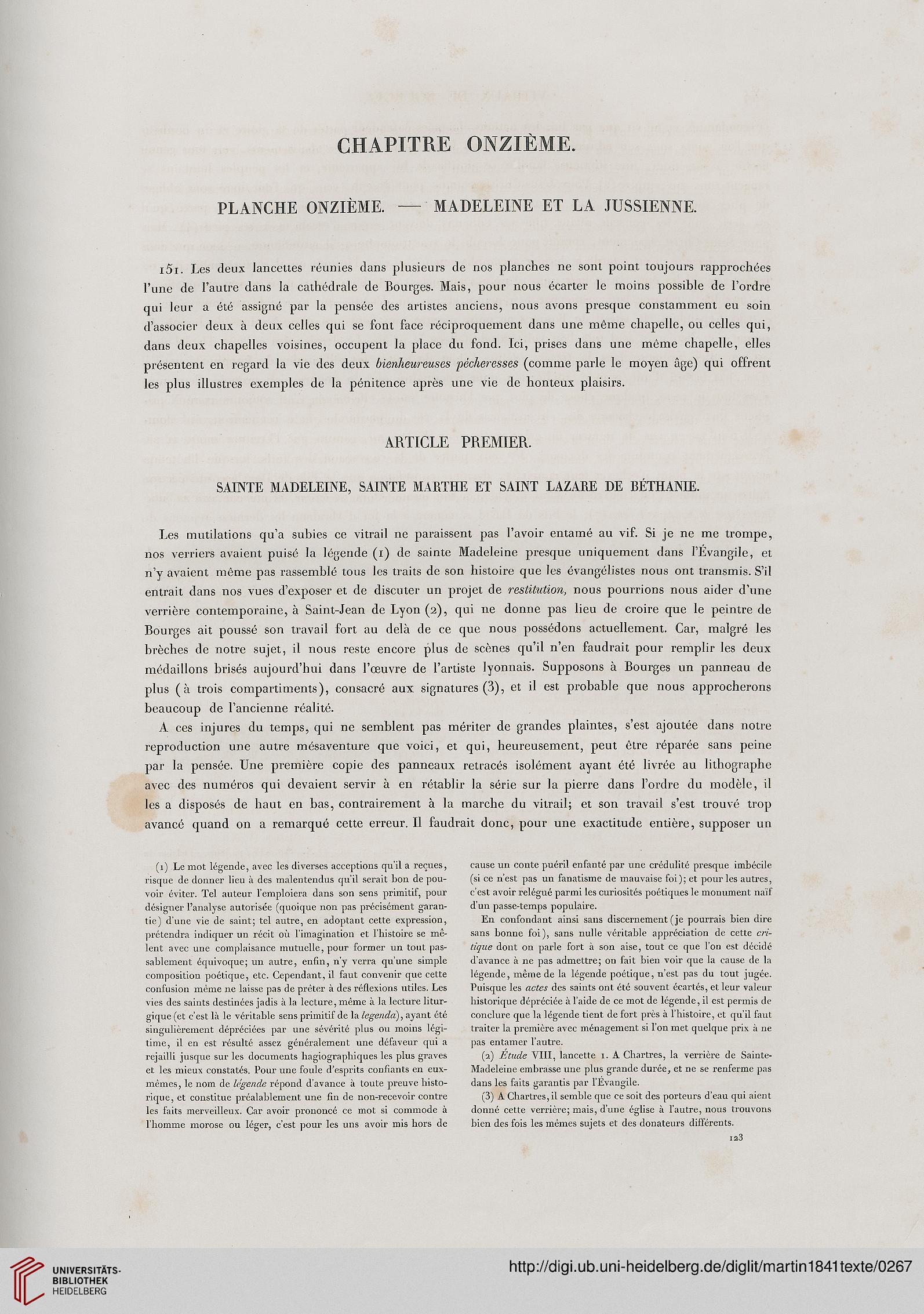CHAPITRE ONZIÈME
PLANCHE ONZIEME. — MADELEINE ET LA JUSSIENNE.
i5i. Les deux lancettes réunies dans plusieurs de nos planches ne sont point toujours rapprochées
l'une de l'autre dans la cathédrale de Bourges. Mais, pour nous écarter le moins possible de l'ordre
qui leur a été assigné par la pensée des artistes anciens, nous avons presque constamment eu soin
d'associer deux à deux celles qui se font face réciproquement dans une même chapelle, ou celles qui,
dans deux chapelles voisines, occupent la place du fond. Ici, prises dans une même chapelle, elles
présentent en regard la vie des deux bienheureuses pécheresses (comme parle le moyen âge) qui offrent
les plus illustres exemples de la pénitence après une vie de honteux plaisirs.
ARTICLE PREMIER.
SAINTE MADELEINE, SAINTE MARTHE ET SAINT LAZARE DE BÉTHANIE.
Les mutilations qu'a subies ce vitrail ne paraissent pas l'avoir entamé au vif. Si je ne me trompe,
nos verriers avaient puisé la légende (i) de sainte Madeleine presque uniquement dans l'Évangile, et
n'y avaient même pas rassemblé tous les traits de son histoire que les évangélistes nous ont transmis. S'il
entrait dans nos vues d'exposer et de discuter un projet de restitution, nous pourrions nous aider d'une
verrière contemporaine, à Saint-Jean de Lyon (2), qui ne donne pas lieu de croire que le peintre de
Bourges ait poussé son travail fort au delà de ce que nous possédons actuellement. Car, malgré les
brèches de notre sujet, il nous reste encore plus de scènes qu'il n'en faudrait pour remplir les deux
médaillons brisés aujourd'hui dans l'œuvre de l'artiste lyonnais. Supposons à Bourges un panneau de
plus (à trois compartiments), consacré aux signatures (3), et il est probable que nous approcherons
beaucoup de l'ancienne réalité.
A ces injures du temps, qui ne semblent pas mériter de grandes plaintes, s'est ajoutée dans notre
reproduction une autre mésaventure que voici, et qui, heureusement, peut être réparée sans peine
par la pensée. Une première copie des panneaux retracés isolément ayant été livrée au lithographe
avec des numéros qui devaient servir à en rétablir la série sur la pierre dans l'ordre du modèle, il
les a disposés de haut en bas, contrairement à la marche du vitrail; et son travail s'est trouvé trop
avancé quand on a remarqué cette erreur. Il faudrait donc, pour une exactitude entière, supposer un
(1) Le mot légende, avec les diverses acceptions qu'il a reçues,
risque de donner lieu à des malentendus qu'il serait bon de pou-
voir éviter. Tel auteur l'emploiera dans son sens primitif, pour
désigner l'analyse autorisée (quoique non pas précisément garan-
tie) d'une vie de saint; tel autre, en adoptant cette expression,
prétendra indiquer un récit où l'imagination et l'histoire se mê-
lent avec une complaisance mutuelle, pour former un tout pas-
sablement équivoque; un autre, enfin, n'y verra qu'une simple
composition poétique, etc. Cependant, il faut convenir que cette
confusion même ne laisse pas de prêter à des réflexions utiles. Les
vies des saints destinées jadis à la lecture, même à la lecture litur-
gique (et c'est là le véritable sens primitif de la legenda), ayant été
singulièrement dépréciées par une sévérité plus ou moins légi-
time, il en est résulté assez généralement une défaveur qui a
rejailli jusque sur les documents hagiographiques les plus graves
et les mieux constatés. Pour une foule d'esprits confiants en eux-
mêmes, le nom de légende répond d'avance à toute preuve histo-
rique, et constitue préalablement une fin de non-recevoir contre
les faits merveilleux. Car avoir prononcé ce mot si commode à
l'homme morose ou léger, c'est pour les uns avoir mis hors de
cause un conte puéril enfanté par une crédulité presque imbécile
(si ce n'est pas un fanatisme de mauvaise foi); et pour les autres,
c'est avoir relégué parmi les curiosités poétiques le monument naïf
d'un passe-temps populaire.
En confondant ainsi sans discernement (je pourrais bien dire
sans bonne foi), sans nulle véritable appréciation de cette cri-
tique dont on parle fort à son aise, tout ce que l'on est décidé
d'avance à ne pas admettre; on fait bien voir que la cause de la
légende, même de la légende poétique, n'est pas du tout jugée.
Puisque les actes des saints ont été souvent écartés, et leur valeur
historique dépréciée à l'aide de ce mot de légende, il est permis de
conclure que la légende tient de fort près à l'histoire, et qu'il faut
traiter la première avec ménagement si l'on met quelque prix à ne
pas entamer l'autre.
(1) Étude VIII, lancette 1. A Chartres, la verrière de Sainte-
Madeleine embrasse une plus grande durée, et ne se renferme pas
dans les faits garantis par l'Evangile.
(3) A Chartres, il semble que ce soit des porteurs d'eau qui aient
donné cette verrière; mais, d'une église à l'autre, nous trouvons
bien des fois les mêmes sujets et des donateurs différents.
ia3
PLANCHE ONZIEME. — MADELEINE ET LA JUSSIENNE.
i5i. Les deux lancettes réunies dans plusieurs de nos planches ne sont point toujours rapprochées
l'une de l'autre dans la cathédrale de Bourges. Mais, pour nous écarter le moins possible de l'ordre
qui leur a été assigné par la pensée des artistes anciens, nous avons presque constamment eu soin
d'associer deux à deux celles qui se font face réciproquement dans une même chapelle, ou celles qui,
dans deux chapelles voisines, occupent la place du fond. Ici, prises dans une même chapelle, elles
présentent en regard la vie des deux bienheureuses pécheresses (comme parle le moyen âge) qui offrent
les plus illustres exemples de la pénitence après une vie de honteux plaisirs.
ARTICLE PREMIER.
SAINTE MADELEINE, SAINTE MARTHE ET SAINT LAZARE DE BÉTHANIE.
Les mutilations qu'a subies ce vitrail ne paraissent pas l'avoir entamé au vif. Si je ne me trompe,
nos verriers avaient puisé la légende (i) de sainte Madeleine presque uniquement dans l'Évangile, et
n'y avaient même pas rassemblé tous les traits de son histoire que les évangélistes nous ont transmis. S'il
entrait dans nos vues d'exposer et de discuter un projet de restitution, nous pourrions nous aider d'une
verrière contemporaine, à Saint-Jean de Lyon (2), qui ne donne pas lieu de croire que le peintre de
Bourges ait poussé son travail fort au delà de ce que nous possédons actuellement. Car, malgré les
brèches de notre sujet, il nous reste encore plus de scènes qu'il n'en faudrait pour remplir les deux
médaillons brisés aujourd'hui dans l'œuvre de l'artiste lyonnais. Supposons à Bourges un panneau de
plus (à trois compartiments), consacré aux signatures (3), et il est probable que nous approcherons
beaucoup de l'ancienne réalité.
A ces injures du temps, qui ne semblent pas mériter de grandes plaintes, s'est ajoutée dans notre
reproduction une autre mésaventure que voici, et qui, heureusement, peut être réparée sans peine
par la pensée. Une première copie des panneaux retracés isolément ayant été livrée au lithographe
avec des numéros qui devaient servir à en rétablir la série sur la pierre dans l'ordre du modèle, il
les a disposés de haut en bas, contrairement à la marche du vitrail; et son travail s'est trouvé trop
avancé quand on a remarqué cette erreur. Il faudrait donc, pour une exactitude entière, supposer un
(1) Le mot légende, avec les diverses acceptions qu'il a reçues,
risque de donner lieu à des malentendus qu'il serait bon de pou-
voir éviter. Tel auteur l'emploiera dans son sens primitif, pour
désigner l'analyse autorisée (quoique non pas précisément garan-
tie) d'une vie de saint; tel autre, en adoptant cette expression,
prétendra indiquer un récit où l'imagination et l'histoire se mê-
lent avec une complaisance mutuelle, pour former un tout pas-
sablement équivoque; un autre, enfin, n'y verra qu'une simple
composition poétique, etc. Cependant, il faut convenir que cette
confusion même ne laisse pas de prêter à des réflexions utiles. Les
vies des saints destinées jadis à la lecture, même à la lecture litur-
gique (et c'est là le véritable sens primitif de la legenda), ayant été
singulièrement dépréciées par une sévérité plus ou moins légi-
time, il en est résulté assez généralement une défaveur qui a
rejailli jusque sur les documents hagiographiques les plus graves
et les mieux constatés. Pour une foule d'esprits confiants en eux-
mêmes, le nom de légende répond d'avance à toute preuve histo-
rique, et constitue préalablement une fin de non-recevoir contre
les faits merveilleux. Car avoir prononcé ce mot si commode à
l'homme morose ou léger, c'est pour les uns avoir mis hors de
cause un conte puéril enfanté par une crédulité presque imbécile
(si ce n'est pas un fanatisme de mauvaise foi); et pour les autres,
c'est avoir relégué parmi les curiosités poétiques le monument naïf
d'un passe-temps populaire.
En confondant ainsi sans discernement (je pourrais bien dire
sans bonne foi), sans nulle véritable appréciation de cette cri-
tique dont on parle fort à son aise, tout ce que l'on est décidé
d'avance à ne pas admettre; on fait bien voir que la cause de la
légende, même de la légende poétique, n'est pas du tout jugée.
Puisque les actes des saints ont été souvent écartés, et leur valeur
historique dépréciée à l'aide de ce mot de légende, il est permis de
conclure que la légende tient de fort près à l'histoire, et qu'il faut
traiter la première avec ménagement si l'on met quelque prix à ne
pas entamer l'autre.
(1) Étude VIII, lancette 1. A Chartres, la verrière de Sainte-
Madeleine embrasse une plus grande durée, et ne se renferme pas
dans les faits garantis par l'Evangile.
(3) A Chartres, il semble que ce soit des porteurs d'eau qui aient
donné cette verrière; mais, d'une église à l'autre, nous trouvons
bien des fois les mêmes sujets et des donateurs différents.
ia3