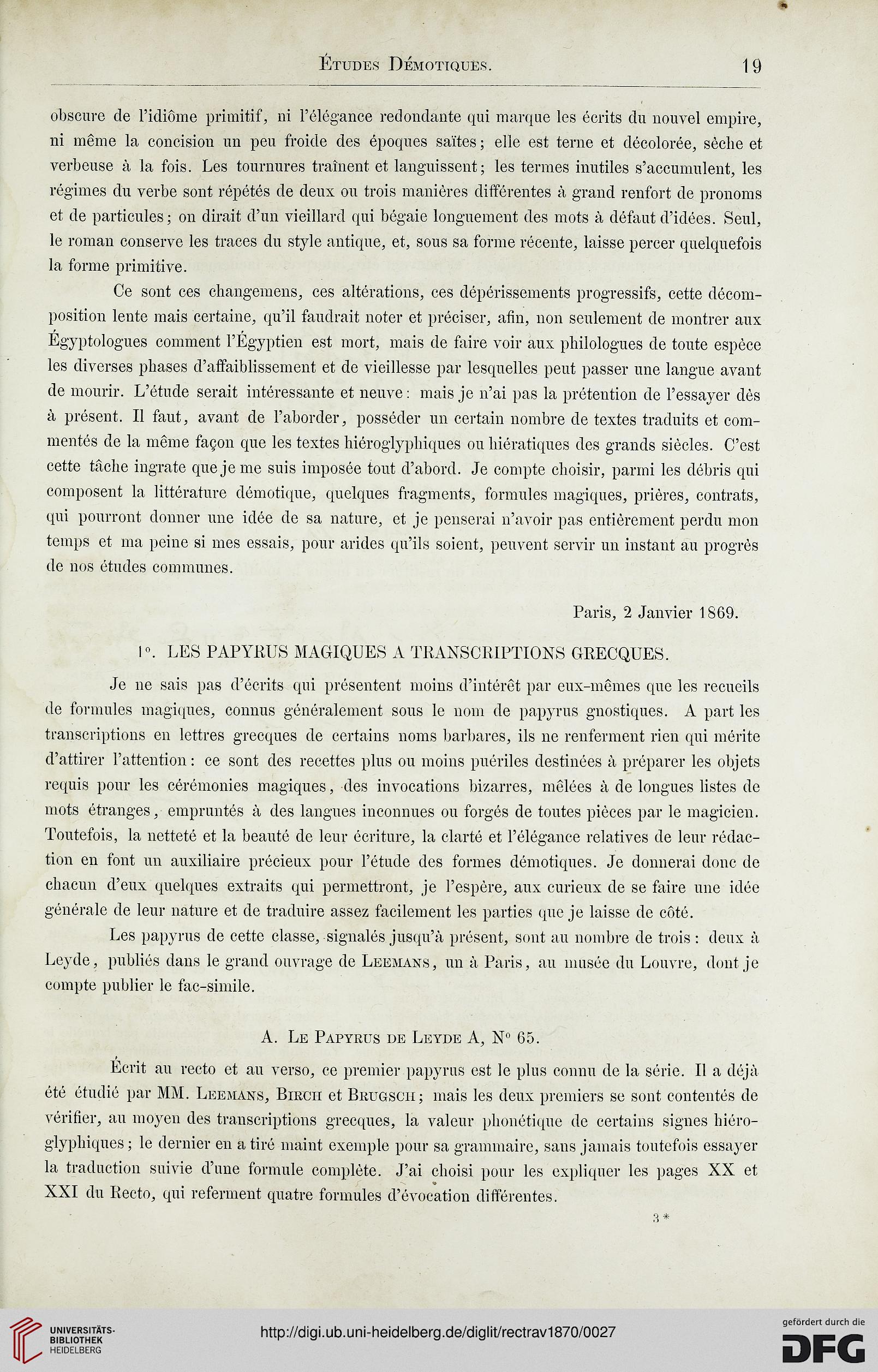Études Démotiques.
19
obscure de l'idiome primitif, m l'élégance redondante qui marque les écrits du nouvel empire,
ni même la concision un peu froide des époques saïtes ; elle est terne et décolorée, sèche et
verbeuse à la fois. Les tournures traînent et languissent; les termes inutiles s'accumulent, les
régimes du verbe sont répétés de deux ou trois manières différentes à grand renfort de pronoms
et de particules; on dirait d'un vieillard qui bégaie longuement des mots à défaut d'idées. Seul,
le roman conserve les traces du style antique, et, sous sa forme récente, laisse percer quelquefois
la forme primitive.
Ce sont ces changemens, ces altérations, ces dépérissements progressifs, cette décom-
position lente mais certaine, qu'il faudrait noter et préciser, afin, non seulement de montrer aux
Egyptologues comment l'Egyptien est mort, mais de faire voir aux philologues de toute espèce
les diverses phases d'affaiblissement et de vieillesse par lesquelles peut passer une langue avant
de mourir. L'étude serait intéressante et neuve : mais je n'ai pas la prétention de l'essayer dès
à présent. Il faut, avant de l'aborder, posséder un certain nombre de textes traduits et com-
mentés de la même façon que les textes hiéroglyphiques ou hiératiques des grands siècles. C'est
cette tâche ingrate que je me suis imposée tout d'abord. Je compte choisir, parmi les débris qui
composent la littérature démotique, quelques fragments, formules magiques, prières, contrats,
qui pourront donner une idée de sa nature, et je penserai n'avoir pas entièrement perdu mon
temps et ma peine si mes essais, pour arides qu'ils soient, peuvent servir un instant au progrès
de nos études communes.
Paris, 2 Janvier 1869.
1°. LES PAPYRUS MAGIQUES A TRANSCRIPTIONS GRECQUES.
Je ne sais pas d'écrits qui présentent moins d'intérêt par eux-mêmes que les recueils
de formules magiques, connus généralement sous le nom de papyrus gnostiques. A part les
transcriptions en lettres grecques de certains noms barbares, ils ne renferment rien qui mérite
d'attirer l'attention : ce sont des recettes plus ou moins puériles destinées à préparer les objets
requis pour les cérémonies magiques, des invocations bizarres, mêlées à de longues listes de
mots étranges, empruntés à des langues inconnues ou forgés de toutes pièces par le magicien.
Toutefois, la netteté et la beauté de leur écriture, la clarté et l'élégance relatives de leur rédac-
tion en font un auxiliaire précieux pour l'étude des formes démotiques. Je donnerai donc de
chacun d'eux quelques extraits qui permettront, je l'espère, aux curieux de se faire une idée
générale de leur nature et de traduire assez facilement les parties que je laisse de côté.
Les papyrus de cette classe, signalés jusqu'à présent, sont au nombre de trois : deux à
Leyde, publiés dans le grand ouvrage de Leemans, un à Paris, au musée du Louvre, dont je
compte publier le fac-similé.
A. Le Papyrus de Leyde A, N° 65.
Ecrit au recto et au verso, ce premier papyrus est le plus connu de la série. Il a déjà
été étudié par MM. Leemans, Bircii et Brugsch; mais les deux premiers se sont contentés de
vérifier, au moyen des transcriptions grecques, la valeur phonétique de certains signes hiéro-
glyphiques ; le dernier en a tiré maint exemple pour sa grammaire, sans jamais toutefois essayer
la traduction suivie d'une formule complète. J'ai choisi pour les expliquer les pages XX et
XXI du Recto, qui referment quatre formules d'évocation différentes.
19
obscure de l'idiome primitif, m l'élégance redondante qui marque les écrits du nouvel empire,
ni même la concision un peu froide des époques saïtes ; elle est terne et décolorée, sèche et
verbeuse à la fois. Les tournures traînent et languissent; les termes inutiles s'accumulent, les
régimes du verbe sont répétés de deux ou trois manières différentes à grand renfort de pronoms
et de particules; on dirait d'un vieillard qui bégaie longuement des mots à défaut d'idées. Seul,
le roman conserve les traces du style antique, et, sous sa forme récente, laisse percer quelquefois
la forme primitive.
Ce sont ces changemens, ces altérations, ces dépérissements progressifs, cette décom-
position lente mais certaine, qu'il faudrait noter et préciser, afin, non seulement de montrer aux
Egyptologues comment l'Egyptien est mort, mais de faire voir aux philologues de toute espèce
les diverses phases d'affaiblissement et de vieillesse par lesquelles peut passer une langue avant
de mourir. L'étude serait intéressante et neuve : mais je n'ai pas la prétention de l'essayer dès
à présent. Il faut, avant de l'aborder, posséder un certain nombre de textes traduits et com-
mentés de la même façon que les textes hiéroglyphiques ou hiératiques des grands siècles. C'est
cette tâche ingrate que je me suis imposée tout d'abord. Je compte choisir, parmi les débris qui
composent la littérature démotique, quelques fragments, formules magiques, prières, contrats,
qui pourront donner une idée de sa nature, et je penserai n'avoir pas entièrement perdu mon
temps et ma peine si mes essais, pour arides qu'ils soient, peuvent servir un instant au progrès
de nos études communes.
Paris, 2 Janvier 1869.
1°. LES PAPYRUS MAGIQUES A TRANSCRIPTIONS GRECQUES.
Je ne sais pas d'écrits qui présentent moins d'intérêt par eux-mêmes que les recueils
de formules magiques, connus généralement sous le nom de papyrus gnostiques. A part les
transcriptions en lettres grecques de certains noms barbares, ils ne renferment rien qui mérite
d'attirer l'attention : ce sont des recettes plus ou moins puériles destinées à préparer les objets
requis pour les cérémonies magiques, des invocations bizarres, mêlées à de longues listes de
mots étranges, empruntés à des langues inconnues ou forgés de toutes pièces par le magicien.
Toutefois, la netteté et la beauté de leur écriture, la clarté et l'élégance relatives de leur rédac-
tion en font un auxiliaire précieux pour l'étude des formes démotiques. Je donnerai donc de
chacun d'eux quelques extraits qui permettront, je l'espère, aux curieux de se faire une idée
générale de leur nature et de traduire assez facilement les parties que je laisse de côté.
Les papyrus de cette classe, signalés jusqu'à présent, sont au nombre de trois : deux à
Leyde, publiés dans le grand ouvrage de Leemans, un à Paris, au musée du Louvre, dont je
compte publier le fac-similé.
A. Le Papyrus de Leyde A, N° 65.
Ecrit au recto et au verso, ce premier papyrus est le plus connu de la série. Il a déjà
été étudié par MM. Leemans, Bircii et Brugsch; mais les deux premiers se sont contentés de
vérifier, au moyen des transcriptions grecques, la valeur phonétique de certains signes hiéro-
glyphiques ; le dernier en a tiré maint exemple pour sa grammaire, sans jamais toutefois essayer
la traduction suivie d'une formule complète. J'ai choisi pour les expliquer les pages XX et
XXI du Recto, qui referment quatre formules d'évocation différentes.