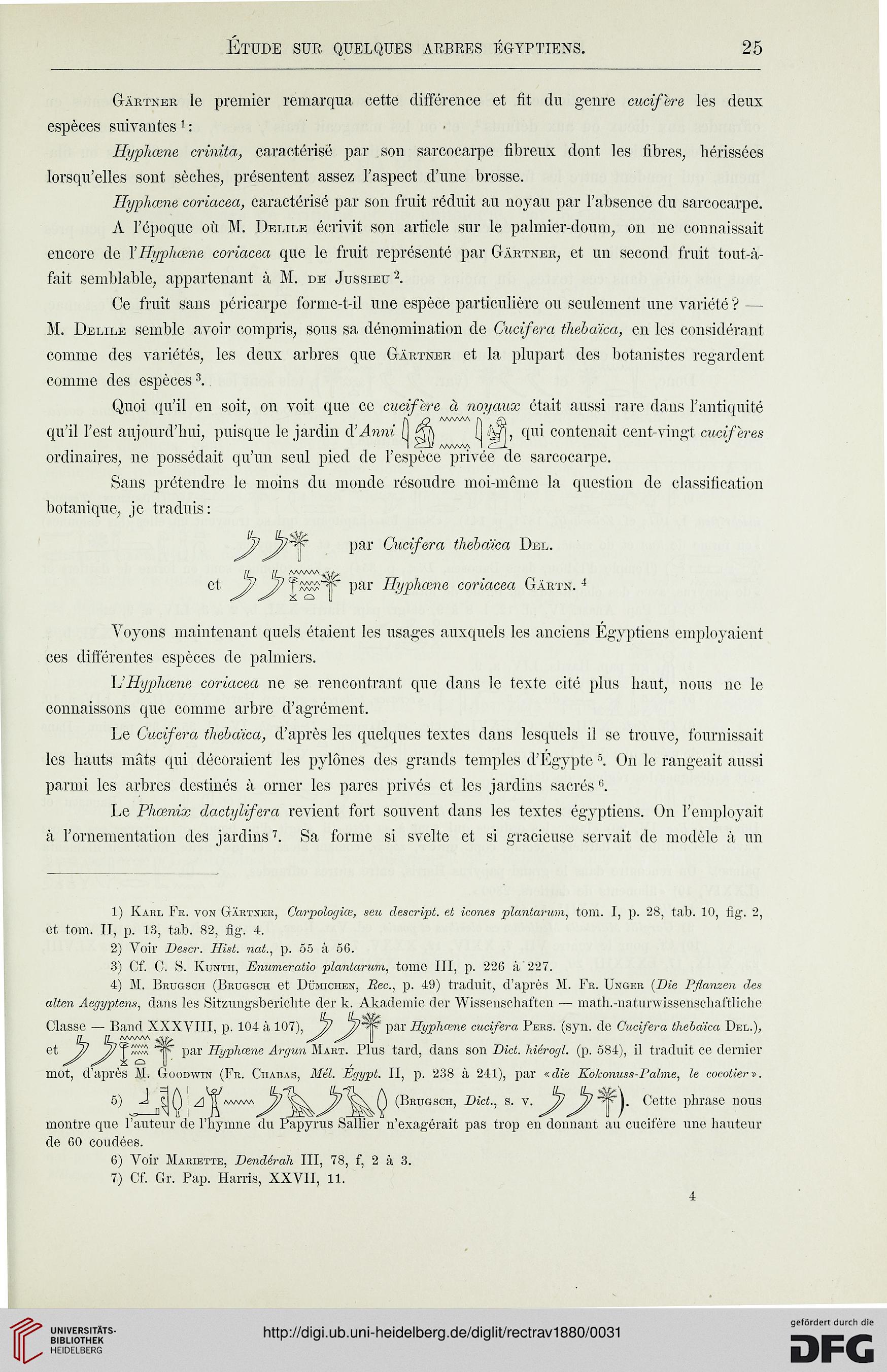Étude sur quelques arbres égyptiens.
25
Gartner le premier remarqua cette différence et fît du genre cucifere les deux
espèces suivantes 1 :
Hyphœne crinita, caractérisé par son sarcocarpe fibreux dont les fibres; hérissées
lorsqu'elles sont sèches, présentent assez l'aspect d'une brosse.
Hyphœne coriacea, caractérisé par son fruit réduit au noyau par l'absence du sarcocarpe.
A l'époque où M. Uelile écrivit son article sur le palmier-doum, on ne connaissait
encore de Y Hyphœne coriacea que le fruit représenté par Gartner, et un second fruit tout-à-
fait semblable, appartenant à M. de Jussieu 2.
Ce fruit sans péricarpe forme-t-il une espèce particulière ou seulement une variété '? —
M. Delile semble avoir compris, sous sa dénomination de Cucifera thébaïca, en les considérant
comme des variétés, les deux arbres que Gartner et la plupart des botanistes regardent
comme des espèces3.
Quoi qu'il en soit, on voit que ce cucifere à noyaux était aussi rare dans l'antiquité
qu'il l'est aujourd'hui, puisque le jardin A'Anni (I [ <ïvj, qui contenait cent-vingt cuciferes
ordinaires, ne possédait qu'un seul pied de l'espèce privée de sarcocarpe.
Sans prétendre le moins du monde résoudre moi-même la question de classification
botanique, je traduis:
^J)'Jp~'f Par Cucifera thébaica Del.
et ^ |î^Y Par Hyphœne coriacea Gârtn. 4
Voyons maintenant quels étaient les usages auxquels les anciens Egyptiens employaient
ces différentes espèces de palmiers.
L'Hyphœne coriacea ne se rencontrant que dans le texte cité plus haut, nous ne le
connaissons que comme arbre d'agrément.
Le Cucifera tliehdica, d'après les quelques textes dans lesquels il se trouve, fournissait
les hauts mats qui décoraient les pylônes des grands temples d'Egypte 5. On le rangeait aussi
parmi les arbres destinés à orner les parcs privés et les jardins sacrés (i.
Le Phœnix dactylifera revient fort souvent dans les textes égyptiens. On l'employait
à l'ornementation des jardins7. Sa forme si svelte et si gracieuse servait de modèle à un
1) Karl Fr. von Gartner, Carpologiœ, seu descript. et icônes plantarum, tom. i, p. 28, tab. 10, fig. 2,
et tom. ii, p. 18, tab. 82, fig. 4.
2) Voir Descr. Hist. nat., p. 55 à 56.
3) Cf. C. S. Kunth, Enumeratio plantarum, tome iii, p. 226 à 227.
4) M. Brugsch (Brugsch et Dùmichen, Eec, p. 49) traduit, d'après M. Fr. Unger (Die Pflanzen des
alten Aegyptens, dans les Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften — math.-naturwissenschaftliche
IL, IL.*U^
Classe — Band XXXVIII, p. 104 à 107), J/ J/"?f par Hyphœne cucifera Pers. (syn. de Cucifera thébaica Del.),
et W W^J"^ *j. Par Hypliœne Argun Mart. Plus tard, dans son Dict. hiérogl. (p. 584), il traduit ce dernier
mot, d'après M. Goodwin (Fr. Chabas, Mél. Egypt. ii, p. 238 à 241), par «die Kokonuss-Palme, le cocotier».
5) Q '! Z,^AA/WA^^''^^^?'^^,0 (Brugsch, Dict., s. v. Jp ~^)' ®eite Pm'ase 110118
montre que l'auteur de l'hymne du Papyrus Sallier n'exagérait pas trop en donnant au cucifere une hauteur
de 60 coudées.
6) Voir Mariette, Dendérah iii, 78, f, 2 à 3.
7) Cf. Gr. Pap. Harris, xxvii, 11.
4
25
Gartner le premier remarqua cette différence et fît du genre cucifere les deux
espèces suivantes 1 :
Hyphœne crinita, caractérisé par son sarcocarpe fibreux dont les fibres; hérissées
lorsqu'elles sont sèches, présentent assez l'aspect d'une brosse.
Hyphœne coriacea, caractérisé par son fruit réduit au noyau par l'absence du sarcocarpe.
A l'époque où M. Uelile écrivit son article sur le palmier-doum, on ne connaissait
encore de Y Hyphœne coriacea que le fruit représenté par Gartner, et un second fruit tout-à-
fait semblable, appartenant à M. de Jussieu 2.
Ce fruit sans péricarpe forme-t-il une espèce particulière ou seulement une variété '? —
M. Delile semble avoir compris, sous sa dénomination de Cucifera thébaïca, en les considérant
comme des variétés, les deux arbres que Gartner et la plupart des botanistes regardent
comme des espèces3.
Quoi qu'il en soit, on voit que ce cucifere à noyaux était aussi rare dans l'antiquité
qu'il l'est aujourd'hui, puisque le jardin A'Anni (I [ <ïvj, qui contenait cent-vingt cuciferes
ordinaires, ne possédait qu'un seul pied de l'espèce privée de sarcocarpe.
Sans prétendre le moins du monde résoudre moi-même la question de classification
botanique, je traduis:
^J)'Jp~'f Par Cucifera thébaica Del.
et ^ |î^Y Par Hyphœne coriacea Gârtn. 4
Voyons maintenant quels étaient les usages auxquels les anciens Egyptiens employaient
ces différentes espèces de palmiers.
L'Hyphœne coriacea ne se rencontrant que dans le texte cité plus haut, nous ne le
connaissons que comme arbre d'agrément.
Le Cucifera tliehdica, d'après les quelques textes dans lesquels il se trouve, fournissait
les hauts mats qui décoraient les pylônes des grands temples d'Egypte 5. On le rangeait aussi
parmi les arbres destinés à orner les parcs privés et les jardins sacrés (i.
Le Phœnix dactylifera revient fort souvent dans les textes égyptiens. On l'employait
à l'ornementation des jardins7. Sa forme si svelte et si gracieuse servait de modèle à un
1) Karl Fr. von Gartner, Carpologiœ, seu descript. et icônes plantarum, tom. i, p. 28, tab. 10, fig. 2,
et tom. ii, p. 18, tab. 82, fig. 4.
2) Voir Descr. Hist. nat., p. 55 à 56.
3) Cf. C. S. Kunth, Enumeratio plantarum, tome iii, p. 226 à 227.
4) M. Brugsch (Brugsch et Dùmichen, Eec, p. 49) traduit, d'après M. Fr. Unger (Die Pflanzen des
alten Aegyptens, dans les Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften — math.-naturwissenschaftliche
IL, IL.*U^
Classe — Band XXXVIII, p. 104 à 107), J/ J/"?f par Hyphœne cucifera Pers. (syn. de Cucifera thébaica Del.),
et W W^J"^ *j. Par Hypliœne Argun Mart. Plus tard, dans son Dict. hiérogl. (p. 584), il traduit ce dernier
mot, d'après M. Goodwin (Fr. Chabas, Mél. Egypt. ii, p. 238 à 241), par «die Kokonuss-Palme, le cocotier».
5) Q '! Z,^AA/WA^^''^^^?'^^,0 (Brugsch, Dict., s. v. Jp ~^)' ®eite Pm'ase 110118
montre que l'auteur de l'hymne du Papyrus Sallier n'exagérait pas trop en donnant au cucifere une hauteur
de 60 coudées.
6) Voir Mariette, Dendérah iii, 78, f, 2 à 3.
7) Cf. Gr. Pap. Harris, xxvii, 11.
4