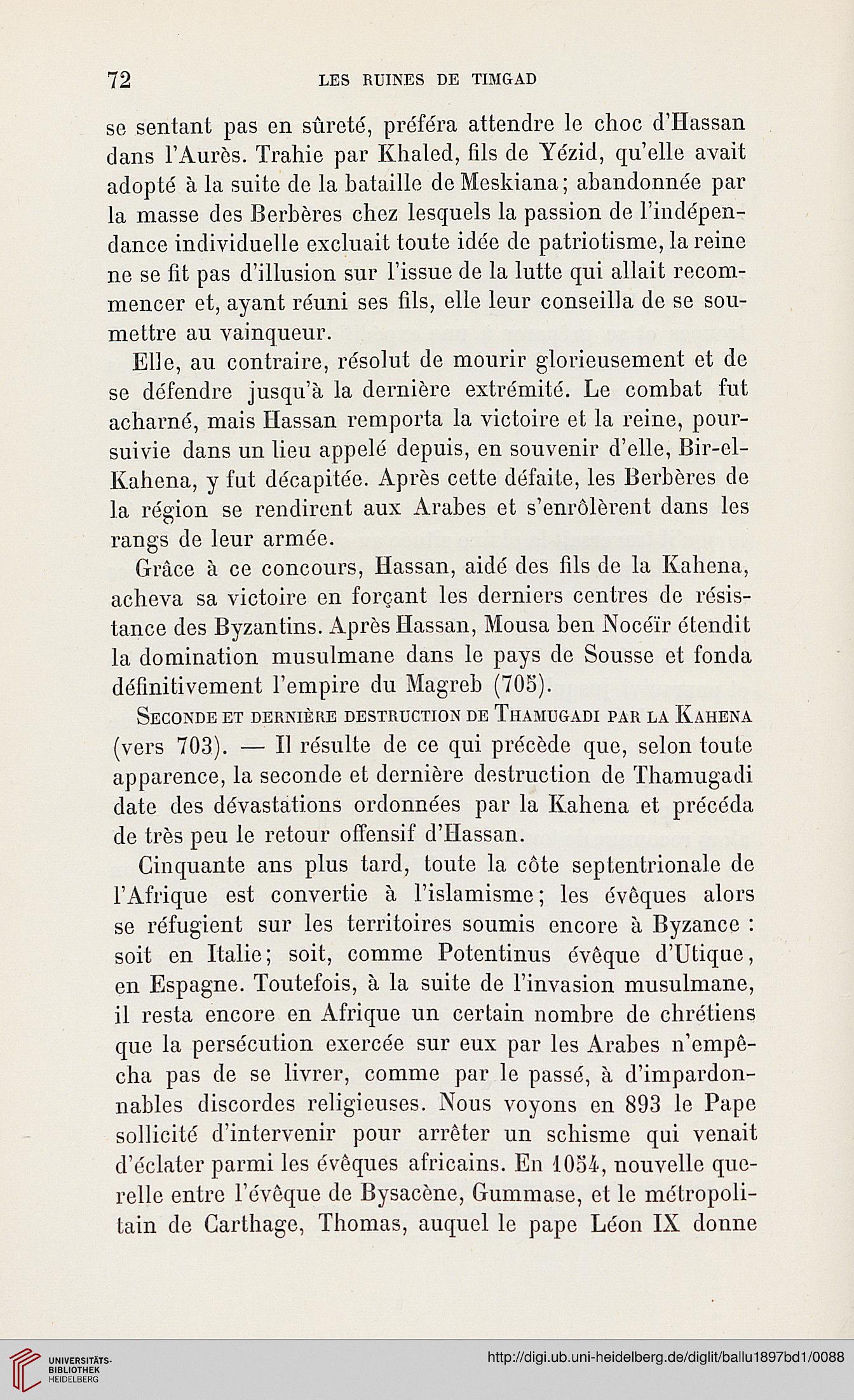72
les ruines de timgad
se sentant pas en sûreté, préféra attendre le choc d'Hassan
dans l'Aurôs. Trahie par Khaled, fils de Yézid, qu'elle avait
adopté à la suite de la bataille deMeskiana; abandonnée par
la masse des Berbères chez lesquels la passion de l'indépen-
dance individuelle excluait loute idée de patriotisme, la reine
ne se fit pas d'illusion sur l'issue de la lutte qui allait recom-
mencer et, ayant réuni ses fils, elle leur conseilla de se sou-
mettre au vainqueur.
Elle, au contraire, résolut de mourir glorieusement et de
se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Le combat fut
acharné, mais Hassan remporta la victoire et la reine, pour-
suivie dans un lieu appelé depuis, en souvenir d'elle, Bir-cl-
Kahena, y fut décapitée. Après cette défaite, les Berbères de
la région se rendirent aux Arabes et s'enrôlèrent dans les
rangs de leur armée.
Grâce à ce concours, Hassan, aidé des fils de la Kahena,
acheva sa victoire en forçant les derniers centres de résis-
tance des Byzantins. Après Hassan, Mousa ben Nocéïr étendit
la domination musulmane dans le pays de Sousse et fonda
définitivement l'empire du Magreb (705).
Seconde et dernière destruction de Thamugadi par la Kahena
(vers 703). — Il résulte de ce qui précède que, selon loute
apparence, la seconde et dernière destruction de Thamugadi
date des dévastations ordonnées par la Kahena et précéda
de très peu le retour offensif d'Hassan.
Cinquante ans plus tard, toute la côte septentrionale de
l'Afrique est convertie à l'islamisme; les évêques alors
se réfugient sur les territoires soumis encore à Byzance :
soit en Italie; soit, comme Potentinus évèque d'Utique,
en Espagne. Toutefois, à la suite de l'invasion musulmane,
il resta encore en Afrique un certain nombre de chrétiens
que la persécution exercée sur eux par les Arabes n'empê-
cha pas de se livrer, comme par le passé, à d'impardon-
nables discordes religieuses. Nous voyons en 893 le Pape
sollicité d'intervenir pour arrêter un schisme qui venait
d'éclater parmi les évêques africains. En 1054, nouvelle que-
relle entre l'évêque de Bysaccne, Gummase, et le métropoli-
tain de Carthage, Thomas, auquel le pape Léon IX donne
les ruines de timgad
se sentant pas en sûreté, préféra attendre le choc d'Hassan
dans l'Aurôs. Trahie par Khaled, fils de Yézid, qu'elle avait
adopté à la suite de la bataille deMeskiana; abandonnée par
la masse des Berbères chez lesquels la passion de l'indépen-
dance individuelle excluait loute idée de patriotisme, la reine
ne se fit pas d'illusion sur l'issue de la lutte qui allait recom-
mencer et, ayant réuni ses fils, elle leur conseilla de se sou-
mettre au vainqueur.
Elle, au contraire, résolut de mourir glorieusement et de
se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Le combat fut
acharné, mais Hassan remporta la victoire et la reine, pour-
suivie dans un lieu appelé depuis, en souvenir d'elle, Bir-cl-
Kahena, y fut décapitée. Après cette défaite, les Berbères de
la région se rendirent aux Arabes et s'enrôlèrent dans les
rangs de leur armée.
Grâce à ce concours, Hassan, aidé des fils de la Kahena,
acheva sa victoire en forçant les derniers centres de résis-
tance des Byzantins. Après Hassan, Mousa ben Nocéïr étendit
la domination musulmane dans le pays de Sousse et fonda
définitivement l'empire du Magreb (705).
Seconde et dernière destruction de Thamugadi par la Kahena
(vers 703). — Il résulte de ce qui précède que, selon loute
apparence, la seconde et dernière destruction de Thamugadi
date des dévastations ordonnées par la Kahena et précéda
de très peu le retour offensif d'Hassan.
Cinquante ans plus tard, toute la côte septentrionale de
l'Afrique est convertie à l'islamisme; les évêques alors
se réfugient sur les territoires soumis encore à Byzance :
soit en Italie; soit, comme Potentinus évèque d'Utique,
en Espagne. Toutefois, à la suite de l'invasion musulmane,
il resta encore en Afrique un certain nombre de chrétiens
que la persécution exercée sur eux par les Arabes n'empê-
cha pas de se livrer, comme par le passé, à d'impardon-
nables discordes religieuses. Nous voyons en 893 le Pape
sollicité d'intervenir pour arrêter un schisme qui venait
d'éclater parmi les évêques africains. En 1054, nouvelle que-
relle entre l'évêque de Bysaccne, Gummase, et le métropoli-
tain de Carthage, Thomas, auquel le pape Léon IX donne