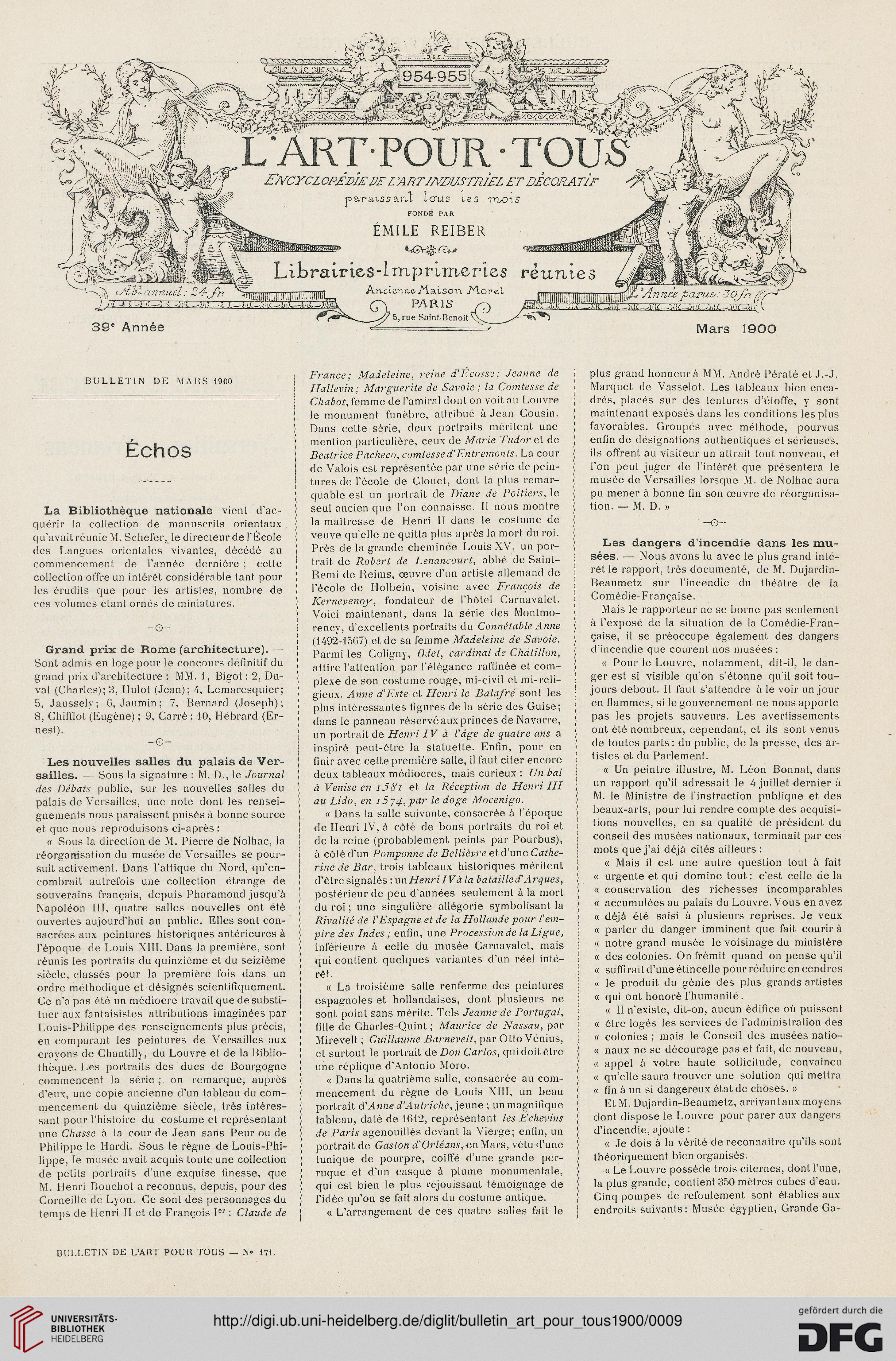L7VRTPOUR • TOUS
ENCYCLOPEDIE DE LART INDUSTRIEL ET DECORA TIF
jaaravssaat toixs les nvotS
FONDÉ PAR
ÉMILE REIBER
Litrairics-Imprimcries réunies
, 5,rue Saint-Benoit^
39e Année ^ Mars 1900
BULLETIN DE MARS 1900
Échos
La Bibliothèque nationale vient d'ac-
quérir la collection de manuscrits orientaux
qu'avait réunie M. Schefer, le directeur de l'École
des Langues orientales vivantes, décédé au
commencement de l'année dernière ; celte
collection offre un intérêt considérable tant pour
les érudits que pour les artistes, nombre de
ces volumes étant ornés de miniatures.
-O-
Grand prix de Rome (architecture). —
Sont admis en loge pour le concours définitif du
grand prix d'architecture : MM. 1, Bigot : 2, Du-
val (Charles); 3, Mulot (Jean); 4, Lemaresquier;
5, Jaussely; 6, Jaumin; 7, Bernard (Joseph);
8, Chifflol (Eugène); 9, Carré; 10, Hébrard (Er-
nest).
-O-
Les nouvelles salles du palais de Ver-
sailles. — Sous la signature : M. D., le Journal
des Débats publie, sur les nouvelles salles du
palais de Versailles, une note dont les rensei-
gnements nous paraissent puisés à bonne source
et que nous reproduisons ci-après :
« Sous la direction de M. Pierre de Nolhac, la
réorganisation du musée de Versailles se pour-
suit activement. Dans l'attique du Nord, qu'en-
combrait autrefois une collection étrange de
souverains français, depuis Pharamond jusqu'à
Napoléon III, quatre salles nouvelles ont été
ouvertes aujourd'hui au public. Elles sont con-
sacrées aux peintures historiques antérieures à
l'époque de Louis XIII. Dans la première, sont
réunis les portraits du quinzième et du seizième
siècle, classés pour la première fois dans un
ordre méthodique et désignés scientifiquement.
Ce n'a pas été un médiocre travail que de substi-
tuer aux fantaisistes attributions imaginées par
Louis-Philippe des renseignements plus précis,
en comparant les peintures de Versailles aux
crayons de Chantilly, du Louvre et de la Biblio-
Ihèque. Les portraits des ducs de Bourgogne
commencent la série ; on remarque, auprès
d'eux, une copie ancienne d'un tableau du com-
mencement du quinzième siècle, très intéres-
sant pour l'histoire du costume et représentant
une Chasse à la cour de Jean sans Peur ou de
Philippe le Hardi. Sous le règne de Louis-Phi-
lippe, le musée avait acquis toute une collection
de petits portraits d'une exquise finesse, que
M. Henri Bouchot a reconnus, depuis, pour des
Corneille de Lyon. Ce sont des personnages du
temps de Henri II et de François Ier : Claude de
i France; Madeleine, reine d'Ecosse; Jeanne de j
Hallevin; Marguerite de Savoie ; la Comtesse de \
Chabot, femme de l'amiral dont on voit au Louvre
le monument funèbre, attribué à Jean Cousin.
Dans cette série, deux portraits méritent une
mention particulière, ceux de Marie Tudor et de
Béatrice Pacheco, comtesse d'Entremonts. La cour
de Valois est représentée par une série de pein-
tures de l'école de Clouet, dont la plus remar- !
quable est un portrait de Diane de Poitiers, le J
seul ancien que l'on connaisse. Il nous montre
la maîtresse de Henri II dans le costume de
veuve qu'elle ne quitta plus après la mort du roi.
' Près de la grande cheminée Louis XV, un por-
trait de Robert de Lenancourt, abbé de Sainl-
Remi de Reims, œuvre d'un artiste allemand de
l'école de Holbein, voisine avec François de j
Kernevenoy, fondateur de l'hôtel Carnavalet.
Voici maintenant, dans la série des Montmo-
rency, d'excellents portraits du Connétable Anne
(1492-1567) et de sa femme Madeleine de Savoie.
Parmi les Coligny, Odet, cardinal de Chdtillon, j
attire l'allention par l'élégance raffinée et com-
plexe de son costume rouge, mi-civil et mi-reli-
! gieux. Anne d'Esté et Henri le Balafré sont les
; plus intéressantes figures de la série des Guise;
dans le panneau réservé aux princes de Navarre,
un portrait de Henri IV à l'âge de quatre ans a
inspiré peut-être la statuette. Enfin, pour en
finir avec celle première salle, il faut citer encore
deux tableaux médiocres, mais curieux : Un bal
à Venise en iJSi et la Réception de Henri III i
au Lido, en 15-4, par le doge Mocenigo.
« Dans la salle suivante, consacrée à l'époque
de Henri IV, à côté de bons portraits du roi et
de la reine (probablement peints par Pourbus),
à côté d'un Pomponne de Bellièvre et d'une Cathe-
rine de Bar, trois tableaux historiques méritent
d'être signalés : unHenrilVà la bataille d'Arqués,
postérieur de peu d'années seulement à la mort j
du roi ; une singulière allégorie symbolisant la
Rivalité de l'Espagne et de la Hollande pour l'em- j
pire des Indes ; enfin, une Procession de la Ligue, i
inférieure à celle du musée Carnavalet, mais
! qui contient quelques variantes d'un réel inté- 1
rêt.
« La troisième salle renferme des peintures j
espagnoles et hollandaises, dont plusieurs ne
sont point sans mérite. Tels Jeanne de Portugal,
fille de Charles-Quint ; Maurice de Nassau, par
Mirevelt ; Guillaume Barnevelt, par Otto Vénius,
et surtout le portrait de Don Carlos, qui doit être
une réplique d'Antonio Moro.
« Dans la quatrième salle, consacrée au com-
mencement du règne de Louis XIII, un beau
portrait d'Anne d'Autriche, jeune ; un magnifique
tableau, daté de 1612, représentant les Échevins
de Paris agenouillés devant la Vierge; enfin, un
portrait de Gaston d'Orléans, en Mars, vêtu d'une
tunique de pourpre, coiffé d'une grande per-
ruque et d'un casque à plume monumentale,
qui est bien le plus réjouissant témoignage de
l'idée qu'on se fait alors du costume antique. j
« L'arrangement de ces quatre salles fait le
plus grand honneur à MM. André Pératô et J.-J.
Marquet de Vasselot. Les tableaux bien enca-
drés, placés sur des tentures d'étoffe, y sont
maintenant exposés dans les conditions les plus
favorables. Groupés avec mélhode, pourvus
enfin de désignalions authentiques et sérieuses,
ils offrent au visiteur un attrait tout nouveau, et
l'on peut juger de l'intérêt que présentera le
musée de Versailles lorsque M. de Nolhac aura
pu mener à bonne fin son œuvre de réorganisa-
tion. — M. D. »
-O-
Les dangers d'incendie dans les mu-
sées. — Nous avons lu avec le plus grand inté-
rêt le rapport, très documenté, de M. Dujardin-
Beaumetz sur l'incendie du théâtre de la
Comédie-Française.
Mais le rapporteur ne se borne pas seulement
à l'exposé de la situation de la Comédie-Fran-
çaise, il se préoccupe également des dangers
d'incendie que courent nos musées :
« Pour le Louvre, notamment, dit-il, le dan-
ger est si visible qu'on s'étonne qu'il soit tou-
jours debout. Il faut s'attendre à le voir un jour
en flammes, si le gouvernement ne nous apporte
pas les projets sauveurs. Les avertissements
ont été nombreux, cependant, et ils sont venus
de toutes parts : du public, de la presse, des ar-
tistes et du Parlement.
« Un peintre illustre, M. Léon Bonnat, dans
un rapport qu'il adressait le 4 juillet dernier à
M. le Ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, pour lui rendre compte des acquisi-
tions nouvelles, en sa qualité de président du
conseil des musées nationaux, terminait par ces
mots que j'ai déjà cités ailleurs :
« Mais il est une autre question tout à fait
« urgente et qui domine tout : c'est celle de la
« conservation des richesses incomparables
« accumulées au palais du Louvre. Vous en avez
« déjà été saisi à plusieurs reprises. Je veux
« parler du danger imminent que fait courir à
« notre grand musée le voisinage du ministère
« des colonies. On frémit quand on pense qu'il
« suffirait d'une étincelle pour réduire en cendres
« le produit du génie des plus grands artistes
« qui ont honoré l'humanité.
« Il n'existe, dit-on, aucun édifice où puissent
« être logés les services de l'administration des
« colonies ; mais le Conseil des musées natio-
« naux ne se décourage pas et fait, de nouveau,
« appel à votre haute sollicitude, convaincu
« qu'elle saura trouver une solution qui mettra
« fin à un si dangereux état de choses. »
Et M. Dujardin-Beaumetz, arrivantaux moyens
dont dispose le Louvre pour parer aux dangers
d'incendie, ajoute :
« Je dois à la vérité de reconnaître qu'ils sont
théoriquement bien organisés.
« Le Louvre possède trois citernes, dont l'une,
la plus grande, contient 350 mètres cubes d'eau.
Cinq pompes de refoulement sont établies aux
endroits suivants: Musée égyptien, Grande Ga-
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS — N« 171
ENCYCLOPEDIE DE LART INDUSTRIEL ET DECORA TIF
jaaravssaat toixs les nvotS
FONDÉ PAR
ÉMILE REIBER
Litrairics-Imprimcries réunies
, 5,rue Saint-Benoit^
39e Année ^ Mars 1900
BULLETIN DE MARS 1900
Échos
La Bibliothèque nationale vient d'ac-
quérir la collection de manuscrits orientaux
qu'avait réunie M. Schefer, le directeur de l'École
des Langues orientales vivantes, décédé au
commencement de l'année dernière ; celte
collection offre un intérêt considérable tant pour
les érudits que pour les artistes, nombre de
ces volumes étant ornés de miniatures.
-O-
Grand prix de Rome (architecture). —
Sont admis en loge pour le concours définitif du
grand prix d'architecture : MM. 1, Bigot : 2, Du-
val (Charles); 3, Mulot (Jean); 4, Lemaresquier;
5, Jaussely; 6, Jaumin; 7, Bernard (Joseph);
8, Chifflol (Eugène); 9, Carré; 10, Hébrard (Er-
nest).
-O-
Les nouvelles salles du palais de Ver-
sailles. — Sous la signature : M. D., le Journal
des Débats publie, sur les nouvelles salles du
palais de Versailles, une note dont les rensei-
gnements nous paraissent puisés à bonne source
et que nous reproduisons ci-après :
« Sous la direction de M. Pierre de Nolhac, la
réorganisation du musée de Versailles se pour-
suit activement. Dans l'attique du Nord, qu'en-
combrait autrefois une collection étrange de
souverains français, depuis Pharamond jusqu'à
Napoléon III, quatre salles nouvelles ont été
ouvertes aujourd'hui au public. Elles sont con-
sacrées aux peintures historiques antérieures à
l'époque de Louis XIII. Dans la première, sont
réunis les portraits du quinzième et du seizième
siècle, classés pour la première fois dans un
ordre méthodique et désignés scientifiquement.
Ce n'a pas été un médiocre travail que de substi-
tuer aux fantaisistes attributions imaginées par
Louis-Philippe des renseignements plus précis,
en comparant les peintures de Versailles aux
crayons de Chantilly, du Louvre et de la Biblio-
Ihèque. Les portraits des ducs de Bourgogne
commencent la série ; on remarque, auprès
d'eux, une copie ancienne d'un tableau du com-
mencement du quinzième siècle, très intéres-
sant pour l'histoire du costume et représentant
une Chasse à la cour de Jean sans Peur ou de
Philippe le Hardi. Sous le règne de Louis-Phi-
lippe, le musée avait acquis toute une collection
de petits portraits d'une exquise finesse, que
M. Henri Bouchot a reconnus, depuis, pour des
Corneille de Lyon. Ce sont des personnages du
temps de Henri II et de François Ier : Claude de
i France; Madeleine, reine d'Ecosse; Jeanne de j
Hallevin; Marguerite de Savoie ; la Comtesse de \
Chabot, femme de l'amiral dont on voit au Louvre
le monument funèbre, attribué à Jean Cousin.
Dans cette série, deux portraits méritent une
mention particulière, ceux de Marie Tudor et de
Béatrice Pacheco, comtesse d'Entremonts. La cour
de Valois est représentée par une série de pein-
tures de l'école de Clouet, dont la plus remar- !
quable est un portrait de Diane de Poitiers, le J
seul ancien que l'on connaisse. Il nous montre
la maîtresse de Henri II dans le costume de
veuve qu'elle ne quitta plus après la mort du roi.
' Près de la grande cheminée Louis XV, un por-
trait de Robert de Lenancourt, abbé de Sainl-
Remi de Reims, œuvre d'un artiste allemand de
l'école de Holbein, voisine avec François de j
Kernevenoy, fondateur de l'hôtel Carnavalet.
Voici maintenant, dans la série des Montmo-
rency, d'excellents portraits du Connétable Anne
(1492-1567) et de sa femme Madeleine de Savoie.
Parmi les Coligny, Odet, cardinal de Chdtillon, j
attire l'allention par l'élégance raffinée et com-
plexe de son costume rouge, mi-civil et mi-reli-
! gieux. Anne d'Esté et Henri le Balafré sont les
; plus intéressantes figures de la série des Guise;
dans le panneau réservé aux princes de Navarre,
un portrait de Henri IV à l'âge de quatre ans a
inspiré peut-être la statuette. Enfin, pour en
finir avec celle première salle, il faut citer encore
deux tableaux médiocres, mais curieux : Un bal
à Venise en iJSi et la Réception de Henri III i
au Lido, en 15-4, par le doge Mocenigo.
« Dans la salle suivante, consacrée à l'époque
de Henri IV, à côté de bons portraits du roi et
de la reine (probablement peints par Pourbus),
à côté d'un Pomponne de Bellièvre et d'une Cathe-
rine de Bar, trois tableaux historiques méritent
d'être signalés : unHenrilVà la bataille d'Arqués,
postérieur de peu d'années seulement à la mort j
du roi ; une singulière allégorie symbolisant la
Rivalité de l'Espagne et de la Hollande pour l'em- j
pire des Indes ; enfin, une Procession de la Ligue, i
inférieure à celle du musée Carnavalet, mais
! qui contient quelques variantes d'un réel inté- 1
rêt.
« La troisième salle renferme des peintures j
espagnoles et hollandaises, dont plusieurs ne
sont point sans mérite. Tels Jeanne de Portugal,
fille de Charles-Quint ; Maurice de Nassau, par
Mirevelt ; Guillaume Barnevelt, par Otto Vénius,
et surtout le portrait de Don Carlos, qui doit être
une réplique d'Antonio Moro.
« Dans la quatrième salle, consacrée au com-
mencement du règne de Louis XIII, un beau
portrait d'Anne d'Autriche, jeune ; un magnifique
tableau, daté de 1612, représentant les Échevins
de Paris agenouillés devant la Vierge; enfin, un
portrait de Gaston d'Orléans, en Mars, vêtu d'une
tunique de pourpre, coiffé d'une grande per-
ruque et d'un casque à plume monumentale,
qui est bien le plus réjouissant témoignage de
l'idée qu'on se fait alors du costume antique. j
« L'arrangement de ces quatre salles fait le
plus grand honneur à MM. André Pératô et J.-J.
Marquet de Vasselot. Les tableaux bien enca-
drés, placés sur des tentures d'étoffe, y sont
maintenant exposés dans les conditions les plus
favorables. Groupés avec mélhode, pourvus
enfin de désignalions authentiques et sérieuses,
ils offrent au visiteur un attrait tout nouveau, et
l'on peut juger de l'intérêt que présentera le
musée de Versailles lorsque M. de Nolhac aura
pu mener à bonne fin son œuvre de réorganisa-
tion. — M. D. »
-O-
Les dangers d'incendie dans les mu-
sées. — Nous avons lu avec le plus grand inté-
rêt le rapport, très documenté, de M. Dujardin-
Beaumetz sur l'incendie du théâtre de la
Comédie-Française.
Mais le rapporteur ne se borne pas seulement
à l'exposé de la situation de la Comédie-Fran-
çaise, il se préoccupe également des dangers
d'incendie que courent nos musées :
« Pour le Louvre, notamment, dit-il, le dan-
ger est si visible qu'on s'étonne qu'il soit tou-
jours debout. Il faut s'attendre à le voir un jour
en flammes, si le gouvernement ne nous apporte
pas les projets sauveurs. Les avertissements
ont été nombreux, cependant, et ils sont venus
de toutes parts : du public, de la presse, des ar-
tistes et du Parlement.
« Un peintre illustre, M. Léon Bonnat, dans
un rapport qu'il adressait le 4 juillet dernier à
M. le Ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, pour lui rendre compte des acquisi-
tions nouvelles, en sa qualité de président du
conseil des musées nationaux, terminait par ces
mots que j'ai déjà cités ailleurs :
« Mais il est une autre question tout à fait
« urgente et qui domine tout : c'est celle de la
« conservation des richesses incomparables
« accumulées au palais du Louvre. Vous en avez
« déjà été saisi à plusieurs reprises. Je veux
« parler du danger imminent que fait courir à
« notre grand musée le voisinage du ministère
« des colonies. On frémit quand on pense qu'il
« suffirait d'une étincelle pour réduire en cendres
« le produit du génie des plus grands artistes
« qui ont honoré l'humanité.
« Il n'existe, dit-on, aucun édifice où puissent
« être logés les services de l'administration des
« colonies ; mais le Conseil des musées natio-
« naux ne se décourage pas et fait, de nouveau,
« appel à votre haute sollicitude, convaincu
« qu'elle saura trouver une solution qui mettra
« fin à un si dangereux état de choses. »
Et M. Dujardin-Beaumetz, arrivantaux moyens
dont dispose le Louvre pour parer aux dangers
d'incendie, ajoute :
« Je dois à la vérité de reconnaître qu'ils sont
théoriquement bien organisés.
« Le Louvre possède trois citernes, dont l'une,
la plus grande, contient 350 mètres cubes d'eau.
Cinq pompes de refoulement sont établies aux
endroits suivants: Musée égyptien, Grande Ga-
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS — N« 171