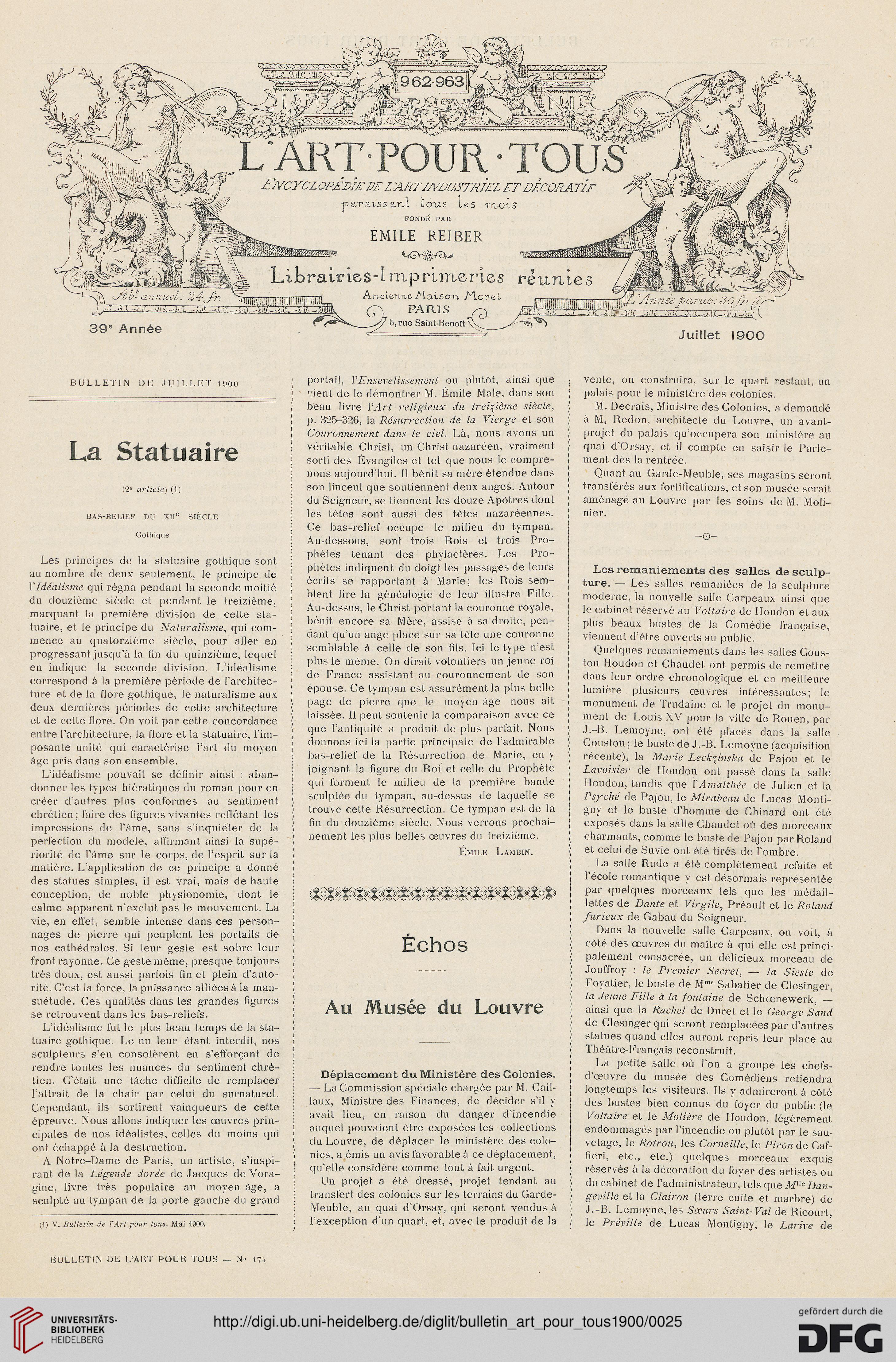C»i«^ 962-963'
L'ART POUR - TOUS
i^/WÊiMM^^^^M/f Encyclopédie'fffart industriel et'décoratif
paraissant laus les nixns
FONDÉ PAR
EMILE REIBER
Librairies-l mprimeries réunie s
J^'i^ {, -i'i^j'^wl^^L^-^^^v-i^)^^^. G\ PARIS y^) iMLix^ i.(-Jil
. . 5, rue Saint-Benoît Vv
39e Année < Juillet 1900
BULLETIN DE JUILLET 1900
La Statuaire
(2° article) (1)
bas-relief du XIIe siècle
Gothique
Les principes de la statuaire gothique sont
au nombre de deux seulement, le principe de
Y Idéalisme qui régna pendant la seconde moitié
du douzième siècle et pendant le treizième,
marquant la première division de cette sta-
tuaire, et le principe du Naturalisme, qui com-
mence au quatorzième siècle, pour aller en
progressant jusqu'à la fin du quinzième, lequel
en indique la seconde division. L'idéalisme
correspond à la première période de l'architec-
ture et de la flore gothique, le naturalisme aux
deux dernières périodes de cette architecture
et de cette flore. On voit par cette concordance
entre l'architecture, la flore et la statuaire, l'im-
posante unité qui caractérise l'art du moyen
âge pris dans son ensemble.
L'idéalisme pouvait se définir ainsi : aban-
donner les types hiératiques du roman pour en
créer d'autres plus conformes au sentiment
chrétien; faire des figures vivantes reflétant les
impressions de l'âme, sans s'inquiéter de la
perfection du modelé, affirmant ainsi la supé-
riorité de l'âme sur le corps, de l'esprit sur la
matière. L'application de ce principe a donné
des statues simples, il est vrai, mais de haute
conception, de noble physionomie, dont le
calme apparent n'exclut pas le mouvement. La
vie, en effet, semble intense dans ces person-
nages de pierre qui peuplent les portails de
nos cathédrales. Si leur geste est sobre leur
front rayonne. Ce geste même, presque toujours
très doux, est aussi parfois fin et plein d'auto-
rité. C'est la force, la puissance alliées à la man-
suétude. Ces qualités dans les grandes figures
se retrouvent dans les bas-reliefs.
L'idéalisme fut le plus beau temps de la sta-
tuaire gothique. Le nu leur étant interdit, nos
sculpteurs s'en consolèrent en s'efforçant de
rendre toutes les nuances du sentiment chré-
tien. C'était une tâche difficile de remplacer
l'attrait de la chair par celui du surnaturel.
Cependant, ils sortirent vainqueurs de cette
épreuve. Nous allons indiquer les œuvres prin-
cipales de nos idéalistes, celles du moins qui
ont échappé à la destruction.
A Notre-Dame de Paris, un artiste, s'inspi-
rant de la Légende dorée de Jacques de Vora-
gine, livre très populaire au moyen âge, a
sculpté au tympan de la porte gauche du grand
(1) V. Bulletin de l'Art pour tous. Mai 1900.
portail, VEnsevelissement ou plutôt, ainsi que
vient de le démontrer M. Emile Maie, dans son
beau livre YArt religieux du treizième siècle,
p. 325-326, la Résurrection de la Vierge et son
Couronnement dans le ciel. Là, nous avons un
véritable Christ, un Christ nazaréen, vraiment
sorti des Évangiles et tel que nous le compre-
nons aujourd'hui. Il bénit sa mère étendue dans
son linceul que soutiennent deux anges. Autour
du Seigneur, se tiennent les douze Apôtres dont
les têtes sont aussi des tètes nazaréennes.
Ce bas-relief occupe le milieu du tympan.
Au-dessous, sont trois Rois et trois Pro-
phètes tenant des phylactères. Les Pro-
phètes indiquent du doigt les passages de leurs
écrits se rapportant à Marie; les Rois sem-
blent lire la généalogie de leur illustre Fille.
Au-dessus, le Christ portant la couronne royale,
bénit encore sa Mère, assise à sa droite, pen-
dant qu'un ange place sur sa tête une couronne
semblable à celle de son fils. Ici le type n'est
plus le même. On dirait volontiers un jeune roi
de France assistant au couronnement de son
épouse. Ce tympan est assurément la plus belle
page de pierre que le moyen âge nous ait
laissée. II peut soutenir la comparaison avec ce
que l'antiquité a produit de plus parlait. Nous
donnons ici la partie principale de l'admirable
bas-relief de la Résurrection de Marie, en y
joignant la figure du Roi et celle du Prophète
qui forment le milieu de la première bande
sculptée du tympan, au-dessus de laquelle se
trouve cette Résurrection. Ce tympan est de la
fin du douzième siècle. Nous verrons prochai-
nement les plus belles œuvres du Ireizième.
Émile Lambin.
Échos
Au Musée du Louvre
Déplacement du Ministère des Colonies.
— La Commission spéciale chargée par M. Cail-
laux, Ministre des Finances, de décider s'il y
avait lieu, en raison du danger d'incendie
auquel pouvaient être exposées les collections
du Louvre, de déplacer le ministère des colo-
nies, a émis un avis favorable à ce déplacement,
qu'elle considère comme tout à fait urgent.
Un projet a été dressé, projet tendant au
transfert des colonies sur les terrains du Garde-
Meuble, au quai d'Orsay, qui seront vendus à
l'exception d'un quart, et, avec le produit de la
vente, on construira, sur le quart restant, un
palais pour le ministère des colonies.
M. Decrais, Ministre des Colonies, a demandé
à M, Redon, architecte du Louvre, un avant-
projet du palais qu'occupera son ministère au
quai d'Orsay, et il compte en saisir le Parle-
ment dès la rentrée.
Quant au Garde-Meuble, ses magasins seront
transférés aux fortifications, et son musée serait
aménagé au Louvre par les soins de M. Moli-
nier.
-O-
Les remaniements des salles de sculp-
ture. — Les salles remaniées de la sculpture
moderne, la nouvelle salle Carpeaux ainsi que
le cabinet réservé au Voltaire de Houdon et aux
plus beaux bustes de la Comédie française,
viennent d'être ouverts au public.
Quelques remaniements dans les salles Cous-
tou Houdon et Chaudet ont permis de remettre
dans leur ordre chronologique et en meilleure
lumière plusieurs œuvres intéressantes; le
monument de Trudaine et le projet du monu-
ment de Louis XV pour la ville de Rouen, par
J.-B. Lemoyne, ont été placés dans la salle
Coustou; le buste de J.-B. Lemoyne (acquisition
récente), la Marie Leck\inska de Pajou et le
Lavoisier de Houdon ont passé dans la salle
Houdon, tandis que VAmalthée de Julien et la
Psyché de Pajou, le Mirabeau de Lucas Monti-
gny et le buste d'homme de Chinard ont été
exposés dans la salle Chaudet où des morceaux
charmants, comme le buste de Pajou par Roland
et celui de Suvie ont été tirés de l'ombre.
La salle Rude a été complètement refaite et
l'école romantique y est désormais représentée
par quelques morceaux tels que les médail-
leltes de Dante et Virgile, Préault et le Roland
furieux de Gabau du Seigneur.
Dans la nouvelle salle Carpeaux, on voit, à
côté des œuvres du maître à qui elle est princi-
palement consacrée, un délicieux morceau de
Jouffroy : le Premier Secret, — la Sieste de
Foyatier, le buste de Mme Sabatier de Clesinger,
la Jeune Fille à la fontaine de Schœnewerk, —
ainsi que la Rachel de Duret et le George Sand
de Clesinger qui seront remplacées par d'autres
statues quand elles auront repris leur place au
Théâtre-Français reconstruit.
La petite salle où l'on a groupé les chefs-
d'œuvre du musée des Comédiens retiendra
longtemps les visiteurs. Ils y admireront à côté
des bustes bien connus du foyer du public (le
Voltaire et le Molière de Houdon, légèrement
endommagés par l'incendie ou plutôt par le sau-
vetage, le Rotrou, les Corneille, le Piron de Caf-
fîeri, etc., etc.) quelques morceaux exquis
réservés à la décoration du foyer des artistes ou
du cabinet de l'administrateur, tels que MileDan-
geville et la Clairon (terre cuite et marbre) de
J.-B. Lemoyne, les Sœurs Saint-Val de Ricourt,
le Préville de Lucas Montigny, le Larive de
BULLETIN DE L'ABT POUB TOUS — M- 17,'.
L'ART POUR - TOUS
i^/WÊiMM^^^^M/f Encyclopédie'fffart industriel et'décoratif
paraissant laus les nixns
FONDÉ PAR
EMILE REIBER
Librairies-l mprimeries réunie s
J^'i^ {, -i'i^j'^wl^^L^-^^^v-i^)^^^. G\ PARIS y^) iMLix^ i.(-Jil
. . 5, rue Saint-Benoît Vv
39e Année < Juillet 1900
BULLETIN DE JUILLET 1900
La Statuaire
(2° article) (1)
bas-relief du XIIe siècle
Gothique
Les principes de la statuaire gothique sont
au nombre de deux seulement, le principe de
Y Idéalisme qui régna pendant la seconde moitié
du douzième siècle et pendant le treizième,
marquant la première division de cette sta-
tuaire, et le principe du Naturalisme, qui com-
mence au quatorzième siècle, pour aller en
progressant jusqu'à la fin du quinzième, lequel
en indique la seconde division. L'idéalisme
correspond à la première période de l'architec-
ture et de la flore gothique, le naturalisme aux
deux dernières périodes de cette architecture
et de cette flore. On voit par cette concordance
entre l'architecture, la flore et la statuaire, l'im-
posante unité qui caractérise l'art du moyen
âge pris dans son ensemble.
L'idéalisme pouvait se définir ainsi : aban-
donner les types hiératiques du roman pour en
créer d'autres plus conformes au sentiment
chrétien; faire des figures vivantes reflétant les
impressions de l'âme, sans s'inquiéter de la
perfection du modelé, affirmant ainsi la supé-
riorité de l'âme sur le corps, de l'esprit sur la
matière. L'application de ce principe a donné
des statues simples, il est vrai, mais de haute
conception, de noble physionomie, dont le
calme apparent n'exclut pas le mouvement. La
vie, en effet, semble intense dans ces person-
nages de pierre qui peuplent les portails de
nos cathédrales. Si leur geste est sobre leur
front rayonne. Ce geste même, presque toujours
très doux, est aussi parfois fin et plein d'auto-
rité. C'est la force, la puissance alliées à la man-
suétude. Ces qualités dans les grandes figures
se retrouvent dans les bas-reliefs.
L'idéalisme fut le plus beau temps de la sta-
tuaire gothique. Le nu leur étant interdit, nos
sculpteurs s'en consolèrent en s'efforçant de
rendre toutes les nuances du sentiment chré-
tien. C'était une tâche difficile de remplacer
l'attrait de la chair par celui du surnaturel.
Cependant, ils sortirent vainqueurs de cette
épreuve. Nous allons indiquer les œuvres prin-
cipales de nos idéalistes, celles du moins qui
ont échappé à la destruction.
A Notre-Dame de Paris, un artiste, s'inspi-
rant de la Légende dorée de Jacques de Vora-
gine, livre très populaire au moyen âge, a
sculpté au tympan de la porte gauche du grand
(1) V. Bulletin de l'Art pour tous. Mai 1900.
portail, VEnsevelissement ou plutôt, ainsi que
vient de le démontrer M. Emile Maie, dans son
beau livre YArt religieux du treizième siècle,
p. 325-326, la Résurrection de la Vierge et son
Couronnement dans le ciel. Là, nous avons un
véritable Christ, un Christ nazaréen, vraiment
sorti des Évangiles et tel que nous le compre-
nons aujourd'hui. Il bénit sa mère étendue dans
son linceul que soutiennent deux anges. Autour
du Seigneur, se tiennent les douze Apôtres dont
les têtes sont aussi des tètes nazaréennes.
Ce bas-relief occupe le milieu du tympan.
Au-dessous, sont trois Rois et trois Pro-
phètes tenant des phylactères. Les Pro-
phètes indiquent du doigt les passages de leurs
écrits se rapportant à Marie; les Rois sem-
blent lire la généalogie de leur illustre Fille.
Au-dessus, le Christ portant la couronne royale,
bénit encore sa Mère, assise à sa droite, pen-
dant qu'un ange place sur sa tête une couronne
semblable à celle de son fils. Ici le type n'est
plus le même. On dirait volontiers un jeune roi
de France assistant au couronnement de son
épouse. Ce tympan est assurément la plus belle
page de pierre que le moyen âge nous ait
laissée. II peut soutenir la comparaison avec ce
que l'antiquité a produit de plus parlait. Nous
donnons ici la partie principale de l'admirable
bas-relief de la Résurrection de Marie, en y
joignant la figure du Roi et celle du Prophète
qui forment le milieu de la première bande
sculptée du tympan, au-dessus de laquelle se
trouve cette Résurrection. Ce tympan est de la
fin du douzième siècle. Nous verrons prochai-
nement les plus belles œuvres du Ireizième.
Émile Lambin.
Échos
Au Musée du Louvre
Déplacement du Ministère des Colonies.
— La Commission spéciale chargée par M. Cail-
laux, Ministre des Finances, de décider s'il y
avait lieu, en raison du danger d'incendie
auquel pouvaient être exposées les collections
du Louvre, de déplacer le ministère des colo-
nies, a émis un avis favorable à ce déplacement,
qu'elle considère comme tout à fait urgent.
Un projet a été dressé, projet tendant au
transfert des colonies sur les terrains du Garde-
Meuble, au quai d'Orsay, qui seront vendus à
l'exception d'un quart, et, avec le produit de la
vente, on construira, sur le quart restant, un
palais pour le ministère des colonies.
M. Decrais, Ministre des Colonies, a demandé
à M, Redon, architecte du Louvre, un avant-
projet du palais qu'occupera son ministère au
quai d'Orsay, et il compte en saisir le Parle-
ment dès la rentrée.
Quant au Garde-Meuble, ses magasins seront
transférés aux fortifications, et son musée serait
aménagé au Louvre par les soins de M. Moli-
nier.
-O-
Les remaniements des salles de sculp-
ture. — Les salles remaniées de la sculpture
moderne, la nouvelle salle Carpeaux ainsi que
le cabinet réservé au Voltaire de Houdon et aux
plus beaux bustes de la Comédie française,
viennent d'être ouverts au public.
Quelques remaniements dans les salles Cous-
tou Houdon et Chaudet ont permis de remettre
dans leur ordre chronologique et en meilleure
lumière plusieurs œuvres intéressantes; le
monument de Trudaine et le projet du monu-
ment de Louis XV pour la ville de Rouen, par
J.-B. Lemoyne, ont été placés dans la salle
Coustou; le buste de J.-B. Lemoyne (acquisition
récente), la Marie Leck\inska de Pajou et le
Lavoisier de Houdon ont passé dans la salle
Houdon, tandis que VAmalthée de Julien et la
Psyché de Pajou, le Mirabeau de Lucas Monti-
gny et le buste d'homme de Chinard ont été
exposés dans la salle Chaudet où des morceaux
charmants, comme le buste de Pajou par Roland
et celui de Suvie ont été tirés de l'ombre.
La salle Rude a été complètement refaite et
l'école romantique y est désormais représentée
par quelques morceaux tels que les médail-
leltes de Dante et Virgile, Préault et le Roland
furieux de Gabau du Seigneur.
Dans la nouvelle salle Carpeaux, on voit, à
côté des œuvres du maître à qui elle est princi-
palement consacrée, un délicieux morceau de
Jouffroy : le Premier Secret, — la Sieste de
Foyatier, le buste de Mme Sabatier de Clesinger,
la Jeune Fille à la fontaine de Schœnewerk, —
ainsi que la Rachel de Duret et le George Sand
de Clesinger qui seront remplacées par d'autres
statues quand elles auront repris leur place au
Théâtre-Français reconstruit.
La petite salle où l'on a groupé les chefs-
d'œuvre du musée des Comédiens retiendra
longtemps les visiteurs. Ils y admireront à côté
des bustes bien connus du foyer du public (le
Voltaire et le Molière de Houdon, légèrement
endommagés par l'incendie ou plutôt par le sau-
vetage, le Rotrou, les Corneille, le Piron de Caf-
fîeri, etc., etc.) quelques morceaux exquis
réservés à la décoration du foyer des artistes ou
du cabinet de l'administrateur, tels que MileDan-
geville et la Clairon (terre cuite et marbre) de
J.-B. Lemoyne, les Sœurs Saint-Val de Ricourt,
le Préville de Lucas Montigny, le Larive de
BULLETIN DE L'ABT POUB TOUS — M- 17,'.