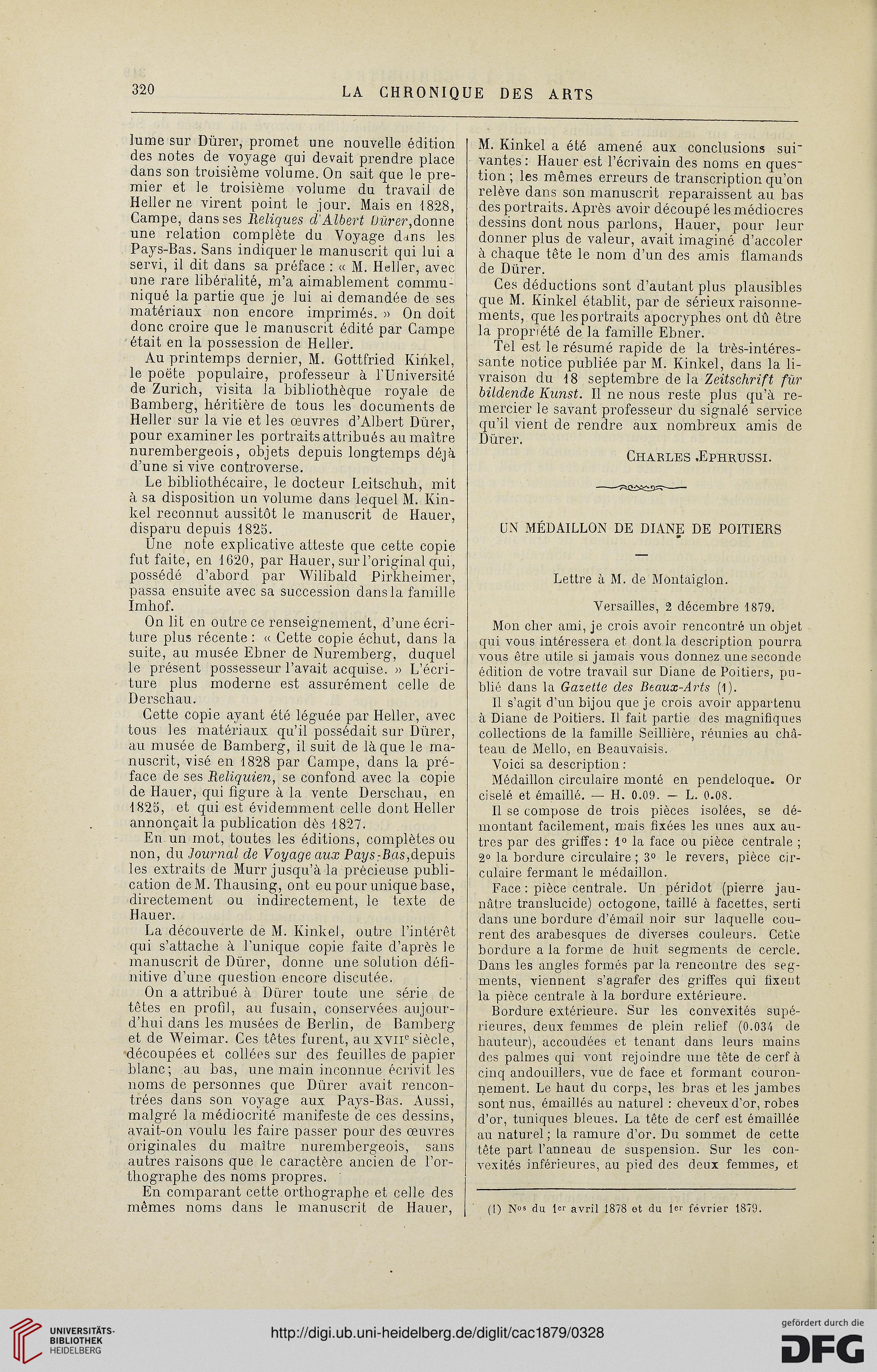320
LA CHRONIQUE DES ARTS
lume sur Dürer, promet une nouvelle édition
des notes de voyage qui devait prendre place
dans son troisième volume. On sait que le pre-
mier et le troisième volume du travail de
Heller ne virent point le jour. Mais en 1828,
Campe, dans ses Reliques d'Albert Durer,donne
une relation complète du Voyage dans les
Pays-Bas. Sans indiquer le manuscrit qui lui a
servi, il dit dans sa préface : « M. Heller, avec
une rare libéralité, m’a aimablement commu-
niqué la partie que je lui ai demandée de ses
matériaux non encore imprimés. » On doit
donc croire que le manuscrit édité par Campe
était en la possession de Heller.
Au printemps dernier, M. Gottfried Kinkel,
le poète populaire, professeur à l’Université
de Zurich, visita la bibliothèque royale de
Bamberg, héritière de tous les documents de
Heller sur la vie et les oîuvres d’Albert Dürer,
pour examiner les portraits attribués au maître
nurembergeois, objets depuis longtemps déjà
d'une si vive controverse.
Le bibliothécaire, le docteur I.eitschuh, mit
à sa disposition un volume dans lequel M. Kin-
kel reconnut aussitôt le manuscrit de Hauer,
disparu depuis 1823.
Une note explicative atteste que cette copie
fut faite, en 1620, par Hauer, sur l’original qui,
possédé d’abord par Wilibald Pirkheimer,
passa ensuite avec sa succession dans la famille
Imliof.
On lit en outre ce renseignement, d’une écri-
ture plus récente : « Cette copie échut, dans la
suite, au musée Ebner de Nuremberg, duquel
le présent possesseur l’avait acquise. » L’écri-
ture plus moderne est assurément celle de
Derschau.
Cette copie ayant été léguée par Heller, avec
tous les matériaux qu’il possédait sur Dürer,
au musée de Bamberg, il suit de là que le ma-
nuscrit, visé en 1828 par Campe, dans la pré-
face de ses Reliquien, se confond avec la copie
de Hauer, qui figure à la vente Derschau, en
1823, et qui est évidemment celle dont Heller
annonçait la publication dès 1827.
En un mot, toutes les éditions, complètes ou
non, du Journal de Voyage aux Pays-Bas,depuis
les extraits de Murr jusqu’à la précieuse publi-
cation de M. Thausing, ont eu pour unique base,
directement ou indirectement, le texte de
Hauer.
La découverte de M. Kinkel, outre l’intérêt
qui s’attache à l’unique copie faite d’après le
manuscrit de Dürer, donne une solution défi-
nitive d’une question encore discutée.
On a attribué à Durer toute une série de
têtes en profil, au fusain, conservées aujour-
d’hui dans les musées de Berlin, de Bamberg
et de Weimar. Ces têtes furent, au xvne siècle,
découpées et collées sur des feuilles de papier
blanc; au bas, une main inconnue écrivit les
noms de personnes que Dürer avait rencon-
trées dans son voyage aux Pays-Bas. Aussi,
malgré la médiocrité manifeste de ces dessins,
avait-on voulu les faire passer pour des œuvres
originales du maître nurembergeois, sans
autres raisons que le caractère ancien de l’or-
thographe des noms propres.
En comparant cette orthographe et celle des
mêmes noms dans le manuscrit de Hauer,
M. Kinkel a été amené aux conclusions sur
vantes : Hauer est l’écrivain des noms en ques-
tion ; les mêmes erreurs de transcription qu’on
relève dans son manuscrit reparaissent au bas
des portraits. Après avoir découpé les médiocres
dessins dont nous parlons, Hauer, pour leur
donner plus de valeur, avait imaginé d’accoler
à chaque tête le nom d’un des amis flamands
de Dürer.
Ces déductions sont d’autant plus plausibles
que M. Kinkel établit, par de sérieux raisonne-
ments, que les portraits apocryphes ont dû être
la propriété de la famille Ebner.
Tel est le résumé rapide de la très-intéres-
sante notice publiée par M. Kinkel, dans la li-
vraison du 18 septembre de la Zeitschrift fur
bildende Kunst. Il ne nous reste plus qu’à re-
mercier le savant professeur du signalé service
qu’il vient de rendre aux nombreux amis de
Dürer.
Charles .Ephrussi.
-——-—
UN MÉDAILLON DE DIANE DE POITIERS
Lettre à M. de Montaiglon.
Versailles, 2 décembre 1879.
Mon cher ami, je crois avoir rencontré un objet
qui vous intéressera et dont la description pourra
vous être utile si jamais vous donnez une seconde
édition de votre travail sur Diane de Poitiers, pu-
blié dans la Gazette des Beaux-Arts (1).
Il s’agit d’un bijou que je crois avoir appartenu
à Diane de Poitiers. Il fait partie des magnifiques
collections de la famille Seillière, réunies au châ-
teau de Mello, en Beauvaisis.
Voici sa description :
Médaillon circulaire monté en pendeloque. Or
ciselé et émaillé. — H. 0.09. — L. 0.08.
Il se compose de trois pièces isolées, se dé-
montant facilement, mais fixées les unes aux au-
tres par des griffes : 1° la face ou pièce centrale ;
2° la bordure circulaire ; 3° le revers, pièce cir-
culaire fermant le médaillon.
Face : pièce centrale. Un péridot (pierre jau-
nâtre translucide) octogone, taillé à facettes, serti
dans une bordure d’émail noir sur laquelle cou-
rent des arabesques de diverses couleurs. Cette
bordure a la forme de huit segments de cercle.
Dans les angles formés par la rencontre des seg-
ments, viennent s’agrafer des griffes qui fixent
la pièce centrale à la bordure extérieure.
Bordure extérieure. Sur les convexités supé-
rieures, deux femmes de plein relief (0.034 de
hauteur), accoudées et tenant dans leurs mains
des palmes qui vont rejoindre une tête de cerf à
cinq andouillers, vue de face et formant couron-
nement. Le haut du corps, les bras et les jambes
sont nus, émaillés au naturel : cheveux d'or, robes
d’or, tuniques bleues. La tête de cerf est émaillée
au naturel ; la ramure d’or. Du sommet de cette
tête part l’anneau de suspension. Sur les con-
vexités inférieures, au pied des deux femmes, et
(1) N°s du pr avril 1878 et du 1er février 1879.
LA CHRONIQUE DES ARTS
lume sur Dürer, promet une nouvelle édition
des notes de voyage qui devait prendre place
dans son troisième volume. On sait que le pre-
mier et le troisième volume du travail de
Heller ne virent point le jour. Mais en 1828,
Campe, dans ses Reliques d'Albert Durer,donne
une relation complète du Voyage dans les
Pays-Bas. Sans indiquer le manuscrit qui lui a
servi, il dit dans sa préface : « M. Heller, avec
une rare libéralité, m’a aimablement commu-
niqué la partie que je lui ai demandée de ses
matériaux non encore imprimés. » On doit
donc croire que le manuscrit édité par Campe
était en la possession de Heller.
Au printemps dernier, M. Gottfried Kinkel,
le poète populaire, professeur à l’Université
de Zurich, visita la bibliothèque royale de
Bamberg, héritière de tous les documents de
Heller sur la vie et les oîuvres d’Albert Dürer,
pour examiner les portraits attribués au maître
nurembergeois, objets depuis longtemps déjà
d'une si vive controverse.
Le bibliothécaire, le docteur I.eitschuh, mit
à sa disposition un volume dans lequel M. Kin-
kel reconnut aussitôt le manuscrit de Hauer,
disparu depuis 1823.
Une note explicative atteste que cette copie
fut faite, en 1620, par Hauer, sur l’original qui,
possédé d’abord par Wilibald Pirkheimer,
passa ensuite avec sa succession dans la famille
Imliof.
On lit en outre ce renseignement, d’une écri-
ture plus récente : « Cette copie échut, dans la
suite, au musée Ebner de Nuremberg, duquel
le présent possesseur l’avait acquise. » L’écri-
ture plus moderne est assurément celle de
Derschau.
Cette copie ayant été léguée par Heller, avec
tous les matériaux qu’il possédait sur Dürer,
au musée de Bamberg, il suit de là que le ma-
nuscrit, visé en 1828 par Campe, dans la pré-
face de ses Reliquien, se confond avec la copie
de Hauer, qui figure à la vente Derschau, en
1823, et qui est évidemment celle dont Heller
annonçait la publication dès 1827.
En un mot, toutes les éditions, complètes ou
non, du Journal de Voyage aux Pays-Bas,depuis
les extraits de Murr jusqu’à la précieuse publi-
cation de M. Thausing, ont eu pour unique base,
directement ou indirectement, le texte de
Hauer.
La découverte de M. Kinkel, outre l’intérêt
qui s’attache à l’unique copie faite d’après le
manuscrit de Dürer, donne une solution défi-
nitive d’une question encore discutée.
On a attribué à Durer toute une série de
têtes en profil, au fusain, conservées aujour-
d’hui dans les musées de Berlin, de Bamberg
et de Weimar. Ces têtes furent, au xvne siècle,
découpées et collées sur des feuilles de papier
blanc; au bas, une main inconnue écrivit les
noms de personnes que Dürer avait rencon-
trées dans son voyage aux Pays-Bas. Aussi,
malgré la médiocrité manifeste de ces dessins,
avait-on voulu les faire passer pour des œuvres
originales du maître nurembergeois, sans
autres raisons que le caractère ancien de l’or-
thographe des noms propres.
En comparant cette orthographe et celle des
mêmes noms dans le manuscrit de Hauer,
M. Kinkel a été amené aux conclusions sur
vantes : Hauer est l’écrivain des noms en ques-
tion ; les mêmes erreurs de transcription qu’on
relève dans son manuscrit reparaissent au bas
des portraits. Après avoir découpé les médiocres
dessins dont nous parlons, Hauer, pour leur
donner plus de valeur, avait imaginé d’accoler
à chaque tête le nom d’un des amis flamands
de Dürer.
Ces déductions sont d’autant plus plausibles
que M. Kinkel établit, par de sérieux raisonne-
ments, que les portraits apocryphes ont dû être
la propriété de la famille Ebner.
Tel est le résumé rapide de la très-intéres-
sante notice publiée par M. Kinkel, dans la li-
vraison du 18 septembre de la Zeitschrift fur
bildende Kunst. Il ne nous reste plus qu’à re-
mercier le savant professeur du signalé service
qu’il vient de rendre aux nombreux amis de
Dürer.
Charles .Ephrussi.
-——-—
UN MÉDAILLON DE DIANE DE POITIERS
Lettre à M. de Montaiglon.
Versailles, 2 décembre 1879.
Mon cher ami, je crois avoir rencontré un objet
qui vous intéressera et dont la description pourra
vous être utile si jamais vous donnez une seconde
édition de votre travail sur Diane de Poitiers, pu-
blié dans la Gazette des Beaux-Arts (1).
Il s’agit d’un bijou que je crois avoir appartenu
à Diane de Poitiers. Il fait partie des magnifiques
collections de la famille Seillière, réunies au châ-
teau de Mello, en Beauvaisis.
Voici sa description :
Médaillon circulaire monté en pendeloque. Or
ciselé et émaillé. — H. 0.09. — L. 0.08.
Il se compose de trois pièces isolées, se dé-
montant facilement, mais fixées les unes aux au-
tres par des griffes : 1° la face ou pièce centrale ;
2° la bordure circulaire ; 3° le revers, pièce cir-
culaire fermant le médaillon.
Face : pièce centrale. Un péridot (pierre jau-
nâtre translucide) octogone, taillé à facettes, serti
dans une bordure d’émail noir sur laquelle cou-
rent des arabesques de diverses couleurs. Cette
bordure a la forme de huit segments de cercle.
Dans les angles formés par la rencontre des seg-
ments, viennent s’agrafer des griffes qui fixent
la pièce centrale à la bordure extérieure.
Bordure extérieure. Sur les convexités supé-
rieures, deux femmes de plein relief (0.034 de
hauteur), accoudées et tenant dans leurs mains
des palmes qui vont rejoindre une tête de cerf à
cinq andouillers, vue de face et formant couron-
nement. Le haut du corps, les bras et les jambes
sont nus, émaillés au naturel : cheveux d'or, robes
d’or, tuniques bleues. La tête de cerf est émaillée
au naturel ; la ramure d’or. Du sommet de cette
tête part l’anneau de suspension. Sur les con-
vexités inférieures, au pied des deux femmes, et
(1) N°s du pr avril 1878 et du 1er février 1879.