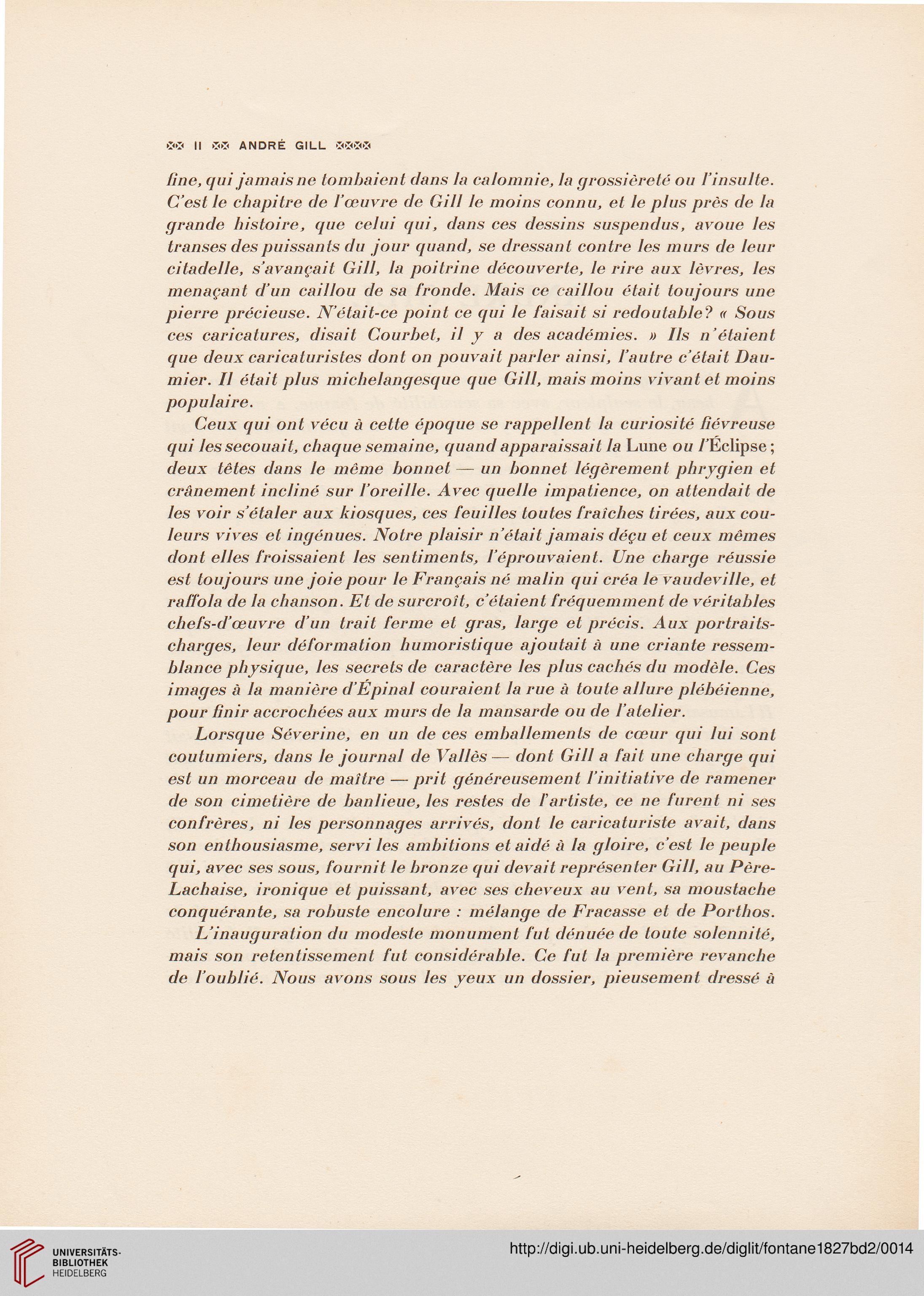** Il XX ANDRÉ GILL ****
line, qui jamais ne tombaient dans la calomnie, la grossièreté ou l'insulte.
C'est le chapitre de l'œuvre de GUI le moins connu, et le plus près de la
grande histoire, que celui qui, dans ces dessins suspendus, avoue les
transes des puissants du jour quand, se dressant contre les murs de leur
citadelle, s'avançait Gill, la poitrine découverte, le rire aux lèvres, les
menaçant d'un caillou de sa fronde. Mais ce caillou était toujours une
pierre précieuse. N'était-ce point ce qui le faisait si redoutable? « Sous
ces caricatures, disait Courbet, il y a des académies. » Ils n'étaient
que deux caricaturistes dont on pouvait parler ainsi, l'autre c'était Dau-
mier. Il était plus michelangesque que Gill, mais moins vivant et moins
populaire.
Ceux qui ont vécu à cette époque se rappellent la curiosité fiévreuse
qui les secouait, chaque semaine, quand apparaissait la Lune ou /'Eclipse ;
deux têtes dans le même bonnet — un bonnet légèrement phrygien et
crânement incliné sur l'oreille. Avec quelle impatience, on attendait de
les voir s'étaler aux kiosques, ces feuilles toutes fraîches tirées, aux cou-
leurs vives et ingénues. Notre plaisir n'était jamais déçu et ceux mêmes
dont elles froissaient les sentiments, l'éprouvaient. Une charge réussie
est toujours une joie pour le Français né malin qui créa le vaudeville, et
raffola de la chanson. Et de surcroît, c'étaient fréquemment de véritables
chefs-d'œuvre d'un trait ferme et gras, large et précis. Aux portraits-
charges, leur déformation humoristique ajoutait à une criante ressem-
blance physique, les secrets de caractère les plus cachés du modèle. Ces
images à la manière d'Épinal couraient la rue à toute allure plébéienne,
pour finir accrochées aux murs de la mansarde ou de l'atelier.
Lorsque Séverine, en un de ces emballements de cœur qui lui sont
coutumiers, dans le journal de Vallès— dont Gill a fait une charge qui
est un morceau de maître — prit généreusement l'initiative de ramener
de son cimetière de banlieue, les restes de f artiste, ce ne furent ni ses
confrères, ni les personnages arrivés, dont le caricaturiste avait, dans
son enthousiasme, servi les ambitions et aidé à la gloire, c'est le peuple
qui, avec ses sous, fournit le bronze qui devait représenter Gill, au Père-
Lachaise, ironique et puissant, avec ses cheveux au vent, sa moustache
conquérante, sa robuste encolure : mélange de Fracasse et de Porthos.
L'inauguration du modeste monument fut dénuée de toute solennité,
mais son retentissement fut considérable. Ce fut la première revanche
de l'oublié. Nous avons sous les yeux un dossier, pieusement dressé à
line, qui jamais ne tombaient dans la calomnie, la grossièreté ou l'insulte.
C'est le chapitre de l'œuvre de GUI le moins connu, et le plus près de la
grande histoire, que celui qui, dans ces dessins suspendus, avoue les
transes des puissants du jour quand, se dressant contre les murs de leur
citadelle, s'avançait Gill, la poitrine découverte, le rire aux lèvres, les
menaçant d'un caillou de sa fronde. Mais ce caillou était toujours une
pierre précieuse. N'était-ce point ce qui le faisait si redoutable? « Sous
ces caricatures, disait Courbet, il y a des académies. » Ils n'étaient
que deux caricaturistes dont on pouvait parler ainsi, l'autre c'était Dau-
mier. Il était plus michelangesque que Gill, mais moins vivant et moins
populaire.
Ceux qui ont vécu à cette époque se rappellent la curiosité fiévreuse
qui les secouait, chaque semaine, quand apparaissait la Lune ou /'Eclipse ;
deux têtes dans le même bonnet — un bonnet légèrement phrygien et
crânement incliné sur l'oreille. Avec quelle impatience, on attendait de
les voir s'étaler aux kiosques, ces feuilles toutes fraîches tirées, aux cou-
leurs vives et ingénues. Notre plaisir n'était jamais déçu et ceux mêmes
dont elles froissaient les sentiments, l'éprouvaient. Une charge réussie
est toujours une joie pour le Français né malin qui créa le vaudeville, et
raffola de la chanson. Et de surcroît, c'étaient fréquemment de véritables
chefs-d'œuvre d'un trait ferme et gras, large et précis. Aux portraits-
charges, leur déformation humoristique ajoutait à une criante ressem-
blance physique, les secrets de caractère les plus cachés du modèle. Ces
images à la manière d'Épinal couraient la rue à toute allure plébéienne,
pour finir accrochées aux murs de la mansarde ou de l'atelier.
Lorsque Séverine, en un de ces emballements de cœur qui lui sont
coutumiers, dans le journal de Vallès— dont Gill a fait une charge qui
est un morceau de maître — prit généreusement l'initiative de ramener
de son cimetière de banlieue, les restes de f artiste, ce ne furent ni ses
confrères, ni les personnages arrivés, dont le caricaturiste avait, dans
son enthousiasme, servi les ambitions et aidé à la gloire, c'est le peuple
qui, avec ses sous, fournit le bronze qui devait représenter Gill, au Père-
Lachaise, ironique et puissant, avec ses cheveux au vent, sa moustache
conquérante, sa robuste encolure : mélange de Fracasse et de Porthos.
L'inauguration du modeste monument fut dénuée de toute solennité,
mais son retentissement fut considérable. Ce fut la première revanche
de l'oublié. Nous avons sous les yeux un dossier, pieusement dressé à