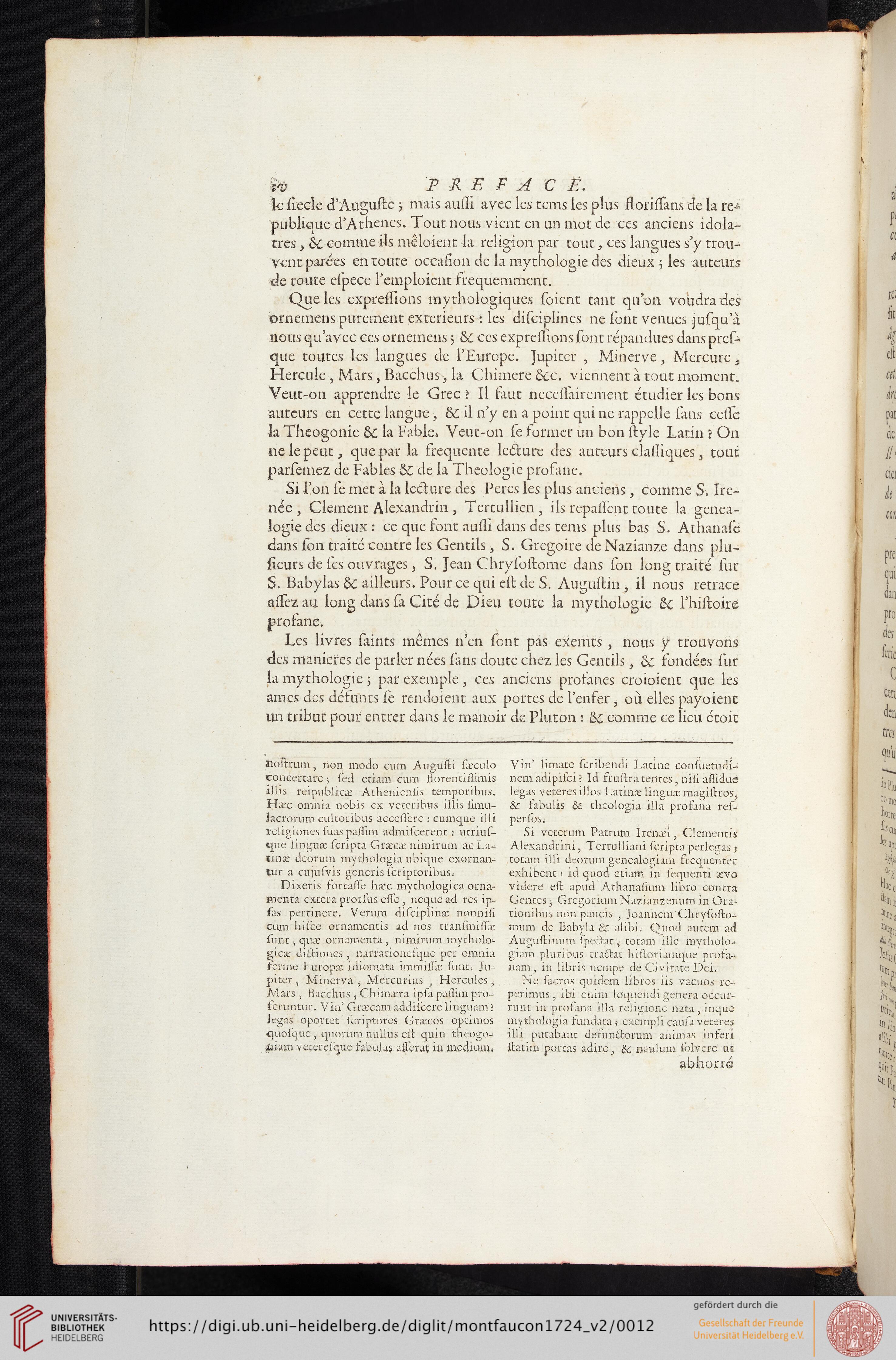fa P R E F A C Ê.
k siecle d’Auguste ; mais aussi avec les tems les plus ssorissàns de la ré-
publique d’Achencs. Tout nous vient en un mot de ces anciens idolâ-
tres , 6c comme ils mcloient la religion par tout, ces langues s’y trou-
vent parées entoure occasion de la mythologie des dieux ; les auteurs
de toute espece l’emploient fréquemment.
Que les expressions mythologiques soient tant qu’on voudra des
ornemens purement extérieurs : les disciplines ne sont venues jusqu’à
nous qu’avec ces ornemens $ & ces expressions sont répandues dans pres-
que toutes les langues de l’Europe. Jupiter , Minerve, Mercure ,
Hercule, Mars, Bacchus, la Chimere 6cc. viennent à tout moment.
Veut-on apprendre le Grec ? Il faut necessairement étudier les bons
auteurs en cette langue, & il n’y en a point qui ne rappelle sans cessè
la Théogonie 6c la Fable. Veut-on se former un bon flylc Latin ? On
ne le peut, que par la frequente leéture des auteurs classiques, tout
parsemez de Fables 6c de la Théologie profane.
Si l’on se met à la leéture des Peres les plus anciens, comme S. Ire-
née , Clement Alexandrin , Tertullien, ils repassent toute la généa-
logie des dieux : ce que font aussi dans des tems plus bas S. Athanase
dans son traité contre les Gentils, S. Grégoire de Nazianze dans plu-
sieurs de ses ouvrages, S. Jean Chrysostome dans son long traité sur
S. Babylas 6c ailleurs. Pour ce qui efl: de S. Augustin , il nous retrace
allez au long dans sa Cité de Dieu toute la mythologie ôc l’histoire
profane.
Les livres saints mêmes n’en sont pas exemts, nous y trouvons
des maniérés de parler nées sans doute chez les Gentils, 6c fondées sur
la mythologie ; par exemple , ces anciens profanes croioient que les
âmes des défunts se rendoient aux portes de l’enfer, où elles payoienc
un tribut pour encrer dans le manoir de Pluton : 6c comme ce lieu étoit
îiostrum, non modo cum Augusti sæculo
concertare ; sed etiam cum ssorentissimis
illis reipublicæ Athenieniis temporibus.
Hæc omnia nobis ex veteribus illis simu-
lacrorum cultoribus accessere : cumque illi
religiones luas passim admiseerent : utrius-
que linguæ seripta Græcæ nimirum acLa-
linæ deorum mythologia ubique exornam
tur a cujusvis generis seriptoribus.
Dixeris fortasse hæc mythologica orna-*
menta extera prorsus esse , neque ad res ip-
sas pertinere. Verum diseiplinæ nonnili
cum hisce ornamentis ad nos transmissæ
sunt,quæ ornamenta, nimirum mytholo-
gicæ didiones, narrationesque per omnia
serme Europae idiomata immissæ sunt; Ju-
piter , Minerva , Mercurius t Hercules ,
Mars, Bacchus, Chimæra ipsa passim pro-
feruntur. Vin’ Græcam addiseere linguam ?
legas oportet seriptores Græcos optimos
quoique , quorum nullus ell quin theogo-^
&iam veteresque sabulas afferat in medium.
Vin’ limate seribendi Latine consuetudi-
nem adipisei ? Id frustra tentes, nili assidue
legas veteres illos Latinæ linguæ magistros,
& fabulis & theologia illa profana res-
persos.
Si veterum Patrum Irenæi, Clementis
Alexandrini, Tertulliani seripta perlegas ?
totam illi deorum genealogiam frequenter
exhibent 2 id quod etiam in sequenti ævo
videre est apud Athanasium libro contra
Gentes, Gregorium NazianZenum in Ora-
tionibus non paucis y Joannem Chrysoflzo-
mum de Babyla & alibi. Quod autem ad
Augustinum spedat , totam ille mytholo-
giam pluribus tradat hiftoriamque profa-
nam , in libris nempe de Civitate Dei.
Ne sacros quidem libros iis vacuos re-*
perimus, ibi enim loquendi genera occur-
runt in profana illa religione nata, inque
mythologia fundata ÿ exempli causa veteres
illi putabant desunctorum animas inferi
ssatim portas adire 3 & naulum solvere ut
abhorw
k siecle d’Auguste ; mais aussi avec les tems les plus ssorissàns de la ré-
publique d’Achencs. Tout nous vient en un mot de ces anciens idolâ-
tres , 6c comme ils mcloient la religion par tout, ces langues s’y trou-
vent parées entoure occasion de la mythologie des dieux ; les auteurs
de toute espece l’emploient fréquemment.
Que les expressions mythologiques soient tant qu’on voudra des
ornemens purement extérieurs : les disciplines ne sont venues jusqu’à
nous qu’avec ces ornemens $ & ces expressions sont répandues dans pres-
que toutes les langues de l’Europe. Jupiter , Minerve, Mercure ,
Hercule, Mars, Bacchus, la Chimere 6cc. viennent à tout moment.
Veut-on apprendre le Grec ? Il faut necessairement étudier les bons
auteurs en cette langue, & il n’y en a point qui ne rappelle sans cessè
la Théogonie 6c la Fable. Veut-on se former un bon flylc Latin ? On
ne le peut, que par la frequente leéture des auteurs classiques, tout
parsemez de Fables 6c de la Théologie profane.
Si l’on se met à la leéture des Peres les plus anciens, comme S. Ire-
née , Clement Alexandrin , Tertullien, ils repassent toute la généa-
logie des dieux : ce que font aussi dans des tems plus bas S. Athanase
dans son traité contre les Gentils, S. Grégoire de Nazianze dans plu-
sieurs de ses ouvrages, S. Jean Chrysostome dans son long traité sur
S. Babylas 6c ailleurs. Pour ce qui efl: de S. Augustin , il nous retrace
allez au long dans sa Cité de Dieu toute la mythologie ôc l’histoire
profane.
Les livres saints mêmes n’en sont pas exemts, nous y trouvons
des maniérés de parler nées sans doute chez les Gentils, 6c fondées sur
la mythologie ; par exemple , ces anciens profanes croioient que les
âmes des défunts se rendoient aux portes de l’enfer, où elles payoienc
un tribut pour encrer dans le manoir de Pluton : 6c comme ce lieu étoit
îiostrum, non modo cum Augusti sæculo
concertare ; sed etiam cum ssorentissimis
illis reipublicæ Athenieniis temporibus.
Hæc omnia nobis ex veteribus illis simu-
lacrorum cultoribus accessere : cumque illi
religiones luas passim admiseerent : utrius-
que linguæ seripta Græcæ nimirum acLa-
linæ deorum mythologia ubique exornam
tur a cujusvis generis seriptoribus.
Dixeris fortasse hæc mythologica orna-*
menta extera prorsus esse , neque ad res ip-
sas pertinere. Verum diseiplinæ nonnili
cum hisce ornamentis ad nos transmissæ
sunt,quæ ornamenta, nimirum mytholo-
gicæ didiones, narrationesque per omnia
serme Europae idiomata immissæ sunt; Ju-
piter , Minerva , Mercurius t Hercules ,
Mars, Bacchus, Chimæra ipsa passim pro-
feruntur. Vin’ Græcam addiseere linguam ?
legas oportet seriptores Græcos optimos
quoique , quorum nullus ell quin theogo-^
&iam veteresque sabulas afferat in medium.
Vin’ limate seribendi Latine consuetudi-
nem adipisei ? Id frustra tentes, nili assidue
legas veteres illos Latinæ linguæ magistros,
& fabulis & theologia illa profana res-
persos.
Si veterum Patrum Irenæi, Clementis
Alexandrini, Tertulliani seripta perlegas ?
totam illi deorum genealogiam frequenter
exhibent 2 id quod etiam in sequenti ævo
videre est apud Athanasium libro contra
Gentes, Gregorium NazianZenum in Ora-
tionibus non paucis y Joannem Chrysoflzo-
mum de Babyla & alibi. Quod autem ad
Augustinum spedat , totam ille mytholo-
giam pluribus tradat hiftoriamque profa-
nam , in libris nempe de Civitate Dei.
Ne sacros quidem libros iis vacuos re-*
perimus, ibi enim loquendi genera occur-
runt in profana illa religione nata, inque
mythologia fundata ÿ exempli causa veteres
illi putabant desunctorum animas inferi
ssatim portas adire 3 & naulum solvere ut
abhorw