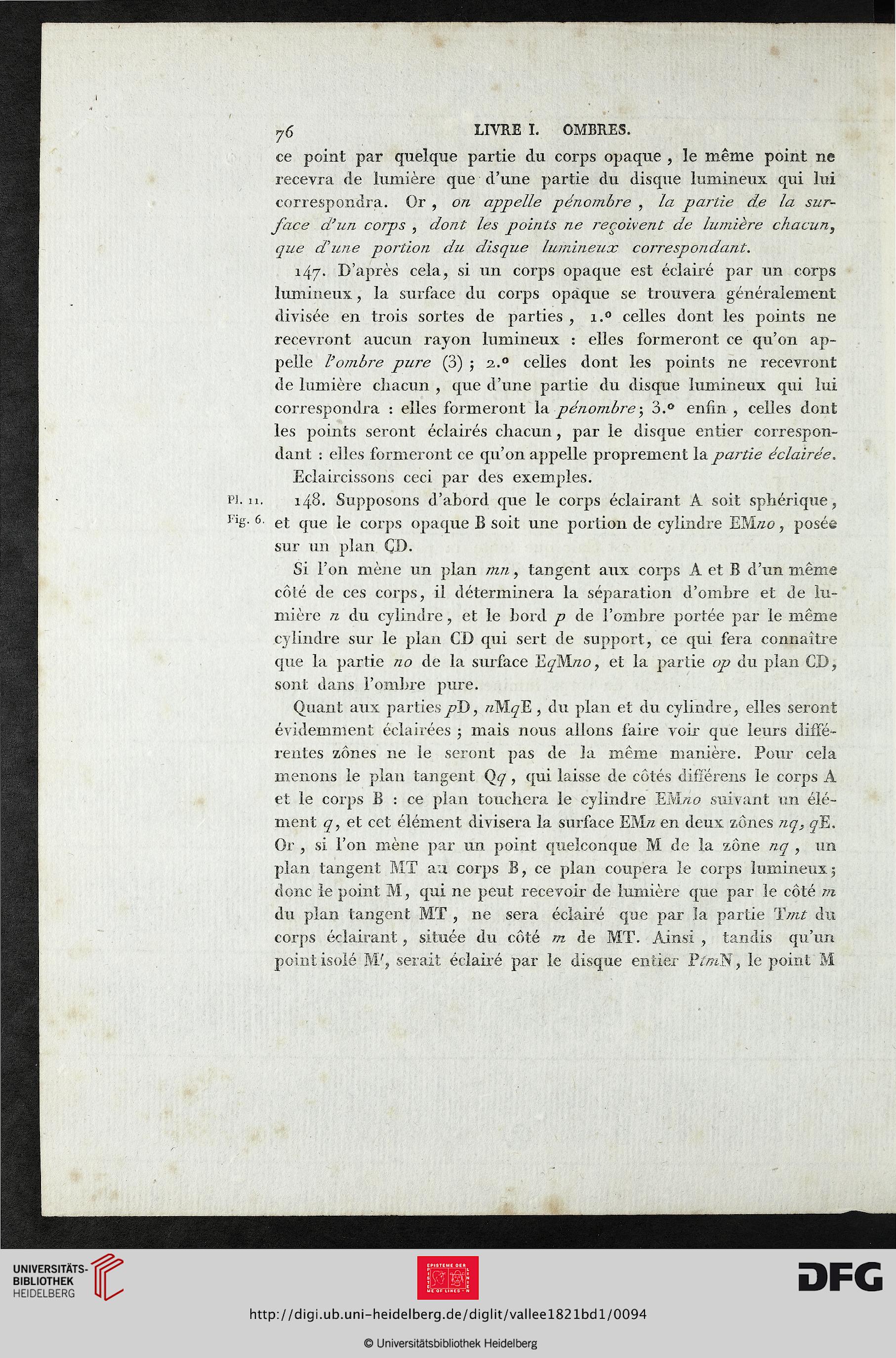?6 LIVRE I. OMBRES.
ce point par quelque partie du corps opaque , le même point ne
recevra de lumière que d'une partie du disque lumineux qui lui
correspondra. Or , on appelle pénombre , la partie de la sur-
face d'un corps , dont les points ne reçoivent de lumière chacun^
que d'une portion du disque lumineux correspondant.
147. D'après cela, si un corps opaque est éclairé par un corps
lumineux, la surface du corps opaque se trouvera généralement
divisée en trois sortes de parties , i.° celles dont les points ne
recevront aucun rayon lumineux : elles formeront ce qu'on ap-
pelle l'ombre pure (3) ; i.° celles dont les points ne recevront
de lumière chacun , que d'une partie du disque lumineux qui lui
correspondra : elles formeront la pénombre -7 3.° enfin , celles dont
les points seront éclairés chacun, par le disque entier correspon-
dant : elles formeront ce qu'on appelle proprement la partie éclairée.
Eciaircissons ceci par des exemples.
Pl. 11. 148. Supposons d'abord que le corps éclairant À soit sphérique,
Vlë- 6 et que le corps opaque B soit une portion de cylindre EMv/o, posée
sur un plan ÇD.
Si l'on mène un plan nui, tangent aux corps A et B d'un même
côlé de ces corps, il déterminera la séparation d'ombre et de lu-
mière 71 du cylindre, et le bord p de l'ombre portée par le même
cylindre sur le plan CD qui sert de support, ce qui fera connaître
que la partie no de la surface EqM.no, et la partie op du pian CD,
sont dans l'ombre pure.
Quant aux partiespD, //M^E , du plan et du cylindre, elles seront
évidemment éclairées ; mais nous allons faire voir que leurs diffé-
rentes zones ne le seront pas de la même manière. Pour cela
menons le plan tangent Qq , qui laisse de côtés diflerens le corps A
et le corps B : ce plan touchera le cylindre EM/zo suivant un élé-
ment q, et cet élément divisera la surface EM/z en deux zones nq, qE.
Or , si l'on mène par un point quelconque M de la zone nq , un
plan tangent MT au corps B, ce plan coupera le corps lumineux ;
donc le point M, qui ne peut recevoir de lumière que par le côté m
du plan tangent MT , ne sera éclairé que par la partie Tmt du
corps éclairant, située du côté m de MT. Ainsi , tandis qu'un
point isolé M;? serait éclairé par le disque entier Ftm'N, le point M
ce point par quelque partie du corps opaque , le même point ne
recevra de lumière que d'une partie du disque lumineux qui lui
correspondra. Or , on appelle pénombre , la partie de la sur-
face d'un corps , dont les points ne reçoivent de lumière chacun^
que d'une portion du disque lumineux correspondant.
147. D'après cela, si un corps opaque est éclairé par un corps
lumineux, la surface du corps opaque se trouvera généralement
divisée en trois sortes de parties , i.° celles dont les points ne
recevront aucun rayon lumineux : elles formeront ce qu'on ap-
pelle l'ombre pure (3) ; i.° celles dont les points ne recevront
de lumière chacun , que d'une partie du disque lumineux qui lui
correspondra : elles formeront la pénombre -7 3.° enfin , celles dont
les points seront éclairés chacun, par le disque entier correspon-
dant : elles formeront ce qu'on appelle proprement la partie éclairée.
Eciaircissons ceci par des exemples.
Pl. 11. 148. Supposons d'abord que le corps éclairant À soit sphérique,
Vlë- 6 et que le corps opaque B soit une portion de cylindre EMv/o, posée
sur un plan ÇD.
Si l'on mène un plan nui, tangent aux corps A et B d'un même
côlé de ces corps, il déterminera la séparation d'ombre et de lu-
mière 71 du cylindre, et le bord p de l'ombre portée par le même
cylindre sur le plan CD qui sert de support, ce qui fera connaître
que la partie no de la surface EqM.no, et la partie op du pian CD,
sont dans l'ombre pure.
Quant aux partiespD, //M^E , du plan et du cylindre, elles seront
évidemment éclairées ; mais nous allons faire voir que leurs diffé-
rentes zones ne le seront pas de la même manière. Pour cela
menons le plan tangent Qq , qui laisse de côtés diflerens le corps A
et le corps B : ce plan touchera le cylindre EM/zo suivant un élé-
ment q, et cet élément divisera la surface EM/z en deux zones nq, qE.
Or , si l'on mène par un point quelconque M de la zone nq , un
plan tangent MT au corps B, ce plan coupera le corps lumineux ;
donc le point M, qui ne peut recevoir de lumière que par le côté m
du plan tangent MT , ne sera éclairé que par la partie Tmt du
corps éclairant, située du côté m de MT. Ainsi , tandis qu'un
point isolé M;? serait éclairé par le disque entier Ftm'N, le point M