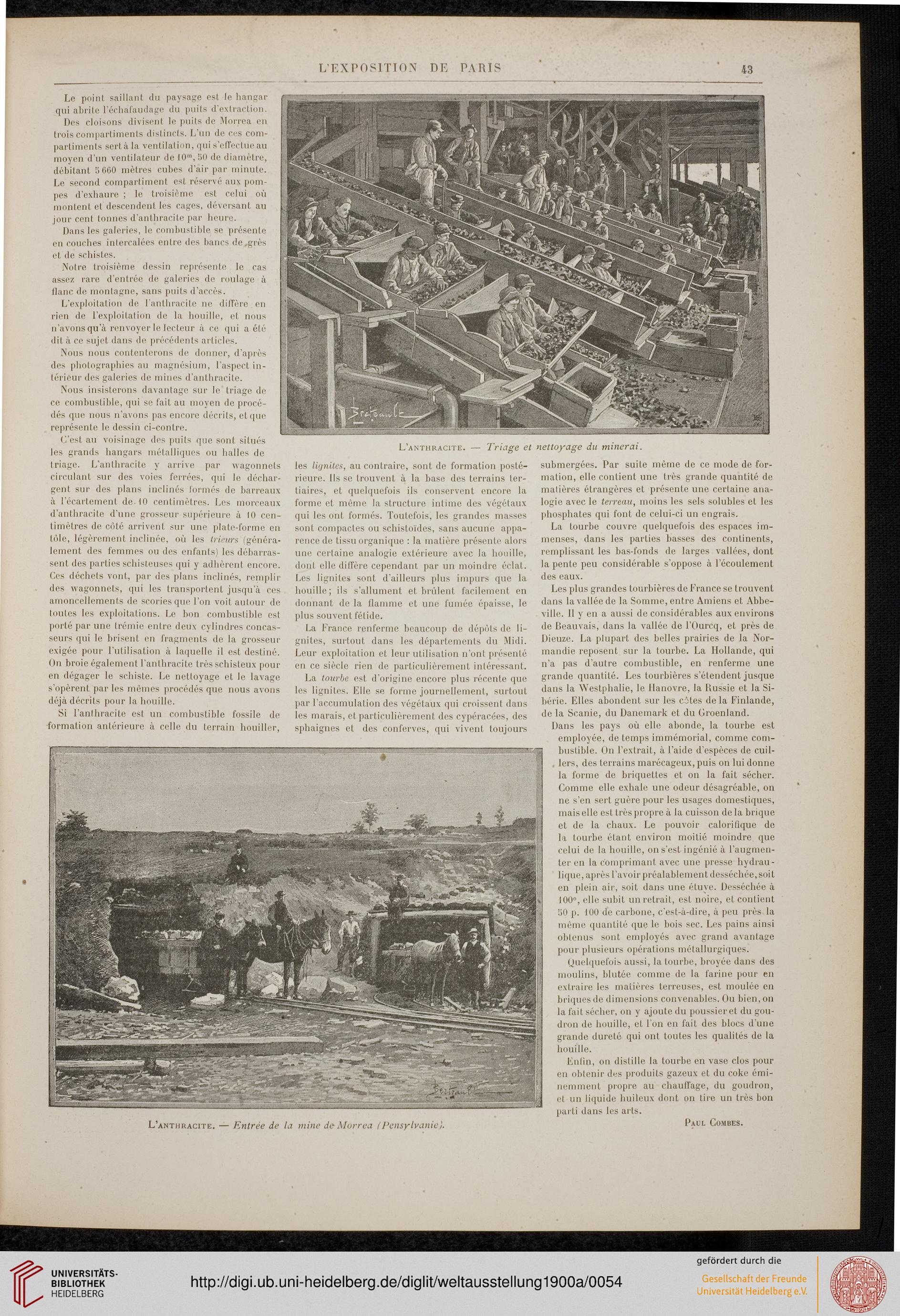L'EXPOSITION DE PARIS
43
Le point saillant du paysage est le hangar
qui abrite l'échafaudage du puits d'extraction.
Des cloisons divisent le puits de Morrea en
trois compartiments distincts. L'un de ces com-
partiments sert à la ventilation, qui s'effectue au
moyen d'un ventilateur de 10"\ 50 de diamètre,
débitant 8 660 mètres cubes d'air par minute.
Le second compartiment est réservé aux pom-
pes d'exhaure ; le troisième est celui où
montent et descendent les cages, déversant au
jour cent tonnes d'anthracite par heure..
Dans les galeries, le combustible se présente
en couches intercalées entre des bancs de grès
et de schistes.
Notre, troisième dessin représente le cas
assez rare d'entrée de galeries de roulage à
flanc de montagne, sans puits d'accès.
L'exploitation de l'anthracite ne diffère en
rien de l'exploitation de la houille, et nous
n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce qui a été
dit à ce sujet dans de précédents articles.
Nous nous contenterons de donner, d'après
des photographies au magnésium, l'aspect in-
térieur des galeries de mines d'anthracite.
Nous insisterons davantage sur le triage de
ce combustible, qui se fait au moyen de procé-
dés que nous n'avons pas encore décrits, et que
représente le dessin ci-contre.
C'est au voisinage des puits que sont situés
les grands hangars métalliques ou halles de
triage. L'anthracite y arrive par wagonnets
circulant sur des voies ferrées, qui le déchar-
gent sur des plans inclinés formés de barreaux
à l'écartement de-10 centimètres. Les morceaux
d'anthracite d'une grosseur supérieure à 10 cen-
timètres de côté arrivent sur une plate-forme en
tôle, légèrement inclinée, où les trieurs (généra-
lement des femmes ou des enfants) les débarras-
sent des parties schisteuses qui y adhèrent encore.
Ces déchets vont, par des plans inclinés, remplir
des wagonnets, qui les transportent jusqu'à ces
amoncellements de scories que l'on voit autour de
toutes les exploitations. Le bon combustible est
porté par une trémie entre deux cylindres concas-
seurs qui le brisent en fragments de la grosseur
exigée pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
On broie également l'anthracite très schisteux pour
en dégager le schiste. Le nettoyage et le lavage
s'opèrent par les mêmes procédés que nous avons
déjà décrits pour la houille.
Si l'anthracite est un combustible fossile de
formation antérieure à celle du terrain houiller,
L'anthracite. — Triage et
les lignites, au contraire, sont de formation posté-
rieure. Ils se trouvent à la base des terrains ter-
tiaires, et quelquefois ils conservent encore la
forme et même la structure intime des végétaux
qui les ont formés. Toutefois, les grandes masses
sont compactes ou schistoïdes, sans aucune appa-
rence de tissu organique : la matière présente alors
une certaine analogie extérieure avec la houille,
dont elle diffère cependant par un moindre éclat.
Les lignites sont d'ailleurs plus impurs que la
houille; ils s'allument et brûlent facilement en
donnant de la flamme et une fumée épaisse, le
plus souvent fétide.
La France renferme beaucoup de dépôts de li-
gnites, surtout dans les départements du Midi.
Leur exploitation et leur utilisation n'ont présenté
en ce siècle rien de particulièrement intéressant.
La tourbe est d'origine encore plus récente que
les lignites. Elle se forme journellement, surtout
par l'accumulation des végétaux qui croissent dans
les marais, et particulièrement des cypéracées, des
sphaignes et des conferves, qui vivent toujours
-------------------_
L'anthracite. — Entrée de la mine de Morrea (Pensylvanic',.
nettoyage du minerai.
submergées. Par suite même de ce mode de for-
mation, elle contient une très grande quantité de
matières étrangères et présente une certaine ana-
logie avec le terreau, moins les sels solubles et les
phosphates qui font de celui-ci un engrais.
La tourbe couvre quelquefois des espaces im-
menses, dans les parties basses des continents,
remplissant les bas-fonds de larges vallées, dont
la pente peu considérable s'oppose à l'écoulement
des eaux.
Les plus grandes tourbières de France se trouvent
dans la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbe-
ville. Il y en a aussi de considérables aux environs
de Beauvais, dans la vallée de l'Ourcq, et près de
Dieuze. La plupart des belles prairies de la Nor-
mandie reposent sur la tourbe. La Hollande, qui
n'a pas d'autre combustible, en renferme une
grande quantité. Les tourbières s'étendent jusque
dans la Westphalie, le Hanovre, la Russie et la Si-
bérie. Elles abondent sur les côtes de la Finlande,
de la Scanie, du Danemark et du Croenland.
Dans les pays où elle abonde, la tourbe est
employée, de temps immémorial, comme com-
bustible. On l'extrait, à l'aide d'espèces de cuil-
. 1ers, des terrains marécageux, puis on lui donne
la forme de briquettes et on la fait sécher.
Comme elle exhale une odeur désagréable, on
ne s'en sert guère pour les usages domestiques,
mais elle est très propre à la cuisson de la brique
et de la chaux. Le pouvoir calorifique de
la tourbe étant environ moitié moindre que
celui de la houille, on s'est ingénié à l'augmen-
ter en la comprimant avec une presse hydrau-
lique, après l'avoir préalablement desséchée, soit
en plein air, soit dans une étuve. Desséchée à
100°, elle subit un retrait, est noire, et contient
50 p. 100 de carbone, c'est-à-dire, à peu près la
môme quantité que le bois sec. Les pains ainsi
obtenus sont employés avec grand avantage
pour plusieurs opérations métallurgiques.
Quelquefois aussi, la tourbe, broyée dans des
moulins, blutée comme de la farine pour en
extraire les maiières terreuses, est moulée en
briques de dimensions convenables. Ou bien, on
la fait sécher, on y ajoute du poussier et du gou-
dron de houille, et l'on en fait des blocs d'une
grande dureté qui ont toutes les qualités de la
houille.
Enlin, on distille la tourbe en vase clos pour
en obtenir des produits gazeux et du coke émi-
nemment propre au chauffage, du goudron,
et un liquide huileux dont on tire un très bon
parti dans les arts.
Paul Combes.
43
Le point saillant du paysage est le hangar
qui abrite l'échafaudage du puits d'extraction.
Des cloisons divisent le puits de Morrea en
trois compartiments distincts. L'un de ces com-
partiments sert à la ventilation, qui s'effectue au
moyen d'un ventilateur de 10"\ 50 de diamètre,
débitant 8 660 mètres cubes d'air par minute.
Le second compartiment est réservé aux pom-
pes d'exhaure ; le troisième est celui où
montent et descendent les cages, déversant au
jour cent tonnes d'anthracite par heure..
Dans les galeries, le combustible se présente
en couches intercalées entre des bancs de grès
et de schistes.
Notre, troisième dessin représente le cas
assez rare d'entrée de galeries de roulage à
flanc de montagne, sans puits d'accès.
L'exploitation de l'anthracite ne diffère en
rien de l'exploitation de la houille, et nous
n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce qui a été
dit à ce sujet dans de précédents articles.
Nous nous contenterons de donner, d'après
des photographies au magnésium, l'aspect in-
térieur des galeries de mines d'anthracite.
Nous insisterons davantage sur le triage de
ce combustible, qui se fait au moyen de procé-
dés que nous n'avons pas encore décrits, et que
représente le dessin ci-contre.
C'est au voisinage des puits que sont situés
les grands hangars métalliques ou halles de
triage. L'anthracite y arrive par wagonnets
circulant sur des voies ferrées, qui le déchar-
gent sur des plans inclinés formés de barreaux
à l'écartement de-10 centimètres. Les morceaux
d'anthracite d'une grosseur supérieure à 10 cen-
timètres de côté arrivent sur une plate-forme en
tôle, légèrement inclinée, où les trieurs (généra-
lement des femmes ou des enfants) les débarras-
sent des parties schisteuses qui y adhèrent encore.
Ces déchets vont, par des plans inclinés, remplir
des wagonnets, qui les transportent jusqu'à ces
amoncellements de scories que l'on voit autour de
toutes les exploitations. Le bon combustible est
porté par une trémie entre deux cylindres concas-
seurs qui le brisent en fragments de la grosseur
exigée pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
On broie également l'anthracite très schisteux pour
en dégager le schiste. Le nettoyage et le lavage
s'opèrent par les mêmes procédés que nous avons
déjà décrits pour la houille.
Si l'anthracite est un combustible fossile de
formation antérieure à celle du terrain houiller,
L'anthracite. — Triage et
les lignites, au contraire, sont de formation posté-
rieure. Ils se trouvent à la base des terrains ter-
tiaires, et quelquefois ils conservent encore la
forme et même la structure intime des végétaux
qui les ont formés. Toutefois, les grandes masses
sont compactes ou schistoïdes, sans aucune appa-
rence de tissu organique : la matière présente alors
une certaine analogie extérieure avec la houille,
dont elle diffère cependant par un moindre éclat.
Les lignites sont d'ailleurs plus impurs que la
houille; ils s'allument et brûlent facilement en
donnant de la flamme et une fumée épaisse, le
plus souvent fétide.
La France renferme beaucoup de dépôts de li-
gnites, surtout dans les départements du Midi.
Leur exploitation et leur utilisation n'ont présenté
en ce siècle rien de particulièrement intéressant.
La tourbe est d'origine encore plus récente que
les lignites. Elle se forme journellement, surtout
par l'accumulation des végétaux qui croissent dans
les marais, et particulièrement des cypéracées, des
sphaignes et des conferves, qui vivent toujours
-------------------_
L'anthracite. — Entrée de la mine de Morrea (Pensylvanic',.
nettoyage du minerai.
submergées. Par suite même de ce mode de for-
mation, elle contient une très grande quantité de
matières étrangères et présente une certaine ana-
logie avec le terreau, moins les sels solubles et les
phosphates qui font de celui-ci un engrais.
La tourbe couvre quelquefois des espaces im-
menses, dans les parties basses des continents,
remplissant les bas-fonds de larges vallées, dont
la pente peu considérable s'oppose à l'écoulement
des eaux.
Les plus grandes tourbières de France se trouvent
dans la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbe-
ville. Il y en a aussi de considérables aux environs
de Beauvais, dans la vallée de l'Ourcq, et près de
Dieuze. La plupart des belles prairies de la Nor-
mandie reposent sur la tourbe. La Hollande, qui
n'a pas d'autre combustible, en renferme une
grande quantité. Les tourbières s'étendent jusque
dans la Westphalie, le Hanovre, la Russie et la Si-
bérie. Elles abondent sur les côtes de la Finlande,
de la Scanie, du Danemark et du Croenland.
Dans les pays où elle abonde, la tourbe est
employée, de temps immémorial, comme com-
bustible. On l'extrait, à l'aide d'espèces de cuil-
. 1ers, des terrains marécageux, puis on lui donne
la forme de briquettes et on la fait sécher.
Comme elle exhale une odeur désagréable, on
ne s'en sert guère pour les usages domestiques,
mais elle est très propre à la cuisson de la brique
et de la chaux. Le pouvoir calorifique de
la tourbe étant environ moitié moindre que
celui de la houille, on s'est ingénié à l'augmen-
ter en la comprimant avec une presse hydrau-
lique, après l'avoir préalablement desséchée, soit
en plein air, soit dans une étuve. Desséchée à
100°, elle subit un retrait, est noire, et contient
50 p. 100 de carbone, c'est-à-dire, à peu près la
môme quantité que le bois sec. Les pains ainsi
obtenus sont employés avec grand avantage
pour plusieurs opérations métallurgiques.
Quelquefois aussi, la tourbe, broyée dans des
moulins, blutée comme de la farine pour en
extraire les maiières terreuses, est moulée en
briques de dimensions convenables. Ou bien, on
la fait sécher, on y ajoute du poussier et du gou-
dron de houille, et l'on en fait des blocs d'une
grande dureté qui ont toutes les qualités de la
houille.
Enlin, on distille la tourbe en vase clos pour
en obtenir des produits gazeux et du coke émi-
nemment propre au chauffage, du goudron,
et un liquide huileux dont on tire un très bon
parti dans les arts.
Paul Combes.