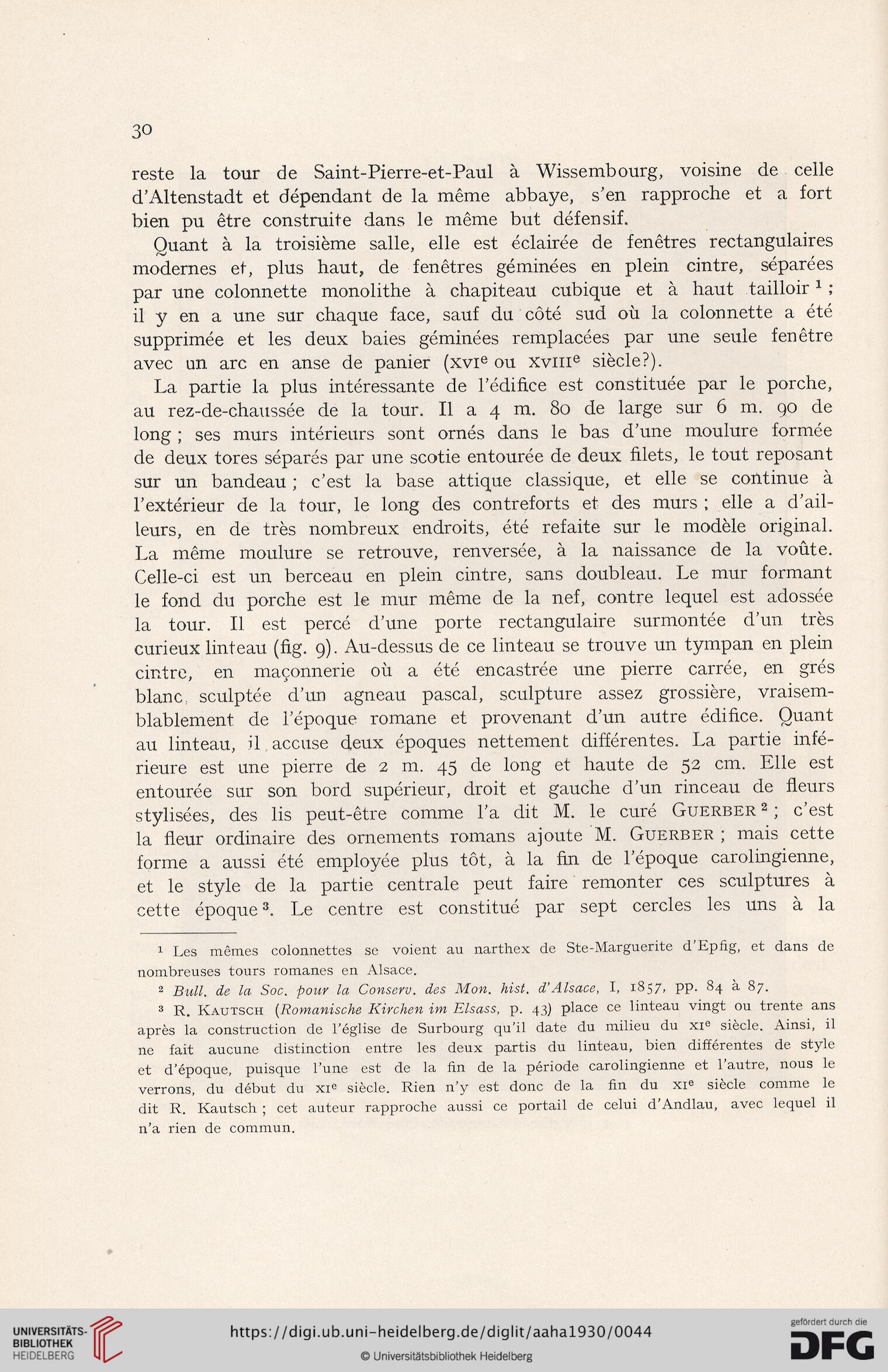30
reste la tour de Saint-Pierre-et-Paul à Wissembourg, voisine de celle
d’Altenstadt et dépendant de la même abbaye, s’en rapproche et a fort
bien pu être construite dans le même but défensif.
Quant à la troisième salle, elle est éclairée de fenêtres rectangulaires
modernes et, plus haut, de fenêtres géminées en plein cintre, séparées
par une colonnette monolithe à chapiteau cubique et à haut tailloir1 ;
il y en a une sur chaque face, sauf du côté sud où la colonnette a été
supprimée et les deux baies géminées remplacées par une seule fenêtre
avec un arc en anse de panier (xvie ou xviue siècle?).
La partie la plus intéressante de l’édifice est constituée par le porche,
au rez-de-chaussée de la tour. Il a 4 m. 80 de large sur 6 m. 90 de
long ; ses murs intérieurs sont ornés dans le bas d’une moulure formée
de deux tores séparés par une scotie entourée de deux filets, le tout reposant
sur un bandeau ; c’est la base attique classique, et elle se continue à
l’extérieur de la tour, le long des contreforts et des murs ; elle a d’ail-
leurs, en de très nombreux endroits, été refaite sur le modèle original.
La même moulure se retrouve, renversée, à la naissance de la voûte.
Celle-ci est un berceau en plein cintre, sans doubleau. Le mur formant
le fond du porche est le mur même de la nef, contre lequel est adossée
la tour. Il est percé d’une porte rectangulaire surmontée d’un très
curieux linteau (fig. 9). Au-dessus de ce linteau se trouve un tympan en plein
cintre, en maçonnerie où a été encastrée une pierre carrée, en grés
blanc, sculptée d’un agneau pascal, sculpture assez grossière, vraisem-
blablement de l’époque romane et provenant d’un autre édifice. Quant
au linteau, il accuse deux époques nettement différentes. La partie infé-
rieure est une pierre de 2 m. 45 de long et haute de 52 cm. Elle est
entourée sur son bord supérieur, droit et gauche d’un rinceau de fleurs
stylisées, des lis peut-être comme l’a dit M. le curé Guerber 2 ; c’est
la fleur ordinaire des ornements romans ajoute M. Guerber ; mais cette
forme a aussi été employée plus tôt, à la fin de l’époque carolingienne,
et le style de la partie centrale peut faire remonter ces sculptures à
cette époque3. Le centre est constitué par sept cercles les uns à la
1 Les mêmes colonnettes se voient au narthex de Ste-Marguerite d’Epfig, et dans de
nombreuses tours romanes en Alsace.
2 Bull, de la Soc. pour la Conserv. des Mon. hist. d’Alsace, I, 1857, pp. 84 à 87.
3 R. Kautsch (Romanische Kirchen im Elsass, p. 43) place ce linteau vingt ou trente ans
après la construction de l’église de Surbourg qu’il date du milieu du xie siècle. Ainsi, il
ne fait aucune distinction entre les deux partis du linteau, bien différentes de style
et d’époque, puisque l’une est de la fin de la période carolingienne et l’autre, nous le
verrons, du début du xie siècle. Rien n’y est donc de la fin du XIe siècle comme le
dit R. Kautsch ; cet auteur rapproche aussi ce portail de celui d’Andlau, avec lequel il
n’a rien de commun.
reste la tour de Saint-Pierre-et-Paul à Wissembourg, voisine de celle
d’Altenstadt et dépendant de la même abbaye, s’en rapproche et a fort
bien pu être construite dans le même but défensif.
Quant à la troisième salle, elle est éclairée de fenêtres rectangulaires
modernes et, plus haut, de fenêtres géminées en plein cintre, séparées
par une colonnette monolithe à chapiteau cubique et à haut tailloir1 ;
il y en a une sur chaque face, sauf du côté sud où la colonnette a été
supprimée et les deux baies géminées remplacées par une seule fenêtre
avec un arc en anse de panier (xvie ou xviue siècle?).
La partie la plus intéressante de l’édifice est constituée par le porche,
au rez-de-chaussée de la tour. Il a 4 m. 80 de large sur 6 m. 90 de
long ; ses murs intérieurs sont ornés dans le bas d’une moulure formée
de deux tores séparés par une scotie entourée de deux filets, le tout reposant
sur un bandeau ; c’est la base attique classique, et elle se continue à
l’extérieur de la tour, le long des contreforts et des murs ; elle a d’ail-
leurs, en de très nombreux endroits, été refaite sur le modèle original.
La même moulure se retrouve, renversée, à la naissance de la voûte.
Celle-ci est un berceau en plein cintre, sans doubleau. Le mur formant
le fond du porche est le mur même de la nef, contre lequel est adossée
la tour. Il est percé d’une porte rectangulaire surmontée d’un très
curieux linteau (fig. 9). Au-dessus de ce linteau se trouve un tympan en plein
cintre, en maçonnerie où a été encastrée une pierre carrée, en grés
blanc, sculptée d’un agneau pascal, sculpture assez grossière, vraisem-
blablement de l’époque romane et provenant d’un autre édifice. Quant
au linteau, il accuse deux époques nettement différentes. La partie infé-
rieure est une pierre de 2 m. 45 de long et haute de 52 cm. Elle est
entourée sur son bord supérieur, droit et gauche d’un rinceau de fleurs
stylisées, des lis peut-être comme l’a dit M. le curé Guerber 2 ; c’est
la fleur ordinaire des ornements romans ajoute M. Guerber ; mais cette
forme a aussi été employée plus tôt, à la fin de l’époque carolingienne,
et le style de la partie centrale peut faire remonter ces sculptures à
cette époque3. Le centre est constitué par sept cercles les uns à la
1 Les mêmes colonnettes se voient au narthex de Ste-Marguerite d’Epfig, et dans de
nombreuses tours romanes en Alsace.
2 Bull, de la Soc. pour la Conserv. des Mon. hist. d’Alsace, I, 1857, pp. 84 à 87.
3 R. Kautsch (Romanische Kirchen im Elsass, p. 43) place ce linteau vingt ou trente ans
après la construction de l’église de Surbourg qu’il date du milieu du xie siècle. Ainsi, il
ne fait aucune distinction entre les deux partis du linteau, bien différentes de style
et d’époque, puisque l’une est de la fin de la période carolingienne et l’autre, nous le
verrons, du début du xie siècle. Rien n’y est donc de la fin du XIe siècle comme le
dit R. Kautsch ; cet auteur rapproche aussi ce portail de celui d’Andlau, avec lequel il
n’a rien de commun.