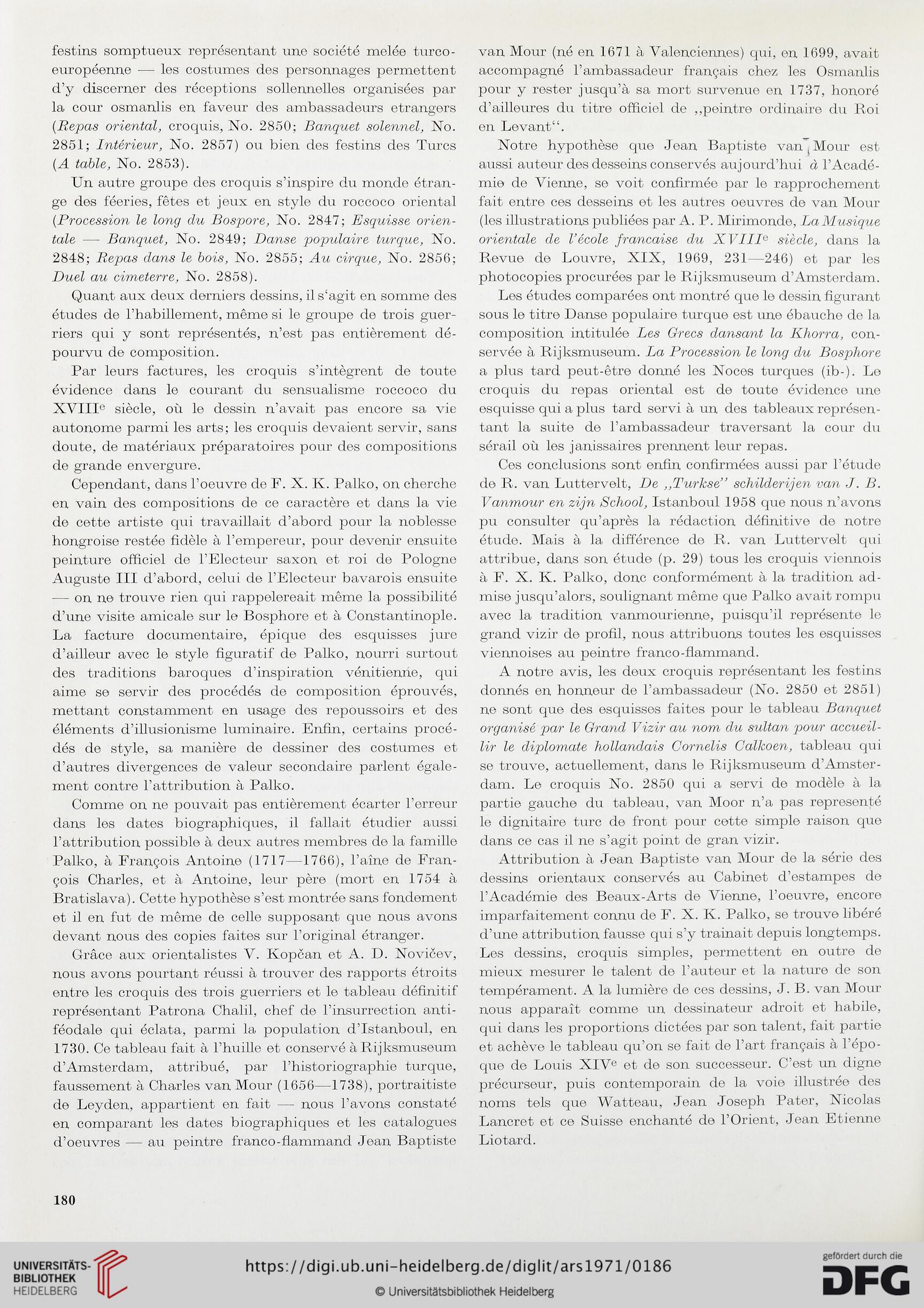festins somptueux représentant une société melée turco-
européenne -—■ les costumes des personnages permettent
d’y discerner des réceptions sollennelles organisées par
la cour osmanlis en faveur des ambassadeurs etrangers
(Repas oriental, croquis, No. 2850; Banquet solennel, No.
2851; Intérieur, No. 2857) ou bien des festins des Turcs
(A table, No. 2853).
Un autre groupe des croquis s’inspire du monde étran-
ge des féeries, fêtes et jeux en style du roccoco oriental
(Procession le long du Bospore, No. 2847; Esquisse orien-
tale — Banquet, No. 2849; Danse populaire turque, No.
2848; Repas dans le bois, No. 2855; Au cirque, No. 2856;
Duel au cimeterre, No. 2858).
Quant aux deux derniers dessins, il s'agit en somme des
études de l’habillement, même si le groupe de trois guer-
riers qui y sont représentés, n’est pas entièrement dé-
pourvu de composition.
Par leurs factures, les croquis s’intégrent de toute
évidence dans le courant du sensualisme roccoco du
XVIIIe siècle, où le dessin n’avait pas encore sa vie
autonome parmi les arts; les croquis devaient servir, sans
doute, de matériaux préparatoires pour des compositions
de grande envergure.
Cependant, dans l’oeuvre de F. X. K. Palko, on cherche
en vain des compositions de ce caractère et dans la vie
de cette artiste qui travaillait d’abord pour la noblesse
hongroise restée fidèle à l’empereur, pour devenir ensuite
peinture officiel de l’Electeur saxon et roi de Pologne
Auguste III d’abord, celui de l’Electeur bavarois ensuite
— on ne trouve rien qui rappelereait même la possibilité
d’une visite amicale sur le Bosphore et à Constantinople.
La facture documentaire, épique des esquisses jure
d’ailleur avec le style figuratif de Palko, nourri surtout
des traditions baroques d’inspiration vénitienne, qui
aime se servir des procédés de composition éprouvés,
mettant constamment en usage des repoussoirs et des
éléments d’illusionisme luminaire. Enfin, certains procé-
dés de style, sa manière de dessiner des costumes et
d’autres divergences de valeur secondaire parlent égale-
ment contre l’attribution à Palko.
Comme on ne pouvait pas entièrement écarter l’erreur
dans les dates biographiques, il fallait étudier aussi
l’attribution possible à deux autres membres de la famille
Palko, à François Antoine (1717—1766), l’aîne de Fran-
çois Charles, et à Antoine, leur père (mort en 1754 à
Bratislava). Cette hypothèse s’est montrée sans fondement
et il en fut de même de celle supposant que nous avons
devant nous des copies faites sur l’original étranger.
Grâce aux orientalistes V. Kopčan et A. D. Novičev,
nous avons pourtant réussi à trouver des rapports étroits
entre les croquis des trois guerriers et le tableau définitif
représentant Patrona Chalil, chef de l’insurrection anti-
féodale qui éclata, parmi la population d’Istanboul, en
1730. Ce tableau fait à l’huille et conservé à Rijksmuseum
d’Amsterdam, attribué, par l’historiographie turque,
faussement à Charles van Mour (1656—1738), portraitiste
de Leyden, appartient en fait — nous l’avons constaté
en comparant les dates biographiques et les catalogues
d’oeuvres — au peintre franco-flammand Jean Baptiste
van Mour (né en 1671 à Valenciennes) qui, en 1699, avait
accompagné l’ambassadeur français chez les Osmanlis
pour y rester jusqu’à sa mort survenue en 1737, honoré
d’ailleures du titre officiel de „peintre ordinaire du Roi
en Levant".
Notre hypothèse que Jean Baptiste van'Mour est
aussi auteur des desseins conservés aujourd’hui à Г Acadé-
mie de Vienne, se voit confirmée par le rapprochement
fait entre ces desseins et les autres oeuvres de van Mour
(les illustrations publiées par A. P. Mirimonde, La Musique
orientale de l’école française du XVIIIe siècle, dans la
Revue de Louvre, XIX, 1969, 231—246) et par les
photocopies procurées par le Rijksmuseum d’Amsterdam.
Les études comparées ont montré que le dessin figurant
sous le titre Danse populaire turque est une ébauche de la
composition intitulée Les Grecs dansant la Klwrra, con-
servée à Rijksmuseum. La Procession le long du Bosphore
a plus tard peut-être donné les Noces turques (ib-). Le
croquis du repas oriental est de toute évidence une
esquisse qui a plus tard servi à un des tableaux représen-
tant la suite de l’ambassadeur traversant la cour du
sérail où les janissaires prennent leur repas.
Ces conclusions sont enfin confirmées aussi par l’étude
de R. van Luttervelt, De ,,Turkse” schilderijen van J. B.
Vanmour en zijn School, Istanboul 1958 que nous n’avons
pu consulter qu’après la rédaction définitive de notre
étude. Mais à la différence de R. van Luttervelt qui
attribue, dans son étude (p. 29) tous les croquis viennois
à F. X. K. Palko, donc conformément à la tradition ad-
mise jusqu’alors, soulignant même que Palko avait rompu
avec la tradition vanmourienne, puisqu’il représente le
grand vizir de profil, nous attribuons toutes les esquisses
viennoises au peintre franco-flammand.
A notre avis, les deux croquis représentant les festins
donnés en honneur de l’ambassadeur (No. 2850 et 2851)
ne sont que des esquisses faites pour le tableau Banquet
organisé par le Grand Vizir au nom du sultan pour accueil-
lir le diplomate hollandais Cornelis Calkoen, tableau qui
se trouve, actuellement, dans le Rijksmuseum d’Amster-
dam. Le croquis No. 2850 qui a servi de modèle à la
partie gauche du tableau, van Moor n’a pas représenté
le dignitaire turc de front pour cette simple raison que
dans ce cas il ne s’agit point de gran vizir.
Attribution à Jean Baptiste van Mour de la série des
dessins orientaux conservés au Cabinet d’estampes de
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, l’oeuvre, encore
imparfaitement connu de F. X. K. Palko, se trouve libéré
d’une attribution fausse qui s’y tramait depuis longtemps.
Les dessins, croquis simples, permettent en outre de
mieux mesurer le talent de l’auteur et la nature de son
tempérament. A la lumière de ces dessins, J. B. van Mour
nous apparaît comme un dessinateur adroit et habile,
qui dans les proportions dictées par son talent, fait partie
et achève le tableau qu’on se fait de l’art français à l’épo-
que de Louis XIVe et de son successeur. C’est un digne
précurseur, puis contemporain de la voie illustrée des
noms tels que Watteau, Jean Joseph Pater, Nicolas
Lancret et ce Suisse enchanté de l’Orient, Jean Etienne
Liotard.
180
européenne -—■ les costumes des personnages permettent
d’y discerner des réceptions sollennelles organisées par
la cour osmanlis en faveur des ambassadeurs etrangers
(Repas oriental, croquis, No. 2850; Banquet solennel, No.
2851; Intérieur, No. 2857) ou bien des festins des Turcs
(A table, No. 2853).
Un autre groupe des croquis s’inspire du monde étran-
ge des féeries, fêtes et jeux en style du roccoco oriental
(Procession le long du Bospore, No. 2847; Esquisse orien-
tale — Banquet, No. 2849; Danse populaire turque, No.
2848; Repas dans le bois, No. 2855; Au cirque, No. 2856;
Duel au cimeterre, No. 2858).
Quant aux deux derniers dessins, il s'agit en somme des
études de l’habillement, même si le groupe de trois guer-
riers qui y sont représentés, n’est pas entièrement dé-
pourvu de composition.
Par leurs factures, les croquis s’intégrent de toute
évidence dans le courant du sensualisme roccoco du
XVIIIe siècle, où le dessin n’avait pas encore sa vie
autonome parmi les arts; les croquis devaient servir, sans
doute, de matériaux préparatoires pour des compositions
de grande envergure.
Cependant, dans l’oeuvre de F. X. K. Palko, on cherche
en vain des compositions de ce caractère et dans la vie
de cette artiste qui travaillait d’abord pour la noblesse
hongroise restée fidèle à l’empereur, pour devenir ensuite
peinture officiel de l’Electeur saxon et roi de Pologne
Auguste III d’abord, celui de l’Electeur bavarois ensuite
— on ne trouve rien qui rappelereait même la possibilité
d’une visite amicale sur le Bosphore et à Constantinople.
La facture documentaire, épique des esquisses jure
d’ailleur avec le style figuratif de Palko, nourri surtout
des traditions baroques d’inspiration vénitienne, qui
aime se servir des procédés de composition éprouvés,
mettant constamment en usage des repoussoirs et des
éléments d’illusionisme luminaire. Enfin, certains procé-
dés de style, sa manière de dessiner des costumes et
d’autres divergences de valeur secondaire parlent égale-
ment contre l’attribution à Palko.
Comme on ne pouvait pas entièrement écarter l’erreur
dans les dates biographiques, il fallait étudier aussi
l’attribution possible à deux autres membres de la famille
Palko, à François Antoine (1717—1766), l’aîne de Fran-
çois Charles, et à Antoine, leur père (mort en 1754 à
Bratislava). Cette hypothèse s’est montrée sans fondement
et il en fut de même de celle supposant que nous avons
devant nous des copies faites sur l’original étranger.
Grâce aux orientalistes V. Kopčan et A. D. Novičev,
nous avons pourtant réussi à trouver des rapports étroits
entre les croquis des trois guerriers et le tableau définitif
représentant Patrona Chalil, chef de l’insurrection anti-
féodale qui éclata, parmi la population d’Istanboul, en
1730. Ce tableau fait à l’huille et conservé à Rijksmuseum
d’Amsterdam, attribué, par l’historiographie turque,
faussement à Charles van Mour (1656—1738), portraitiste
de Leyden, appartient en fait — nous l’avons constaté
en comparant les dates biographiques et les catalogues
d’oeuvres — au peintre franco-flammand Jean Baptiste
van Mour (né en 1671 à Valenciennes) qui, en 1699, avait
accompagné l’ambassadeur français chez les Osmanlis
pour y rester jusqu’à sa mort survenue en 1737, honoré
d’ailleures du titre officiel de „peintre ordinaire du Roi
en Levant".
Notre hypothèse que Jean Baptiste van'Mour est
aussi auteur des desseins conservés aujourd’hui à Г Acadé-
mie de Vienne, se voit confirmée par le rapprochement
fait entre ces desseins et les autres oeuvres de van Mour
(les illustrations publiées par A. P. Mirimonde, La Musique
orientale de l’école française du XVIIIe siècle, dans la
Revue de Louvre, XIX, 1969, 231—246) et par les
photocopies procurées par le Rijksmuseum d’Amsterdam.
Les études comparées ont montré que le dessin figurant
sous le titre Danse populaire turque est une ébauche de la
composition intitulée Les Grecs dansant la Klwrra, con-
servée à Rijksmuseum. La Procession le long du Bosphore
a plus tard peut-être donné les Noces turques (ib-). Le
croquis du repas oriental est de toute évidence une
esquisse qui a plus tard servi à un des tableaux représen-
tant la suite de l’ambassadeur traversant la cour du
sérail où les janissaires prennent leur repas.
Ces conclusions sont enfin confirmées aussi par l’étude
de R. van Luttervelt, De ,,Turkse” schilderijen van J. B.
Vanmour en zijn School, Istanboul 1958 que nous n’avons
pu consulter qu’après la rédaction définitive de notre
étude. Mais à la différence de R. van Luttervelt qui
attribue, dans son étude (p. 29) tous les croquis viennois
à F. X. K. Palko, donc conformément à la tradition ad-
mise jusqu’alors, soulignant même que Palko avait rompu
avec la tradition vanmourienne, puisqu’il représente le
grand vizir de profil, nous attribuons toutes les esquisses
viennoises au peintre franco-flammand.
A notre avis, les deux croquis représentant les festins
donnés en honneur de l’ambassadeur (No. 2850 et 2851)
ne sont que des esquisses faites pour le tableau Banquet
organisé par le Grand Vizir au nom du sultan pour accueil-
lir le diplomate hollandais Cornelis Calkoen, tableau qui
se trouve, actuellement, dans le Rijksmuseum d’Amster-
dam. Le croquis No. 2850 qui a servi de modèle à la
partie gauche du tableau, van Moor n’a pas représenté
le dignitaire turc de front pour cette simple raison que
dans ce cas il ne s’agit point de gran vizir.
Attribution à Jean Baptiste van Mour de la série des
dessins orientaux conservés au Cabinet d’estampes de
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, l’oeuvre, encore
imparfaitement connu de F. X. K. Palko, se trouve libéré
d’une attribution fausse qui s’y tramait depuis longtemps.
Les dessins, croquis simples, permettent en outre de
mieux mesurer le talent de l’auteur et la nature de son
tempérament. A la lumière de ces dessins, J. B. van Mour
nous apparaît comme un dessinateur adroit et habile,
qui dans les proportions dictées par son talent, fait partie
et achève le tableau qu’on se fait de l’art français à l’épo-
que de Louis XIVe et de son successeur. C’est un digne
précurseur, puis contemporain de la voie illustrée des
noms tels que Watteau, Jean Joseph Pater, Nicolas
Lancret et ce Suisse enchanté de l’Orient, Jean Etienne
Liotard.
180