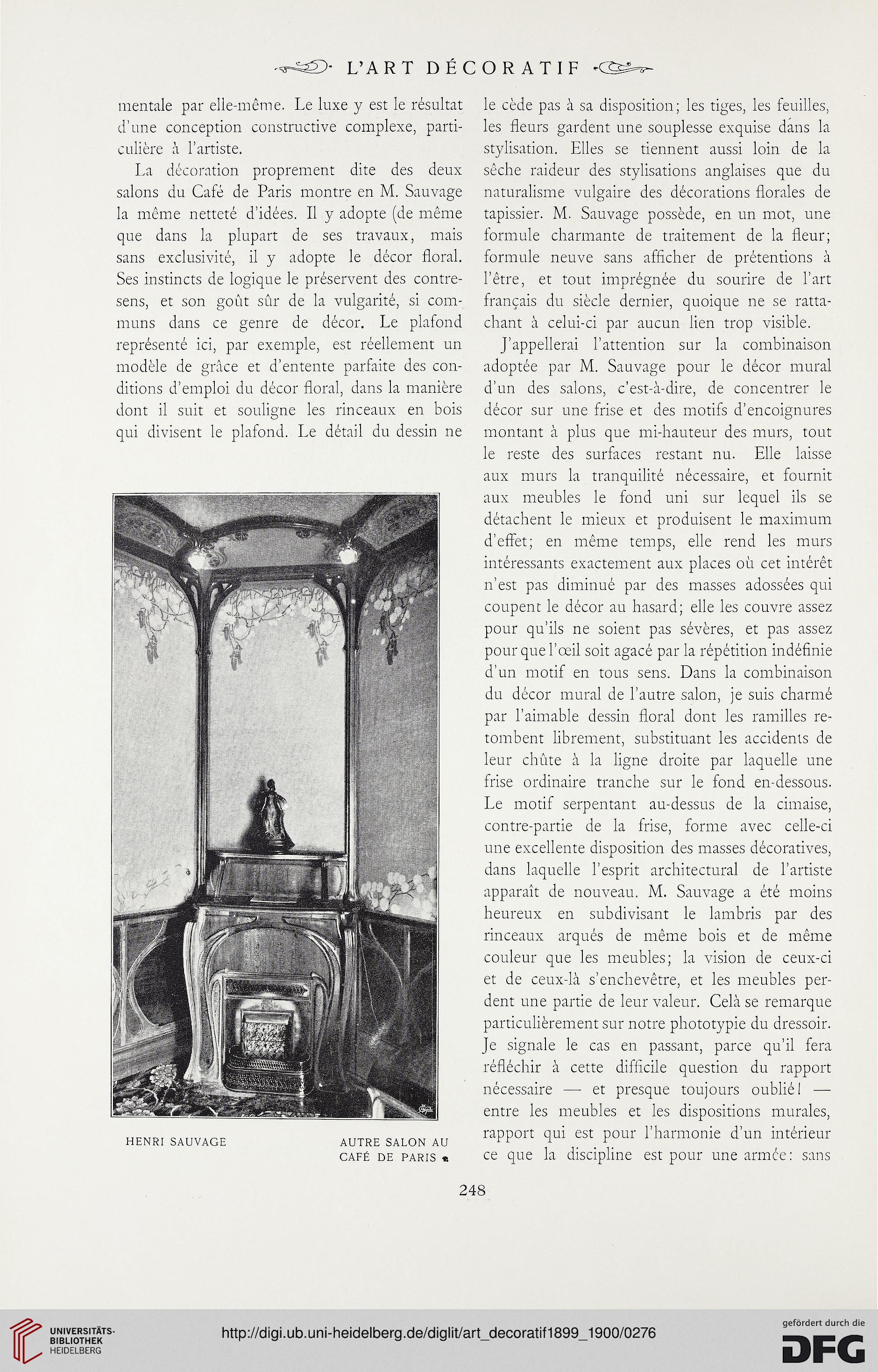L'ART DÉCORATIF
mentale par elle-même. Le luxe y est le résultat
d'une conception constructive complexe, parti-
culière à l'artiste.
La décoration proprement dite des deux
salons du Café de Paris montre en M. Sauvage
la même netteté d'idées. Il y adopte (de même
que dans la plupart de ses travaux, mais
sans exclusivité, il y adopte le décor Aoral.
Ses instincts de logique le préservent des contre-
sens, et son goût sûr de la vulgarité, si com-
muns dans ce genre de décor. Le plafond
représenté ici, par exemple, est réellement un
modèle de grâce et d'entente parfaite des con-
ditions d'emploi du décor Aoral, dans la manière
dont il suit et souligne les rinceaux en bois
qui divisent le plafond. Le détail du dessin ne
HENRI SAUVAGE AUTRE SALON AU
CAFÉ DE PARIS*
le cède pas à sa disposition; les tiges, les feuilles,
les Aeurs gardent une souplesse exquise dans la
stylisation. Elles se tiennent aussi loin de la
sèche raideur des stylisations anglaises que du
naturalisme vulgaire des décorations Aorales de
tapissier. M. Sauvage possède, en un mot, une
formule charmante de traitement de la Aeur;
formule neuve sans afhcher de prétentions à
l'être, et tout imprégnée du sourire de l'art
français du siècle dernier, quoique ne se ratta-
chant à celui-ci par aucun lien trop visible.
j'appellerai l'attention sur la combinaison
adoptée par M. Sauvage pour le décor mural
d'un des salons, c'est-à-dire, de concentrer le
décor sur une frise et des motifs d'encoignures
montant à plus que mi-hauteur des murs, tout
le reste des surfaces restant nu. Elle laisse
aux murs la tranquilité nécessaire, et fournit
aux meubles le fond uni sur lequel ils se
détachent le mieux et produisent le maximum
d'effet; en même temps, elle rend les murs
intéressants exactement aux places où cet intérêt
n'est pas diminué par des masses adossées qui
coupent le décor au hasard; elle les couvre assez
pour qu'ils ne soient pas sévères, et pas assez
pour que l'œil soit agacé par la répétition indéAnie
d'un motif en tous sens. Dans la combinaison
du décor mural de l'autre salon, je suis charmé
par l'aimable dessin Aoral dont les ramilles re-
tombent librement, substituant les accidents de
leur chute à la ligne droite par laquelle une
irise ordinaire tranche sur le fond en-dessous.
Le motif serpentant au-dessus de la cimaise,
contre-partie de la frise, forme avec celle-ci
une excellente disposition des masses décoratives,
dans laquelle l'esprit architectural de l'artiste
apparaît de nouveau. M. Sauvage a été moins
heureux en subdivisant le lambris par des
rinceaux arqués de même bois et de même
couleur que les meubles; la vision de ceux-ci
et de ceux-là s'enchevêtre, et les meubles per-
dent une partie de leur valeur. Celà se remarque
particulièrement sur notre phototypie du dressoir.
Je signale le cas en passant, parce qu'il fera
réAéchir à cette difAcile question du rapport
nécessaire — et presque toujours oublié! —
entre les meubles et les dispositions murales,
rapport qui est pour l'harmonie d'un intérieur
ce que la discipline est pour une armée: sans
248
mentale par elle-même. Le luxe y est le résultat
d'une conception constructive complexe, parti-
culière à l'artiste.
La décoration proprement dite des deux
salons du Café de Paris montre en M. Sauvage
la même netteté d'idées. Il y adopte (de même
que dans la plupart de ses travaux, mais
sans exclusivité, il y adopte le décor Aoral.
Ses instincts de logique le préservent des contre-
sens, et son goût sûr de la vulgarité, si com-
muns dans ce genre de décor. Le plafond
représenté ici, par exemple, est réellement un
modèle de grâce et d'entente parfaite des con-
ditions d'emploi du décor Aoral, dans la manière
dont il suit et souligne les rinceaux en bois
qui divisent le plafond. Le détail du dessin ne
HENRI SAUVAGE AUTRE SALON AU
CAFÉ DE PARIS*
le cède pas à sa disposition; les tiges, les feuilles,
les Aeurs gardent une souplesse exquise dans la
stylisation. Elles se tiennent aussi loin de la
sèche raideur des stylisations anglaises que du
naturalisme vulgaire des décorations Aorales de
tapissier. M. Sauvage possède, en un mot, une
formule charmante de traitement de la Aeur;
formule neuve sans afhcher de prétentions à
l'être, et tout imprégnée du sourire de l'art
français du siècle dernier, quoique ne se ratta-
chant à celui-ci par aucun lien trop visible.
j'appellerai l'attention sur la combinaison
adoptée par M. Sauvage pour le décor mural
d'un des salons, c'est-à-dire, de concentrer le
décor sur une frise et des motifs d'encoignures
montant à plus que mi-hauteur des murs, tout
le reste des surfaces restant nu. Elle laisse
aux murs la tranquilité nécessaire, et fournit
aux meubles le fond uni sur lequel ils se
détachent le mieux et produisent le maximum
d'effet; en même temps, elle rend les murs
intéressants exactement aux places où cet intérêt
n'est pas diminué par des masses adossées qui
coupent le décor au hasard; elle les couvre assez
pour qu'ils ne soient pas sévères, et pas assez
pour que l'œil soit agacé par la répétition indéAnie
d'un motif en tous sens. Dans la combinaison
du décor mural de l'autre salon, je suis charmé
par l'aimable dessin Aoral dont les ramilles re-
tombent librement, substituant les accidents de
leur chute à la ligne droite par laquelle une
irise ordinaire tranche sur le fond en-dessous.
Le motif serpentant au-dessus de la cimaise,
contre-partie de la frise, forme avec celle-ci
une excellente disposition des masses décoratives,
dans laquelle l'esprit architectural de l'artiste
apparaît de nouveau. M. Sauvage a été moins
heureux en subdivisant le lambris par des
rinceaux arqués de même bois et de même
couleur que les meubles; la vision de ceux-ci
et de ceux-là s'enchevêtre, et les meubles per-
dent une partie de leur valeur. Celà se remarque
particulièrement sur notre phototypie du dressoir.
Je signale le cas en passant, parce qu'il fera
réAéchir à cette difAcile question du rapport
nécessaire — et presque toujours oublié! —
entre les meubles et les dispositions murales,
rapport qui est pour l'harmonie d'un intérieur
ce que la discipline est pour une armée: sans
248