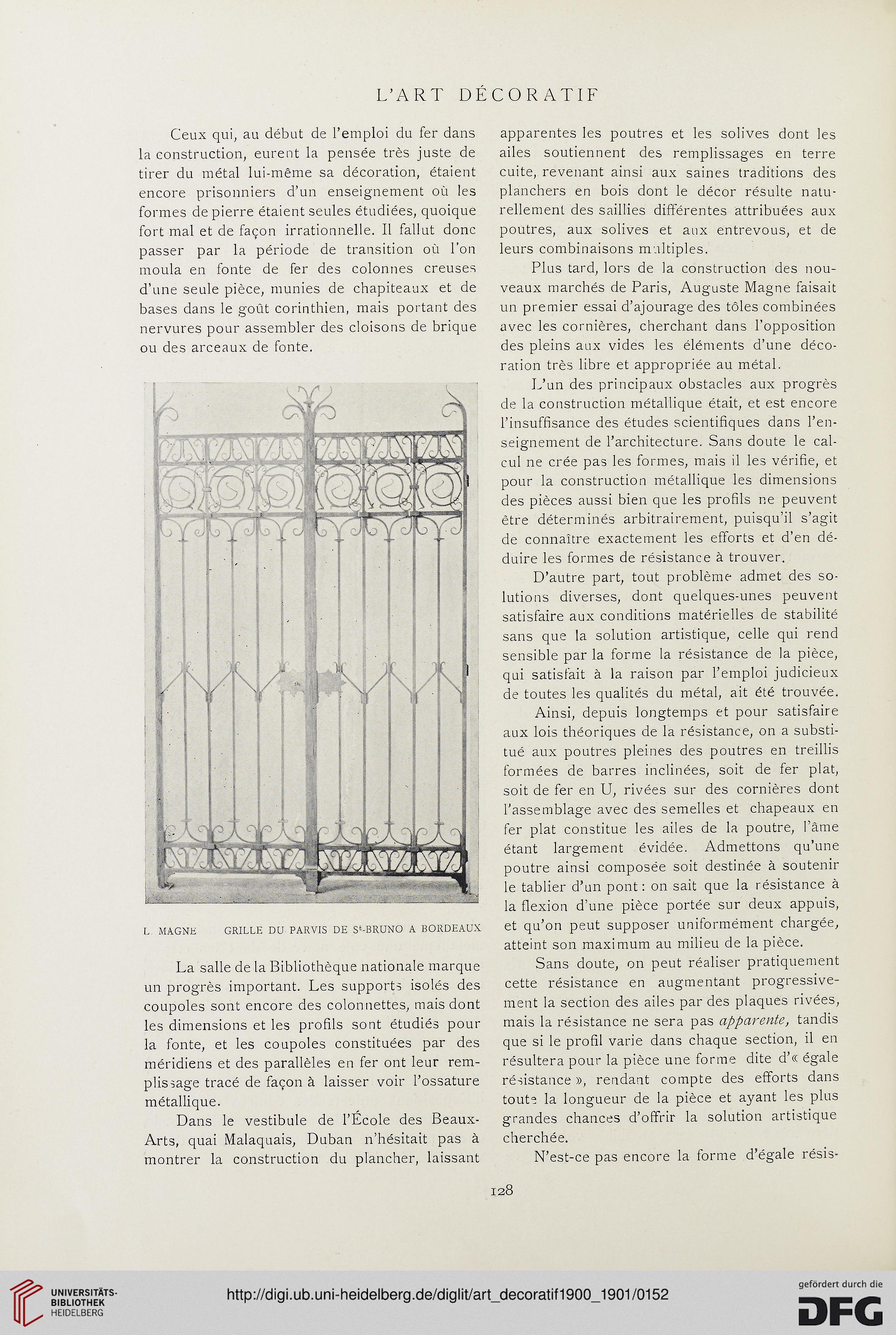L'ART DECORATIF
Ceux qui, au début de l'emploi du fer dans
la construction, eurent la pensée très juste de
tirer du métal lui-même sa décoration, étaient
encore prisonniers d'un enseignement où les
formes de pierre étaient seules étudiées, quoique
fort mal et de façon irrationnelle. Il fallut donc
passer par la période de transition où l'on
moula en fonte de 1er des colonnes creuses
d'une seule pièce, munies de chapiteaux et de
bases dans le goût corinthien, mais portant des
nervures pour assembler des cloisons de brique
ou des arceaux de fonte.
L MAGNE GRILLE DU PARVIS DE S^BRUNO A BORDEAUX
La salle de la Bibliothèque nationale marque
un progrès important. Les supports isolés des
coupoles sont encore des colonnettes, mais dont
les dimensions et les profils sont étudiés pour
la fonte, et les coupoles constituées par des
méridiens et des parallèles en fer ont leur rem-
plissage tracé de façon à laisser voir l'ossature
métallique.
Dans le vestibule de l'École des Beaux-
Arts, quai Malaquais, Duban n'hésitait pas à
montrer la construction du plancher, laissant
apparentes les poutres et les solives dont les
ailes soutiennent des remplissages en terre
cuite, revenant ainsi aux saines traditions des
planchers en bois dont le décor résulte natu-
rellement des saillies différentes attribuées aux
poutres, aux solives et aux entrevous, et de
leurs combinaisons multiples.
Plus tard, lors de la construction des nou-
veaux marchés de Paris, Auguste Magne faisait
un premier essai d'ajourage des tôles combinées
avec les cornières, cherchant dans l'opposition
des pleins aux vides les éléments d'une déco-
ration très libre et appropriée au métal.
L'un des principaux obstacles aux progrès
de la construction métallique était, et est encore
l'insuffisance des études scientifiques dans l'en-
seignement de l'architecture. Sans doute le cal-
cul ne crée pas les formes, mais il les vérifie, et
pour la construction métallique les dimensions
des pièces aussi bien que les profils ne peuvent
être déterminés arbitrairement, puisqu'il s'agit
de connaître exactement les efforts et d'en dé-
duire les formes de résistance à trouver.
D'autre part, tout problème admet des so-
lutions diverses, dont quelques-unes peuvent
satisfaire aux conditions matérielles de stabilité
sans que la solution artistique, celle qui rend
sensible par la forme la résistance de la pièce,
qui satisfait à la raison par l'emploi judicieux
de toutes les qualités du métal, ait été trouvée.
Ainsi, depuis longtemps et pour satisfaire
aux lois théoriques de la résistance, on a substi-
tué aux poutres pleines des poutres en treillis
formées de barres inclinées, soit de fer plat,
soit de fer en U, rivées sur des cornières dont
l'assemblage avec des semelles et chapeaux en
fer plat constitue les ailes de la poutre, l'âme
étant largement évidée. Admettons qu'une
poutre ainsi composée soit destinée à soutenir
le tablier d'un pont: on sait que la résistance à
la flexion d'une pièce portée sur deux appuis,
et qu'on peut supposer uniformément chargée,
atteint son maximum au milieu de la pièce.
Sans doute, on peut réaliser pratiquement
cette résistance en augmentant progressive-
ment la section des ailes par des plaques rivées,
mais la résistance ne sera pas tandis
que si le profil varie dans chaque section, il en
résultera pour la pièce une forme dite d'« égale
résistance )), rendant compte des efforts dans
toute la longueur de la pièce et ayant les plus
grandes chances d'offrir la solution artistique
cherchée.
N'est-ce pas encore la forme d'égale résis-
128
Ceux qui, au début de l'emploi du fer dans
la construction, eurent la pensée très juste de
tirer du métal lui-même sa décoration, étaient
encore prisonniers d'un enseignement où les
formes de pierre étaient seules étudiées, quoique
fort mal et de façon irrationnelle. Il fallut donc
passer par la période de transition où l'on
moula en fonte de 1er des colonnes creuses
d'une seule pièce, munies de chapiteaux et de
bases dans le goût corinthien, mais portant des
nervures pour assembler des cloisons de brique
ou des arceaux de fonte.
L MAGNE GRILLE DU PARVIS DE S^BRUNO A BORDEAUX
La salle de la Bibliothèque nationale marque
un progrès important. Les supports isolés des
coupoles sont encore des colonnettes, mais dont
les dimensions et les profils sont étudiés pour
la fonte, et les coupoles constituées par des
méridiens et des parallèles en fer ont leur rem-
plissage tracé de façon à laisser voir l'ossature
métallique.
Dans le vestibule de l'École des Beaux-
Arts, quai Malaquais, Duban n'hésitait pas à
montrer la construction du plancher, laissant
apparentes les poutres et les solives dont les
ailes soutiennent des remplissages en terre
cuite, revenant ainsi aux saines traditions des
planchers en bois dont le décor résulte natu-
rellement des saillies différentes attribuées aux
poutres, aux solives et aux entrevous, et de
leurs combinaisons multiples.
Plus tard, lors de la construction des nou-
veaux marchés de Paris, Auguste Magne faisait
un premier essai d'ajourage des tôles combinées
avec les cornières, cherchant dans l'opposition
des pleins aux vides les éléments d'une déco-
ration très libre et appropriée au métal.
L'un des principaux obstacles aux progrès
de la construction métallique était, et est encore
l'insuffisance des études scientifiques dans l'en-
seignement de l'architecture. Sans doute le cal-
cul ne crée pas les formes, mais il les vérifie, et
pour la construction métallique les dimensions
des pièces aussi bien que les profils ne peuvent
être déterminés arbitrairement, puisqu'il s'agit
de connaître exactement les efforts et d'en dé-
duire les formes de résistance à trouver.
D'autre part, tout problème admet des so-
lutions diverses, dont quelques-unes peuvent
satisfaire aux conditions matérielles de stabilité
sans que la solution artistique, celle qui rend
sensible par la forme la résistance de la pièce,
qui satisfait à la raison par l'emploi judicieux
de toutes les qualités du métal, ait été trouvée.
Ainsi, depuis longtemps et pour satisfaire
aux lois théoriques de la résistance, on a substi-
tué aux poutres pleines des poutres en treillis
formées de barres inclinées, soit de fer plat,
soit de fer en U, rivées sur des cornières dont
l'assemblage avec des semelles et chapeaux en
fer plat constitue les ailes de la poutre, l'âme
étant largement évidée. Admettons qu'une
poutre ainsi composée soit destinée à soutenir
le tablier d'un pont: on sait que la résistance à
la flexion d'une pièce portée sur deux appuis,
et qu'on peut supposer uniformément chargée,
atteint son maximum au milieu de la pièce.
Sans doute, on peut réaliser pratiquement
cette résistance en augmentant progressive-
ment la section des ailes par des plaques rivées,
mais la résistance ne sera pas tandis
que si le profil varie dans chaque section, il en
résultera pour la pièce une forme dite d'« égale
résistance )), rendant compte des efforts dans
toute la longueur de la pièce et ayant les plus
grandes chances d'offrir la solution artistique
cherchée.
N'est-ce pas encore la forme d'égale résis-
128