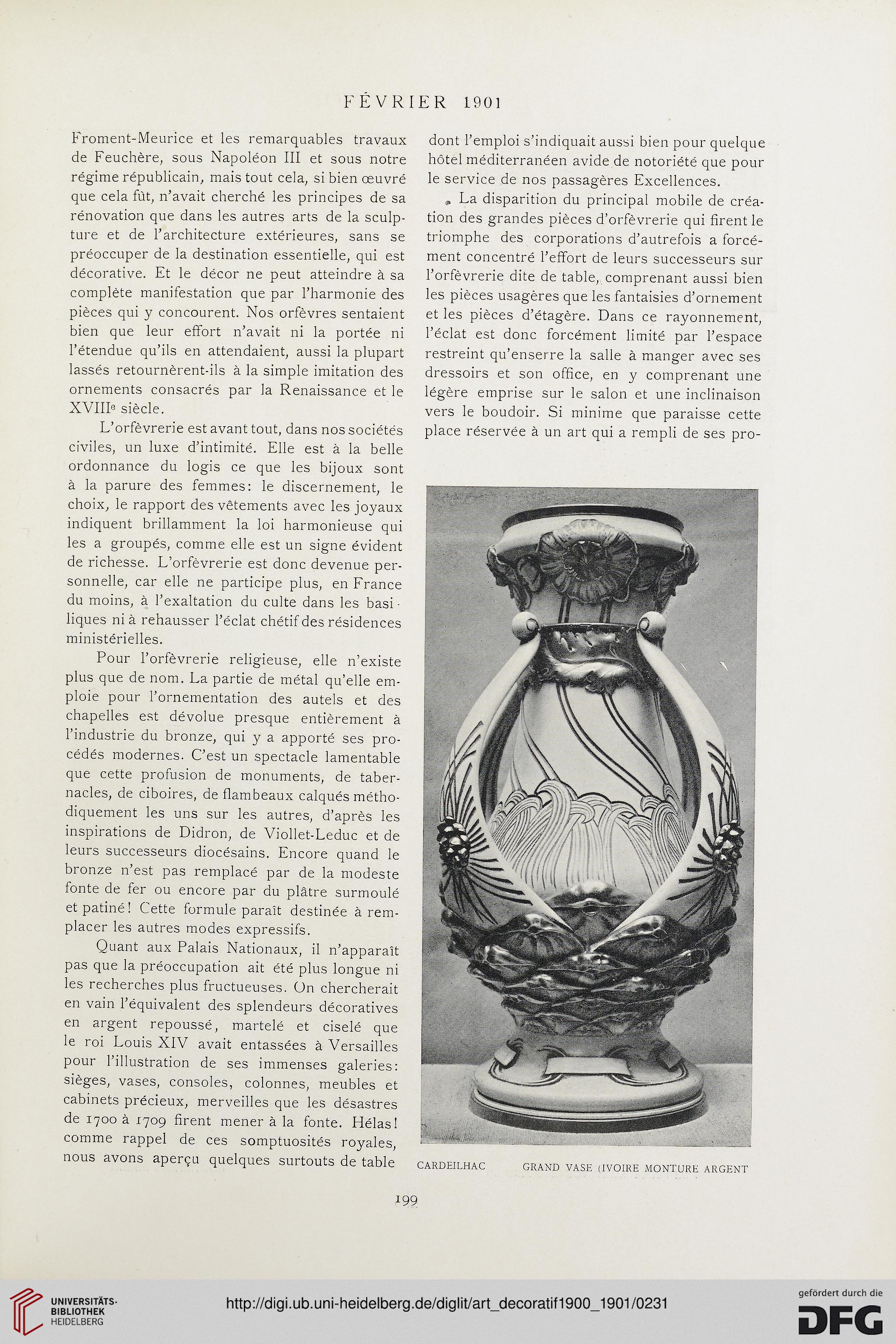FEVRIER 1901
Froment-Meurice et les remarquables travaux
de Feuchère, sous Napoléon III et sous notre
régime républicain, mais tout cela, si bien œuvré
que cela fut, n'avait cherché les principes de sa
rénovation que dans les autres arts de la sculp-
ture et de l'architecture extérieures, sans se
préoccuper de la destination essentielle, qui est
décorative. Et le décor ne peut atteindre à sa
complète manifestation que par l'harmonie des
pièces qui y concourent. Nos orfèvres sentaient
bien que leur effort n'avait ni la portée ni
l'étendue qu'ils en attendaient, aussi la plupart
lassés retournèrent-ils à la simple imitation des
ornements consacrés par la Renaissance et le
XVIIF siècle.
L'orfèvrerie est avant tout, dans nos sociétés
civiles, un luxe d'intimité. Elle est à la belle
ordonnance du logis ce que les bijoux sont
à la parure des femmes: le discernement, le
choix, le rapport des vêtements avec les joyaux
indiquent brillamment la loi harmonieuse qui
les a groupés, comme elle est un signe évident
de richesse. L'orfèvrerie est donc devenue per-
sonnelle, car elle ne participe plus, en France
du moins, à l'exaltation du culte dans les basi
liques ni à rehausser l'éclat chétif des résidences
ministérielles.
Pour l'orfèvrerie religieuse, elle n'existe
plus que de nom. La partie de métal qu'elle em-
ploie pour l'ornementation des autels et des
chapelles est dévolue presque entièrement à
l'industrie du bronze, qui y a apporté ses pro-
cédés modernes. C'est un spectacle lamentable
que cette profusion de monuments, de taber-
nacles, de ciboires, de flambeaux calqués métho-
diquement les uns sur les autres, d'après les
inspirations de Didron, de Viollet-Leduc et de
leurs successeurs diocésains. Encore quand le
bronze n'est pas remplacé par de la modeste
fonte de fer ou encore par du plâtre surmoulé
et patiné! Cette formule paraît destinée à rem-
placer les autres modes expressifs.
Quant aux Palais Nationaux, il n'apparaît
pas que la préoccupation ait été plus longue ni
les recherches plus fructueuses. On chercherait
en vain l'équivalent des splendeurs décoratives
en argent repoussé, martelé et ciselé que
le roi Louis XIV avait entassées à Versailles
pour l'illustration de ses immenses galeries:
sièges, vases, consoles, colonnes, meubles et
cabinets précieux, merveilles que les désastres
de 1700 à 1709 firent mener à la fonte. Hélas!
comme rappel de ces somptuosités royales,
nous avons aperçu quelques surtouts de table
dont l'emploi s'indiquait aussi bien pour quelque
hôtel méditerranéen avide de notoriété que pour
le service de nos passagères Excellences.
, La disparition du principal mobile de créa-
tion des grandes pièces d'orfèvrerie qui firent le
triomphe des corporations d'autrefois a forcé-
ment concentré l'effort de leurs successeurs sur
l'orfèvrerie dite de table, comprenant aussi bien
les pièces usagères que les fantaisies d'ornement
et les pièces d'étagère. Dans ce rayonnement,
l'éclat est donc forcément limité par l'espace
restreint qu'enserre la salle à manger avec ses
dressoirs et son office, en y comprenant une
légère emprise sur le salon et une inclinaison
vers le boudoir. Si minime que paraisse cette
place réservée à un art qui a rempli de ses pro-
CARDEILHAC GRAND VASE (IVOIRE MONTURE ARGENT
199
Froment-Meurice et les remarquables travaux
de Feuchère, sous Napoléon III et sous notre
régime républicain, mais tout cela, si bien œuvré
que cela fut, n'avait cherché les principes de sa
rénovation que dans les autres arts de la sculp-
ture et de l'architecture extérieures, sans se
préoccuper de la destination essentielle, qui est
décorative. Et le décor ne peut atteindre à sa
complète manifestation que par l'harmonie des
pièces qui y concourent. Nos orfèvres sentaient
bien que leur effort n'avait ni la portée ni
l'étendue qu'ils en attendaient, aussi la plupart
lassés retournèrent-ils à la simple imitation des
ornements consacrés par la Renaissance et le
XVIIF siècle.
L'orfèvrerie est avant tout, dans nos sociétés
civiles, un luxe d'intimité. Elle est à la belle
ordonnance du logis ce que les bijoux sont
à la parure des femmes: le discernement, le
choix, le rapport des vêtements avec les joyaux
indiquent brillamment la loi harmonieuse qui
les a groupés, comme elle est un signe évident
de richesse. L'orfèvrerie est donc devenue per-
sonnelle, car elle ne participe plus, en France
du moins, à l'exaltation du culte dans les basi
liques ni à rehausser l'éclat chétif des résidences
ministérielles.
Pour l'orfèvrerie religieuse, elle n'existe
plus que de nom. La partie de métal qu'elle em-
ploie pour l'ornementation des autels et des
chapelles est dévolue presque entièrement à
l'industrie du bronze, qui y a apporté ses pro-
cédés modernes. C'est un spectacle lamentable
que cette profusion de monuments, de taber-
nacles, de ciboires, de flambeaux calqués métho-
diquement les uns sur les autres, d'après les
inspirations de Didron, de Viollet-Leduc et de
leurs successeurs diocésains. Encore quand le
bronze n'est pas remplacé par de la modeste
fonte de fer ou encore par du plâtre surmoulé
et patiné! Cette formule paraît destinée à rem-
placer les autres modes expressifs.
Quant aux Palais Nationaux, il n'apparaît
pas que la préoccupation ait été plus longue ni
les recherches plus fructueuses. On chercherait
en vain l'équivalent des splendeurs décoratives
en argent repoussé, martelé et ciselé que
le roi Louis XIV avait entassées à Versailles
pour l'illustration de ses immenses galeries:
sièges, vases, consoles, colonnes, meubles et
cabinets précieux, merveilles que les désastres
de 1700 à 1709 firent mener à la fonte. Hélas!
comme rappel de ces somptuosités royales,
nous avons aperçu quelques surtouts de table
dont l'emploi s'indiquait aussi bien pour quelque
hôtel méditerranéen avide de notoriété que pour
le service de nos passagères Excellences.
, La disparition du principal mobile de créa-
tion des grandes pièces d'orfèvrerie qui firent le
triomphe des corporations d'autrefois a forcé-
ment concentré l'effort de leurs successeurs sur
l'orfèvrerie dite de table, comprenant aussi bien
les pièces usagères que les fantaisies d'ornement
et les pièces d'étagère. Dans ce rayonnement,
l'éclat est donc forcément limité par l'espace
restreint qu'enserre la salle à manger avec ses
dressoirs et son office, en y comprenant une
légère emprise sur le salon et une inclinaison
vers le boudoir. Si minime que paraisse cette
place réservée à un art qui a rempli de ses pro-
CARDEILHAC GRAND VASE (IVOIRE MONTURE ARGENT
199