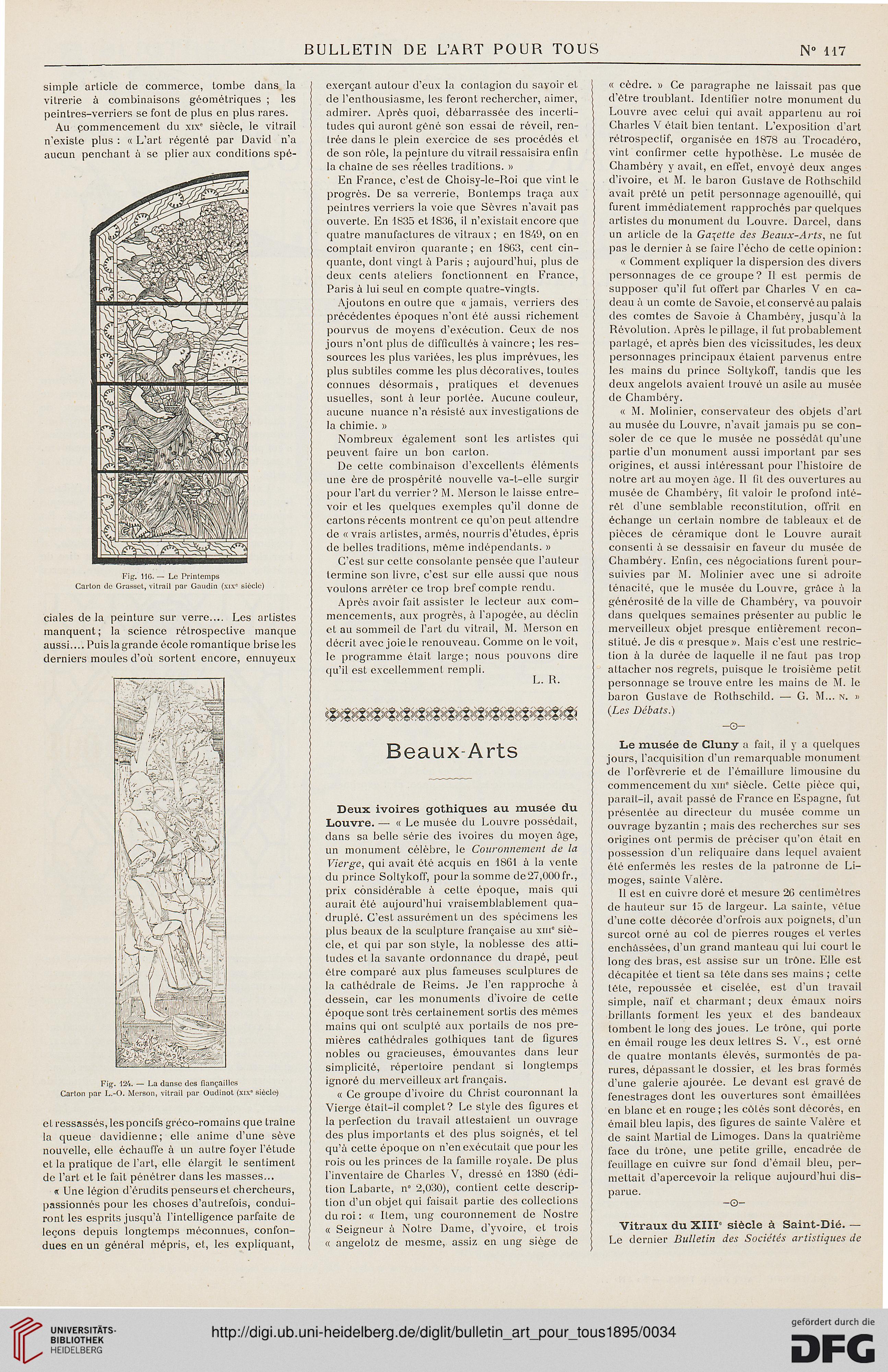BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
N° 117
simple article de commerce, tombe dans la
vitrerie à combinaisons géométriques ; les
peintres-verriers se font de plus en plus rares.
Au commencement du xix" siècle, le vitrail
n'existe plus : « L'art régenté par David n'a
aucun penchant à se plier aux conditions spé-
Fig. 116. — Le Printemps
Carton de Grasset, vitrail par Gaudin (xix° siècle)
ciales de la peinture sur verre.... Les artistes
manquent; la science rétrospective manque
aussi.... Puis la grande école romantique brise les
derniers moules d'où sortent encore, ennuyeux
Fig. 124. — La danse des fiançailles
Carton par L.-O. Merson, vitrail par Oudinot (xix° siècle)
et ressassés, les poncifs gréco-romains que traîne
la queue davidienne; elle anime d'une sève
nouvelle, elle échauffe à un autre foyer l'étude
et la pratique de l'art, elle élargit le sentiment
de l'art et le fait pénétrer dans les masses...
« Une légion d'érudits penseurs et chercheurs,
passionnés pour les choses d'autrefois, condui-
ront les esprits jusqu'à l'intelligence parfaite de
leçons depuis longtemps méconnues, confon-
dues en un général mépris, et, les expliquant,
exerçant autour d'eux la contagion du savoir et
de l'enthousiasme, les feront rechercher, aimer,
admirer. Après quoi, débarrassée des incerti-
tudes qui auront gêné son essai de réveil, ren-
trée dans le plein exercice de ses procédés et
de son rôle, la peinture du vitrail ressaisira enfin
la chaîne de ses réelles traditions. »
En France, c'est de Choisy-le-Roi que vint le
progrès. De sa verrerie, Bontemps traça aux
peintres verriers la voie que Sèvres n'avait pas
ouverte. En 1835 et 1836, il n'existait encore que
quatre manufactures de vitraux ; en 1849, on en
comptait environ quarante; en 1863, cent cin-
quante, dont vingt à Paris ; aujourd'hui, plus de
deux cents ateliers fonctionnent en France,
Paris à lui seul en compte quatre-vingts.
Ajoutons en outre que «jamais, verriers des
précédentes époques n'ont été aussi richement
pourvus de moyens d'exécution. Ceux de nos
jours n'ont plus de difficultés à vaincre; les res-
sources les plus variées, les plus imprévues, les
plus subtiles comme les plus décoratives, toutes
connues désormais, pratiques et devenues
usuelles, sont à leur portée. Aucune couleur,
aucune nuance n'a résisté aux investigations de
la chimie. »
Nombreux également sont les artistes qui
peuvent faire un bon carton.
De cette combinaison d'excellents éléments
une ère de prospérité nouvelle va-t-elle surgir
pour l'art du verrier? M. Merson le laisse entre-
voir et les quelques exemples qu'il donne de
cartons récents montrent ce qu'on peut attendre
de « vrais artistes, armés, nourris d'études, épris
de belles traditions, même indépendants. »
C'est sur cette consolante pensée que l'auteur
termine son livre, c'est sur elle aussi que nous
voulons arrêter ce trop bref compte rendu.
Après avoir fait assister le lecteur aux com-
mencements, aux progrès, à l'apogée, au déclin
et au sommeil de l'art du vitrail, M. Merson en
décrit avec joie le renouveau. Comme on le voit,
le programme était large; nous pouvons dire
qu'il est excellemment rempli.
L. R.
Beaux-Arts
Deux ivoires gothiques au musée du
Louvre. — « Le musée du Louvre possédait,
dans sa belle série des ivoires du moyen âge,
un monument célèbre, le Couronnement de la
Vierge, qui avait été acquis en 1861 à la vente
du prince Soltykoff, pour la somme de27,000fr.,
prix considérable à celte époque, mais qui
aurait été aujourd'hui vraisemblablement qua-
druplé. C'est assurément un des spécimens les
plus beaux de la sculpture française au xiue siè-
cle, et qui par son style, la noblesse des atti-
tudes et la savante ordonnance du drapé, peut
être comparé aux plus fameuses sculptures de
la cathédrale de Reims. Je l'en rapproche à
dessein, car les monuments d'ivoire de cette
époque sont très certainement sortis des mêmes
mains qui ont sculpté aux portails de nos pre-
mières cathédrales gothiques tant de figures
nobles ou gracieuses, émouvantes dans leur
simplicité, répertoire pendant si longtemps
ignoré du merveilleux art français.
« Ce groupe d'ivoire du Christ couronnant la
Vierge était-il complet? Le style des figures et
la perfection du travail attestaient un ouvrage
des plus importants et des plus soignés, et tel
qu'à cette époque on n'en exécutait que pour les
rois ou les princes de la famille royale. De plus
l'inventaire de Charles V, dressé en 1380 (édi-
tion Labarte, n° 2,030), contient celte descrip-
tion d'un objet qui faisait partie des collections
du roi : « Item, ting couronnement de Noslre
« Seigneur à Noire Dame, d'yvoire, et trois
« angelolz de mesme, assiz en ung siège de
J « cèdre. » Ce paragraphe ne laissait pas que
d'être troublant. Identifier notre monument du
Louvre avec celui qui avait appartenu au roi
Charles V était bien lenlant. L'exposition d'art
rétrospectif, organisée en 1878 au Trocadéro,
vint confirmer cette hypothèse. Le musée de
Chambéry y avait, en effet, envoyé deux anges
d'ivoire, et M. le baron Gustave de Rothschild
avait prêté un petit personnage agenouillé, qui
furent immédiatement rapprochés par quelques
artistes du monument du Louvre. Darcel, dans
un arlicle de la Galette des Beaux-Arts, ne fut
pas le dernier à se faire l'écho de cette opinion:
« Comment expliquer la dispersion des divers
personnages de ce groupe? Il est permis de
supposer qu'il fut offert par Charles V en ca-
deau à un comte de Savoie, et conservé au palais
des comtes de Savoie à Chambéry, jusqu'à la
Révolution. Après le pillage, il fut probablement
partagé, et après bien des vicissitudes, les deux
personnages principaux élaienl parvenus entre
les mains du prince Soltykoff, tandis que les
deux angelots avaient trouvé un asile au musée
!de Chambéry.
« M. Molinier, conservateur des objets d'art
au musée du Louvre, n'avait jamais pu se con-
soler de ce que le musée ne possédât qu'une
partie d'un monument aussi important par ses
origines, et aussi intéressant pour l'histoire de
noire art au moyen âge. Il fit des ouvertures au
musée de Chambéry, fit valoir le profond inté-
rêt d'une semblable reconstitution, offrit en
échange un certain nombre de tableaux et de
pièces de céramique dont le Louvre aurait
consenti à se dessaisir en faveur du musée de
Chambéry. Enfin, ces négociations furent pour-
suivies par M. Molinier avec une si adroite
ténacité, que le musée du Louvre, grâce à la
générosité de la ville de Chambéry, va pouvoir
dans quelques semaines présenter au public le
merveilleux objet presque entièrement recon-
stitué. Je dis « presque». Mais c'est une restric-
tion à la durée de laquelle il ne faut pas trop
attacher nos regrets, puisque le troisième petit
personnage se trouve entre les mains de M. le
baron Gustave de Rothschild. — G. M... n. »
{Les Débats.)
-G-
Le musée de Cluny a fait, il y a quelques
jours, l'acquisition d'un remarquable monument
de l'orfèvrerie et de l'émaillure limousine du
commencement du xme siècle. Cette pièce qui,
paraît-il, avait passé de France en Espagne, fut
présentée au directeur du musée comme un
' ouvrage byzantin ; mais des recherches sur ses
' origines ont permis de préciser qu'on était en
J possession d'un reliquaire dans lequel avaient
; été enfermés les restes de la patronne de Li-
moges, sainte Valère.
Il est en cuivre doré et mesure 26 centimètres
\ de hauteur sur 15 de largeur. La sainte, vêtue
d'une cotte décorée d'orfrois aux poignets, d'un
surcot orné au col de pierres rouges et vertes
enchâssées, d'un grand manteau qui lui court le
long des bras, est assise sur un trône. Elle est
décapitée et tient sa tête dans ses mains ; cette
tête, repoussée et ciselée, est d'un travail
simple, naïf et charmant ; deux émaux noirs
brillants forment les yeux et des bandeaux
tombent le long des joues. Le trône, qui porte
en émail rouge les deux lettres S. V., est orné
de quatre montants élevés, surmontés de pa-
rures, dépassant le dossier, et les bras formés
d'une galerie ajourée. Le devant est gravé de
fenestrages dont les ouvertures sont émaillées
en blanc et en rouge; les côtés sont décorés, en
! émail bleu lapis, des figures de sainte Valère et
de saint Martial de Limoges. Dans la quatrième
face du trône, une petite grille, encadrée de
feuillage en cuivre sur fond d'émail bleu, per-
mettait d'apercevoir la relique aujourd'hui dis-
parue.
-O-
Vitraux du XIII0 siècle à Saint-Dié. —
Le dernier Bulletin des Sociétés artistiques de
N° 117
simple article de commerce, tombe dans la
vitrerie à combinaisons géométriques ; les
peintres-verriers se font de plus en plus rares.
Au commencement du xix" siècle, le vitrail
n'existe plus : « L'art régenté par David n'a
aucun penchant à se plier aux conditions spé-
Fig. 116. — Le Printemps
Carton de Grasset, vitrail par Gaudin (xix° siècle)
ciales de la peinture sur verre.... Les artistes
manquent; la science rétrospective manque
aussi.... Puis la grande école romantique brise les
derniers moules d'où sortent encore, ennuyeux
Fig. 124. — La danse des fiançailles
Carton par L.-O. Merson, vitrail par Oudinot (xix° siècle)
et ressassés, les poncifs gréco-romains que traîne
la queue davidienne; elle anime d'une sève
nouvelle, elle échauffe à un autre foyer l'étude
et la pratique de l'art, elle élargit le sentiment
de l'art et le fait pénétrer dans les masses...
« Une légion d'érudits penseurs et chercheurs,
passionnés pour les choses d'autrefois, condui-
ront les esprits jusqu'à l'intelligence parfaite de
leçons depuis longtemps méconnues, confon-
dues en un général mépris, et, les expliquant,
exerçant autour d'eux la contagion du savoir et
de l'enthousiasme, les feront rechercher, aimer,
admirer. Après quoi, débarrassée des incerti-
tudes qui auront gêné son essai de réveil, ren-
trée dans le plein exercice de ses procédés et
de son rôle, la peinture du vitrail ressaisira enfin
la chaîne de ses réelles traditions. »
En France, c'est de Choisy-le-Roi que vint le
progrès. De sa verrerie, Bontemps traça aux
peintres verriers la voie que Sèvres n'avait pas
ouverte. En 1835 et 1836, il n'existait encore que
quatre manufactures de vitraux ; en 1849, on en
comptait environ quarante; en 1863, cent cin-
quante, dont vingt à Paris ; aujourd'hui, plus de
deux cents ateliers fonctionnent en France,
Paris à lui seul en compte quatre-vingts.
Ajoutons en outre que «jamais, verriers des
précédentes époques n'ont été aussi richement
pourvus de moyens d'exécution. Ceux de nos
jours n'ont plus de difficultés à vaincre; les res-
sources les plus variées, les plus imprévues, les
plus subtiles comme les plus décoratives, toutes
connues désormais, pratiques et devenues
usuelles, sont à leur portée. Aucune couleur,
aucune nuance n'a résisté aux investigations de
la chimie. »
Nombreux également sont les artistes qui
peuvent faire un bon carton.
De cette combinaison d'excellents éléments
une ère de prospérité nouvelle va-t-elle surgir
pour l'art du verrier? M. Merson le laisse entre-
voir et les quelques exemples qu'il donne de
cartons récents montrent ce qu'on peut attendre
de « vrais artistes, armés, nourris d'études, épris
de belles traditions, même indépendants. »
C'est sur cette consolante pensée que l'auteur
termine son livre, c'est sur elle aussi que nous
voulons arrêter ce trop bref compte rendu.
Après avoir fait assister le lecteur aux com-
mencements, aux progrès, à l'apogée, au déclin
et au sommeil de l'art du vitrail, M. Merson en
décrit avec joie le renouveau. Comme on le voit,
le programme était large; nous pouvons dire
qu'il est excellemment rempli.
L. R.
Beaux-Arts
Deux ivoires gothiques au musée du
Louvre. — « Le musée du Louvre possédait,
dans sa belle série des ivoires du moyen âge,
un monument célèbre, le Couronnement de la
Vierge, qui avait été acquis en 1861 à la vente
du prince Soltykoff, pour la somme de27,000fr.,
prix considérable à celte époque, mais qui
aurait été aujourd'hui vraisemblablement qua-
druplé. C'est assurément un des spécimens les
plus beaux de la sculpture française au xiue siè-
cle, et qui par son style, la noblesse des atti-
tudes et la savante ordonnance du drapé, peut
être comparé aux plus fameuses sculptures de
la cathédrale de Reims. Je l'en rapproche à
dessein, car les monuments d'ivoire de cette
époque sont très certainement sortis des mêmes
mains qui ont sculpté aux portails de nos pre-
mières cathédrales gothiques tant de figures
nobles ou gracieuses, émouvantes dans leur
simplicité, répertoire pendant si longtemps
ignoré du merveilleux art français.
« Ce groupe d'ivoire du Christ couronnant la
Vierge était-il complet? Le style des figures et
la perfection du travail attestaient un ouvrage
des plus importants et des plus soignés, et tel
qu'à cette époque on n'en exécutait que pour les
rois ou les princes de la famille royale. De plus
l'inventaire de Charles V, dressé en 1380 (édi-
tion Labarte, n° 2,030), contient celte descrip-
tion d'un objet qui faisait partie des collections
du roi : « Item, ting couronnement de Noslre
« Seigneur à Noire Dame, d'yvoire, et trois
« angelolz de mesme, assiz en ung siège de
J « cèdre. » Ce paragraphe ne laissait pas que
d'être troublant. Identifier notre monument du
Louvre avec celui qui avait appartenu au roi
Charles V était bien lenlant. L'exposition d'art
rétrospectif, organisée en 1878 au Trocadéro,
vint confirmer cette hypothèse. Le musée de
Chambéry y avait, en effet, envoyé deux anges
d'ivoire, et M. le baron Gustave de Rothschild
avait prêté un petit personnage agenouillé, qui
furent immédiatement rapprochés par quelques
artistes du monument du Louvre. Darcel, dans
un arlicle de la Galette des Beaux-Arts, ne fut
pas le dernier à se faire l'écho de cette opinion:
« Comment expliquer la dispersion des divers
personnages de ce groupe? Il est permis de
supposer qu'il fut offert par Charles V en ca-
deau à un comte de Savoie, et conservé au palais
des comtes de Savoie à Chambéry, jusqu'à la
Révolution. Après le pillage, il fut probablement
partagé, et après bien des vicissitudes, les deux
personnages principaux élaienl parvenus entre
les mains du prince Soltykoff, tandis que les
deux angelots avaient trouvé un asile au musée
!de Chambéry.
« M. Molinier, conservateur des objets d'art
au musée du Louvre, n'avait jamais pu se con-
soler de ce que le musée ne possédât qu'une
partie d'un monument aussi important par ses
origines, et aussi intéressant pour l'histoire de
noire art au moyen âge. Il fit des ouvertures au
musée de Chambéry, fit valoir le profond inté-
rêt d'une semblable reconstitution, offrit en
échange un certain nombre de tableaux et de
pièces de céramique dont le Louvre aurait
consenti à se dessaisir en faveur du musée de
Chambéry. Enfin, ces négociations furent pour-
suivies par M. Molinier avec une si adroite
ténacité, que le musée du Louvre, grâce à la
générosité de la ville de Chambéry, va pouvoir
dans quelques semaines présenter au public le
merveilleux objet presque entièrement recon-
stitué. Je dis « presque». Mais c'est une restric-
tion à la durée de laquelle il ne faut pas trop
attacher nos regrets, puisque le troisième petit
personnage se trouve entre les mains de M. le
baron Gustave de Rothschild. — G. M... n. »
{Les Débats.)
-G-
Le musée de Cluny a fait, il y a quelques
jours, l'acquisition d'un remarquable monument
de l'orfèvrerie et de l'émaillure limousine du
commencement du xme siècle. Cette pièce qui,
paraît-il, avait passé de France en Espagne, fut
présentée au directeur du musée comme un
' ouvrage byzantin ; mais des recherches sur ses
' origines ont permis de préciser qu'on était en
J possession d'un reliquaire dans lequel avaient
; été enfermés les restes de la patronne de Li-
moges, sainte Valère.
Il est en cuivre doré et mesure 26 centimètres
\ de hauteur sur 15 de largeur. La sainte, vêtue
d'une cotte décorée d'orfrois aux poignets, d'un
surcot orné au col de pierres rouges et vertes
enchâssées, d'un grand manteau qui lui court le
long des bras, est assise sur un trône. Elle est
décapitée et tient sa tête dans ses mains ; cette
tête, repoussée et ciselée, est d'un travail
simple, naïf et charmant ; deux émaux noirs
brillants forment les yeux et des bandeaux
tombent le long des joues. Le trône, qui porte
en émail rouge les deux lettres S. V., est orné
de quatre montants élevés, surmontés de pa-
rures, dépassant le dossier, et les bras formés
d'une galerie ajourée. Le devant est gravé de
fenestrages dont les ouvertures sont émaillées
en blanc et en rouge; les côtés sont décorés, en
! émail bleu lapis, des figures de sainte Valère et
de saint Martial de Limoges. Dans la quatrième
face du trône, une petite grille, encadrée de
feuillage en cuivre sur fond d'émail bleu, per-
mettait d'apercevoir la relique aujourd'hui dis-
parue.
-O-
Vitraux du XIII0 siècle à Saint-Dié. —
Le dernier Bulletin des Sociétés artistiques de