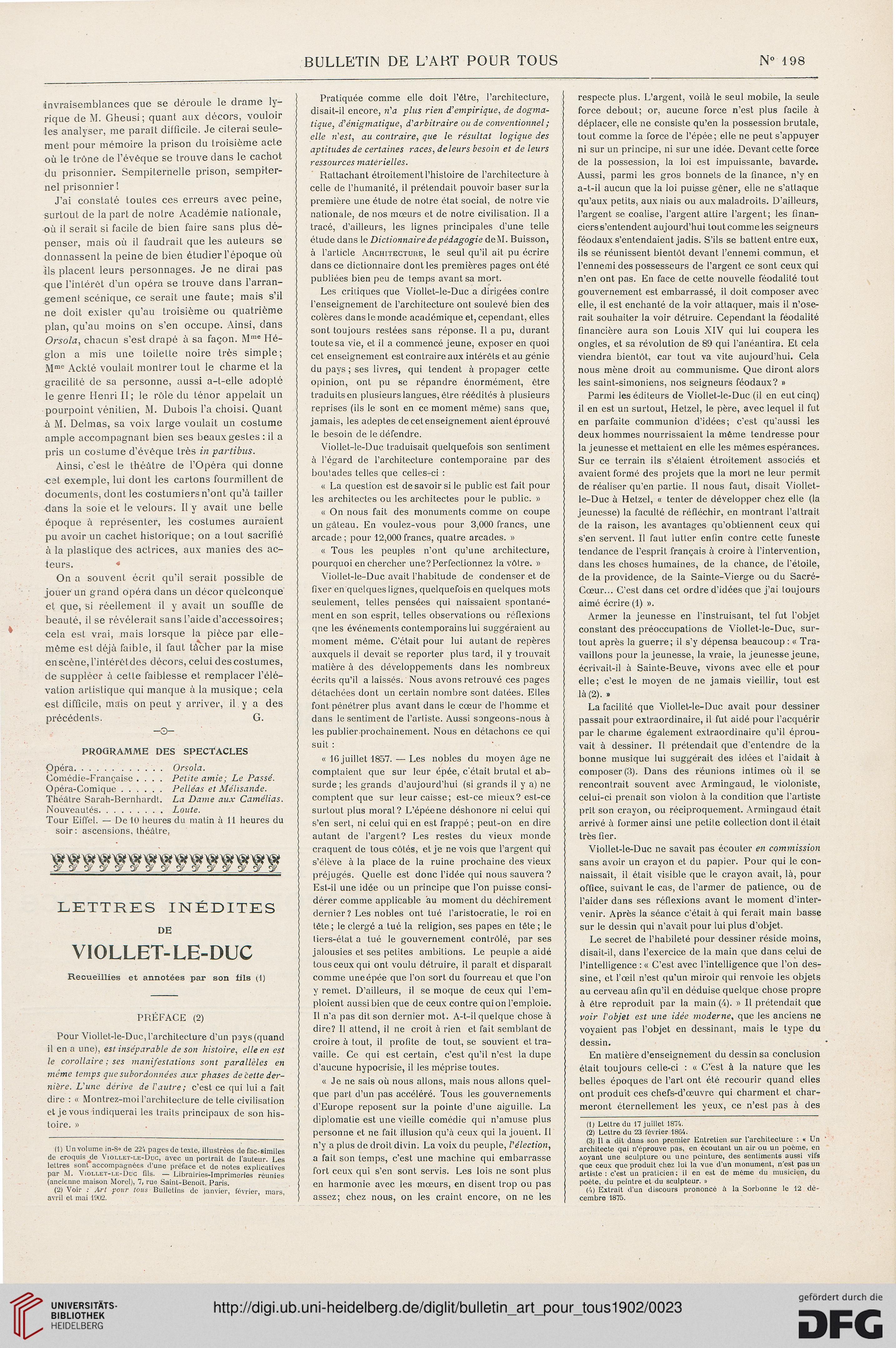BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
N° 198
invraisemblances que se déroule le drame ly-
rique de M. Gheusi; quant aux décors, vouloir
les analyser, me paraît difficile. Je citerai seule-
ment pour mémoire la prison du troisième acte
où le trône de l'évèque se trouve dans le cachot
du prisonnier. Sempiternelle prison, sempiter-
nel prisonnier !
J'ai constaté toutes ces erreurs avec peine,
surtout de la part de notre Académie nationale,
où il serait si facile de bien faire sans plus dé-
penser, mais où il faudrait que les auteurs se
donnassent la peine de bien étudier l'époque où
ils placent leurs personnages. Je ne dirai pas
que l'intérêt d'un opéra se trouve dans l'arran-
gement scénique, ce serait une faute; mais s'il
ne doit exister qu'au troisième ou quatrième
plan, qu'au moins on s'en occupe. Ainsi, dans
Orsola, chacun s'est drapé à sa façon. Mme Ilé-
gion a mis une toilette noire très simple;
Mme Acklé voulait montrer tout le charme et la
gracilité de sa personne, aussi a-t-elle adopté
le genre Henri II; le rôle du ténor appelait un
pourpoint vénitien, M. Dubois l'a choisi. Quant
à M. Delmas, sa voix large voulait un costume
ample accompagnant bien ses beaux gestes : il a
pris un costume d'évôque très in partibus.
Ainsi, c'est le théâtre de l'Opéra qui donne
•cet exemple, lui dont les cartons fourmillent de
documents, dont les costumiers n'ont qu'à tailler
■dans la soie et le velours. Il y avait une belle
époque à représenter, les costumes auraient
pu avoir un cachet historique; on a tout sacrifié
à la plastique des actrices, aux manies des ac-
teurs. «
On a souvent écrit qu'il serait possible de
jouer Un grand opéra clans un décor quelconque
et que, si réellement il y avait un souffle de
beauté, il se révélerait sans l'aide d'accessoires;
cela est vrai, mais lorsque la pièce par elle-
même est déjà faible, il faut tâcher par la mise
en scène, l'intérêtdes décors, celui des costumes,
de suppléer à cette faiblesse et remplacer l'élé-
vation artistique qui manque à la musique; cela
est difficile, mats on peut y arriver, il y a des
précédents. G.
-3-
PROGRAMME DES SPECTACLES
Opéra........... . Orsola.
Comédie-Française .... Petite amie; Le Passé.
Opéra-Comique...... Pelléas et Mélisande.
Théâtre Saràh-Bernhàrdt. La Dame aux Camélias.
Nouveautés.........Louie.
Tour Eiffel. — De 10 heures du matin à 11 heures du
soir: ascensions, théâtre,
LETTRES INÉDITES
DE
VIOLLET- LE-DUC
Recueillies et annotées par son fils (1)
PRÉFACE (2)
Pour Viollet-le-Duc, l'architecture d'un pays (quand
il en a une), est inséparable de son histoire, elle en est
le corollaire ; ses manifestations sont parallèles en
même temps que subordonnées aux phases de cette der-
nière. L'une dérive de Vautre; c'est ce qui lui a fait
dire : « Montrez-moi l'architecture dételle civilisation
et je vous indiquerai les traits principaux de son his-
toire. »
(1) Unvolume in-8° de 224 pages de texte, illustrées de fac-similés
de croquis ^de Viollet-le-Duc, avec un portrait de l'auteur. Les
lettres sont accompagnées d'une préface et de notes explicatives
par M. Viollet-le-Duc fils. — Librairies-Imprimeries réunies
(ancienne maison Morcl), 7, rue Saint-Benoît. Paris.
(2) Voir : Art pour tous Bulletins de janvier, février, mars
avril et mai !'J02.
1 Pratiquée comme elle doit l'être, l'architecture,
disait-il encore, n'a plus rien d'empirique, de dogma-
tique, d'énigmatique, d'arbitraire ou de conventionnel ;
elle n'est, au contraire, que le résultat logique des
aptitudes de certaines races, de leurs besoin et de leurs
ressources matérielles.
Rattachant étroitement l'histoire de l'architecture à
celle de l'humanité, il prétendait pouvoir baser sur la
première une étude de notre état social, de notre vie
nationale, de nos mœurs et de notre civilisation. 11 a
tracé, d'ailleurs, les lignes principales d'une telle
étude dans le Dictionnaire de pédagogie de M. Buisson,
à l'article Architecture, le seul qu'il ait pu écrire
dans ce dictionnaire dont les premières pages ont été
publiées bien peu de temps avant sa mort.
Les critiques que Viollet-le-Duc a dirigées contre
l'enseignement de l'architecture ont soulevé bien des
colères dans le monde académique et, cependant, elles
sont toujours restées sans réponse. Il a pu, durant
toute sa vie, et il a commencé jeune, exposer en quoi
cet enseignement est contraire aux intérêts et au génie
du pays ; ses livres, qui tendent à propager cette
opinion, ont pu se répandre énormément, être
traduits en plusieurs langues, être réédités à plusieurs
reprises (ils le sont en ce moment même) sans que,
jamais, les adeptes de cet enseignement aient éprouvé
le besoin de le défendre.
Viollet-lc-Duc traduisait quelquefois son sentiment
à l'égard de l'architecture contemporaine par des
boutades telles que celles-ci :
« La question est de savoir si le public est fait pour
les architectes ou les architectes pour le public. »
« On nous fait des monuments comme on coupe
un gâteau. En voulez-vous pour 3,000 francs, une
arcade; pour 12,000 francs, quatre arcades. »
« Tous les peuples n'ont qu'une architecture,
pourquoi en chercher une?Perfectionnez la vôtre. »
Viollet-le-Duc avait l'habitude de condenser et de
fixer en quelques lignes, quelquefois en quelques mots
seulement, telles pensées qui naissaient spontané-
ment en son esprit, telles observations ou réflexions
que les événements contemporains lui suggéraient au
moment même. C'était pour lui autant de repères
auxquels il devait se reporter plus tard, il y trouvait
matière à des développements dans les nombreux
écrits qu'il a laissés. Nous avons retrouvé ces pages
détachées dont un certain nombre sont datées. Elles
font pénétrer plus avant dans le cœur de l'homme et
dans le sentiment de l'artiste. Aussi songeons-nous à
les publier prochainement. Nous en détachons ce qui
suit :
« 16 juillet 1857. — Les nobles du moyen âge ne
comptaient que sur leur épée, c'était brutal et ab-
surde ; les grands d'aujourd'hui (si grands il y a) ne
; comptent que sur leur caisse; est-ce mieux? est-ce
surtout plus moral? L'épéene déshonore ni celui qui
s'en sert, ni celui qui en est frappé; peut-on en dire
autant de l'argent? Les restes du vieux monde
i craquent de tous côtés, et je ne vois que l'argent qui
s'élève à la place de la ruine prochaine des vieux
préjugés. Quelle est donc l'idée qui nous sauvera ?
Est-il une idée ou un principe que l'on puisse consi-
dérer comme applicable au moment du déchirement
dernier ? Les nobles ont tué l'aristocratie, le roi en
tête ; le clergé a tué la religion, ses papes en tête ; le
tiers-état a tué le gouvernement contrôlé, par ses
jalousies et ses petites ambitions. Le peuple a aidé
tous ceux qui ont voulu détruire, il paraît et disparait
\ comme uneépée que l'on sort du fourreau et que l'on
' y remet. D'ailleurs, il se moque de ceux qui l'em-
ploient aussi bien que de ceux contre qui on l'emploie.
Il n'a pas dit son dernier mot. A-t-il quelque chose à
dire? Il attend, il ne croit à rien et fait semblant de
croire à tout, il profite de tout, se souvient et tra-
vaille. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est la dupe
d'aucune hypocrisie, il les méprise toutes.
« Je ne sais où nous allons, mais nous allons quel-
que part d'un pas accéléré. Tous les gouvernements
d'Europe reposent sur la pointe d'une aiguille. La
diplomatie est une vieille comédie qui n'amuse plus
personne et ne fait illusion qu'à ceux qui la jouent. Il
n'y a plus de droit divin. La voix du peuple, l'élection,
a fait son temps, c'est une machine qui embarrasse
fort ceux qui s'en sont servis. Les lois ne sont plus
en harmonie avec les mœurs, en disent trop ou pas
J assez; chez nous, on les craint encore, on ne les
respecte plus. L'argent, voilà le seul mobile, la seule
force debout; or, aucune force n'est plus facile à
déplacer, elle ne consiste qu'en la possession brutale,
tout comme la force de l'épée; elle ne peut s'appuyer
ni sur un principe, ni sur une idée. Devant cette force
de la possession, la loi est impuissante, bavarde.
Aussi, parmi les gros bonnets de la finance, n'y en
a-t-il aucun que la loi puisse gêner, elle ne s'attaque
qu'aux petits, aux niais ou aux maladroits. D'ailleurs,
l'argent se coalise, l'argent attire l'argent; les finan-
ciers s'entendent aujourd'hui tout comme les seigneurs
féodaux s'entendaient jadis. S'ils se battent entre eux,
ils se réunissent bientôt devant l'ennemi commun, et
l'ennemi des possesseurs de l'argent ce sont ceux qui
n'en ont pas. En face de cette nouvelle féodalité tout
gouvernement est embarrassé, il doit composer avec
elle, il est enchanté de la voir attaquer, mais il n'ose-
rait souhaiter la voir détruire. Cependant la féodalité
financière aura son Louis XIV qui lui coupera les
ongles, et sa révolution de 89 qui l'anéantira. Et cela
viendra bientôt, car tout va vite aujourd'hui. Cela
nous mène droit au communisme. Que diront alors
les saint-simoniens, nos seigneurs féodaux? »
Parmi les éditeurs de Viollet-le-Duc (il en eut cinq)
il en est un surtout, Hetzel, le père, avec lequel il fut
en parfaite communion d'idées; c'est qu'aussi les
deux hommes nourrissaient la même tendresse pour
la jeunesse et mettaient en elle les mêmes espérances.
Sur ce terrain ils s'étaient étroitement associés et
avaient formé des projets que la mort ne leur permit
de réaliser qu'en partie. Il nous faut, disait Viollet-
le-Duc à Hetzel, « tenter de développer chez elle (la
jeunesse) la faculté de réfléchir, en montrant l'attrait
de la raison, les avantages qu'obtiennent ceux qui
s'en servent. Il faut lutter enfin contre cette funeste
tendance de l'esprit français à croire à l'intervention,
dans les choses humaines, de la chance, de l'étoile,
de la providence, de la Sainte-Vierge ou du Sacré-
Cœur... C'est dans cet ordre d'idées que j'ai toujours
aimé écrire (1) ».
Armer la jeunesse en l'instruisant, tel fut l'objet
constant des préoccupations de Viollet-le-Duc, sur-
tout après la guerre; il s'y dépensa beaucoup : « Tra-
vaillons pour la jeunesse, la vraie, la jeunesse jeune,
écrivait-il à Sainte-Beuve, vivons avec elle et pour
elle; c'est le moyen de ne jamais vieillir, tout est
là (2). »
La facilité que Viollet-le-Duc avait pour dessiner
passait pour extraordinaire, il fut aidé pour l'acquérir
par le charme également extraordinaire qu'il éprou-
vait à dessiner. Il prétendait que d'entendre de la
bonne musique lui suggérait des idées et l'aidait à
composerai). Dans des réunions intimes où il se
rencontrait souvent avec Armingaud, le violoniste,
celui-ci prenait son violon à la condition que l'artiste
prît son crayon, ou réciproquement. Armingaud était
arrivé à former ainsi une petite collection dont il était
très fier.
Viollet-le-Duc ne savait pas écouter en commission
sans avoir un crayon et du papier. Pour qui le con-
naissait, il était visible que le crayon avait, là, pour
office, suivant le cas, de l'armer de patience, ou de
l'aider dans ses réflexions avant le moment d'inter-
venir. Après la séance c'était à qui ferait main basse
sur le dessin qui n'avait pour lui plus d'objet.
Le secret de l'habileté pour dessiner réside moins,
disait-il, dans l'exercice de la main que dans celui de
l'intelligence : « C'est avec l'intelligence que l'on des-
sine, et l'œil n'est qu'un miroir qui renvoie les objets
au cerveau afin qu'il en déduise quelque chose propre
à être reproduit par la main (4). » Il prétendait que
voir l'objet est une idée moderne, que les anciens ne
voyaient pas l'objet en dessinant, mais le type du
dessin.
En matière d'enseignement du dessin sa conclusion
était toujours celle-ci : « C'est à la nature que les
belles époques de l'art ont été recourir quand elles
ont produit ces chefs-d'œuvre qui charment et char-
meront éternellement les yeux, ce n'est pas à des
(1) Lettre du 17 juillet 1874.
(2) Lettre du 23 février 1864.
(3) Il a dit dans son premier Entretien sur l'architecture : « Un
architecte qui n'éprouve pas, en écoutant un air ou un poème, en
voyant une sculpture ou une peinture, des sentiments aussi vifs
que ceux que produit chez lui la vue d'un monument, n'est pas un
artiste : c'est un praticien; il en est de même du musicien, du
poète, du peintre et du sculpteur. »
(4) Extrait d'un discours prononcé a la Sorbonne le 12 dé-
cembre 1875.
N° 198
invraisemblances que se déroule le drame ly-
rique de M. Gheusi; quant aux décors, vouloir
les analyser, me paraît difficile. Je citerai seule-
ment pour mémoire la prison du troisième acte
où le trône de l'évèque se trouve dans le cachot
du prisonnier. Sempiternelle prison, sempiter-
nel prisonnier !
J'ai constaté toutes ces erreurs avec peine,
surtout de la part de notre Académie nationale,
où il serait si facile de bien faire sans plus dé-
penser, mais où il faudrait que les auteurs se
donnassent la peine de bien étudier l'époque où
ils placent leurs personnages. Je ne dirai pas
que l'intérêt d'un opéra se trouve dans l'arran-
gement scénique, ce serait une faute; mais s'il
ne doit exister qu'au troisième ou quatrième
plan, qu'au moins on s'en occupe. Ainsi, dans
Orsola, chacun s'est drapé à sa façon. Mme Ilé-
gion a mis une toilette noire très simple;
Mme Acklé voulait montrer tout le charme et la
gracilité de sa personne, aussi a-t-elle adopté
le genre Henri II; le rôle du ténor appelait un
pourpoint vénitien, M. Dubois l'a choisi. Quant
à M. Delmas, sa voix large voulait un costume
ample accompagnant bien ses beaux gestes : il a
pris un costume d'évôque très in partibus.
Ainsi, c'est le théâtre de l'Opéra qui donne
•cet exemple, lui dont les cartons fourmillent de
documents, dont les costumiers n'ont qu'à tailler
■dans la soie et le velours. Il y avait une belle
époque à représenter, les costumes auraient
pu avoir un cachet historique; on a tout sacrifié
à la plastique des actrices, aux manies des ac-
teurs. «
On a souvent écrit qu'il serait possible de
jouer Un grand opéra clans un décor quelconque
et que, si réellement il y avait un souffle de
beauté, il se révélerait sans l'aide d'accessoires;
cela est vrai, mais lorsque la pièce par elle-
même est déjà faible, il faut tâcher par la mise
en scène, l'intérêtdes décors, celui des costumes,
de suppléer à cette faiblesse et remplacer l'élé-
vation artistique qui manque à la musique; cela
est difficile, mats on peut y arriver, il y a des
précédents. G.
-3-
PROGRAMME DES SPECTACLES
Opéra........... . Orsola.
Comédie-Française .... Petite amie; Le Passé.
Opéra-Comique...... Pelléas et Mélisande.
Théâtre Saràh-Bernhàrdt. La Dame aux Camélias.
Nouveautés.........Louie.
Tour Eiffel. — De 10 heures du matin à 11 heures du
soir: ascensions, théâtre,
LETTRES INÉDITES
DE
VIOLLET- LE-DUC
Recueillies et annotées par son fils (1)
PRÉFACE (2)
Pour Viollet-le-Duc, l'architecture d'un pays (quand
il en a une), est inséparable de son histoire, elle en est
le corollaire ; ses manifestations sont parallèles en
même temps que subordonnées aux phases de cette der-
nière. L'une dérive de Vautre; c'est ce qui lui a fait
dire : « Montrez-moi l'architecture dételle civilisation
et je vous indiquerai les traits principaux de son his-
toire. »
(1) Unvolume in-8° de 224 pages de texte, illustrées de fac-similés
de croquis ^de Viollet-le-Duc, avec un portrait de l'auteur. Les
lettres sont accompagnées d'une préface et de notes explicatives
par M. Viollet-le-Duc fils. — Librairies-Imprimeries réunies
(ancienne maison Morcl), 7, rue Saint-Benoît. Paris.
(2) Voir : Art pour tous Bulletins de janvier, février, mars
avril et mai !'J02.
1 Pratiquée comme elle doit l'être, l'architecture,
disait-il encore, n'a plus rien d'empirique, de dogma-
tique, d'énigmatique, d'arbitraire ou de conventionnel ;
elle n'est, au contraire, que le résultat logique des
aptitudes de certaines races, de leurs besoin et de leurs
ressources matérielles.
Rattachant étroitement l'histoire de l'architecture à
celle de l'humanité, il prétendait pouvoir baser sur la
première une étude de notre état social, de notre vie
nationale, de nos mœurs et de notre civilisation. 11 a
tracé, d'ailleurs, les lignes principales d'une telle
étude dans le Dictionnaire de pédagogie de M. Buisson,
à l'article Architecture, le seul qu'il ait pu écrire
dans ce dictionnaire dont les premières pages ont été
publiées bien peu de temps avant sa mort.
Les critiques que Viollet-le-Duc a dirigées contre
l'enseignement de l'architecture ont soulevé bien des
colères dans le monde académique et, cependant, elles
sont toujours restées sans réponse. Il a pu, durant
toute sa vie, et il a commencé jeune, exposer en quoi
cet enseignement est contraire aux intérêts et au génie
du pays ; ses livres, qui tendent à propager cette
opinion, ont pu se répandre énormément, être
traduits en plusieurs langues, être réédités à plusieurs
reprises (ils le sont en ce moment même) sans que,
jamais, les adeptes de cet enseignement aient éprouvé
le besoin de le défendre.
Viollet-lc-Duc traduisait quelquefois son sentiment
à l'égard de l'architecture contemporaine par des
boutades telles que celles-ci :
« La question est de savoir si le public est fait pour
les architectes ou les architectes pour le public. »
« On nous fait des monuments comme on coupe
un gâteau. En voulez-vous pour 3,000 francs, une
arcade; pour 12,000 francs, quatre arcades. »
« Tous les peuples n'ont qu'une architecture,
pourquoi en chercher une?Perfectionnez la vôtre. »
Viollet-le-Duc avait l'habitude de condenser et de
fixer en quelques lignes, quelquefois en quelques mots
seulement, telles pensées qui naissaient spontané-
ment en son esprit, telles observations ou réflexions
que les événements contemporains lui suggéraient au
moment même. C'était pour lui autant de repères
auxquels il devait se reporter plus tard, il y trouvait
matière à des développements dans les nombreux
écrits qu'il a laissés. Nous avons retrouvé ces pages
détachées dont un certain nombre sont datées. Elles
font pénétrer plus avant dans le cœur de l'homme et
dans le sentiment de l'artiste. Aussi songeons-nous à
les publier prochainement. Nous en détachons ce qui
suit :
« 16 juillet 1857. — Les nobles du moyen âge ne
comptaient que sur leur épée, c'était brutal et ab-
surde ; les grands d'aujourd'hui (si grands il y a) ne
; comptent que sur leur caisse; est-ce mieux? est-ce
surtout plus moral? L'épéene déshonore ni celui qui
s'en sert, ni celui qui en est frappé; peut-on en dire
autant de l'argent? Les restes du vieux monde
i craquent de tous côtés, et je ne vois que l'argent qui
s'élève à la place de la ruine prochaine des vieux
préjugés. Quelle est donc l'idée qui nous sauvera ?
Est-il une idée ou un principe que l'on puisse consi-
dérer comme applicable au moment du déchirement
dernier ? Les nobles ont tué l'aristocratie, le roi en
tête ; le clergé a tué la religion, ses papes en tête ; le
tiers-état a tué le gouvernement contrôlé, par ses
jalousies et ses petites ambitions. Le peuple a aidé
tous ceux qui ont voulu détruire, il paraît et disparait
\ comme uneépée que l'on sort du fourreau et que l'on
' y remet. D'ailleurs, il se moque de ceux qui l'em-
ploient aussi bien que de ceux contre qui on l'emploie.
Il n'a pas dit son dernier mot. A-t-il quelque chose à
dire? Il attend, il ne croit à rien et fait semblant de
croire à tout, il profite de tout, se souvient et tra-
vaille. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est la dupe
d'aucune hypocrisie, il les méprise toutes.
« Je ne sais où nous allons, mais nous allons quel-
que part d'un pas accéléré. Tous les gouvernements
d'Europe reposent sur la pointe d'une aiguille. La
diplomatie est une vieille comédie qui n'amuse plus
personne et ne fait illusion qu'à ceux qui la jouent. Il
n'y a plus de droit divin. La voix du peuple, l'élection,
a fait son temps, c'est une machine qui embarrasse
fort ceux qui s'en sont servis. Les lois ne sont plus
en harmonie avec les mœurs, en disent trop ou pas
J assez; chez nous, on les craint encore, on ne les
respecte plus. L'argent, voilà le seul mobile, la seule
force debout; or, aucune force n'est plus facile à
déplacer, elle ne consiste qu'en la possession brutale,
tout comme la force de l'épée; elle ne peut s'appuyer
ni sur un principe, ni sur une idée. Devant cette force
de la possession, la loi est impuissante, bavarde.
Aussi, parmi les gros bonnets de la finance, n'y en
a-t-il aucun que la loi puisse gêner, elle ne s'attaque
qu'aux petits, aux niais ou aux maladroits. D'ailleurs,
l'argent se coalise, l'argent attire l'argent; les finan-
ciers s'entendent aujourd'hui tout comme les seigneurs
féodaux s'entendaient jadis. S'ils se battent entre eux,
ils se réunissent bientôt devant l'ennemi commun, et
l'ennemi des possesseurs de l'argent ce sont ceux qui
n'en ont pas. En face de cette nouvelle féodalité tout
gouvernement est embarrassé, il doit composer avec
elle, il est enchanté de la voir attaquer, mais il n'ose-
rait souhaiter la voir détruire. Cependant la féodalité
financière aura son Louis XIV qui lui coupera les
ongles, et sa révolution de 89 qui l'anéantira. Et cela
viendra bientôt, car tout va vite aujourd'hui. Cela
nous mène droit au communisme. Que diront alors
les saint-simoniens, nos seigneurs féodaux? »
Parmi les éditeurs de Viollet-le-Duc (il en eut cinq)
il en est un surtout, Hetzel, le père, avec lequel il fut
en parfaite communion d'idées; c'est qu'aussi les
deux hommes nourrissaient la même tendresse pour
la jeunesse et mettaient en elle les mêmes espérances.
Sur ce terrain ils s'étaient étroitement associés et
avaient formé des projets que la mort ne leur permit
de réaliser qu'en partie. Il nous faut, disait Viollet-
le-Duc à Hetzel, « tenter de développer chez elle (la
jeunesse) la faculté de réfléchir, en montrant l'attrait
de la raison, les avantages qu'obtiennent ceux qui
s'en servent. Il faut lutter enfin contre cette funeste
tendance de l'esprit français à croire à l'intervention,
dans les choses humaines, de la chance, de l'étoile,
de la providence, de la Sainte-Vierge ou du Sacré-
Cœur... C'est dans cet ordre d'idées que j'ai toujours
aimé écrire (1) ».
Armer la jeunesse en l'instruisant, tel fut l'objet
constant des préoccupations de Viollet-le-Duc, sur-
tout après la guerre; il s'y dépensa beaucoup : « Tra-
vaillons pour la jeunesse, la vraie, la jeunesse jeune,
écrivait-il à Sainte-Beuve, vivons avec elle et pour
elle; c'est le moyen de ne jamais vieillir, tout est
là (2). »
La facilité que Viollet-le-Duc avait pour dessiner
passait pour extraordinaire, il fut aidé pour l'acquérir
par le charme également extraordinaire qu'il éprou-
vait à dessiner. Il prétendait que d'entendre de la
bonne musique lui suggérait des idées et l'aidait à
composerai). Dans des réunions intimes où il se
rencontrait souvent avec Armingaud, le violoniste,
celui-ci prenait son violon à la condition que l'artiste
prît son crayon, ou réciproquement. Armingaud était
arrivé à former ainsi une petite collection dont il était
très fier.
Viollet-le-Duc ne savait pas écouter en commission
sans avoir un crayon et du papier. Pour qui le con-
naissait, il était visible que le crayon avait, là, pour
office, suivant le cas, de l'armer de patience, ou de
l'aider dans ses réflexions avant le moment d'inter-
venir. Après la séance c'était à qui ferait main basse
sur le dessin qui n'avait pour lui plus d'objet.
Le secret de l'habileté pour dessiner réside moins,
disait-il, dans l'exercice de la main que dans celui de
l'intelligence : « C'est avec l'intelligence que l'on des-
sine, et l'œil n'est qu'un miroir qui renvoie les objets
au cerveau afin qu'il en déduise quelque chose propre
à être reproduit par la main (4). » Il prétendait que
voir l'objet est une idée moderne, que les anciens ne
voyaient pas l'objet en dessinant, mais le type du
dessin.
En matière d'enseignement du dessin sa conclusion
était toujours celle-ci : « C'est à la nature que les
belles époques de l'art ont été recourir quand elles
ont produit ces chefs-d'œuvre qui charment et char-
meront éternellement les yeux, ce n'est pas à des
(1) Lettre du 17 juillet 1874.
(2) Lettre du 23 février 1864.
(3) Il a dit dans son premier Entretien sur l'architecture : « Un
architecte qui n'éprouve pas, en écoutant un air ou un poème, en
voyant une sculpture ou une peinture, des sentiments aussi vifs
que ceux que produit chez lui la vue d'un monument, n'est pas un
artiste : c'est un praticien; il en est de même du musicien, du
poète, du peintre et du sculpteur. »
(4) Extrait d'un discours prononcé a la Sorbonne le 12 dé-
cembre 1875.