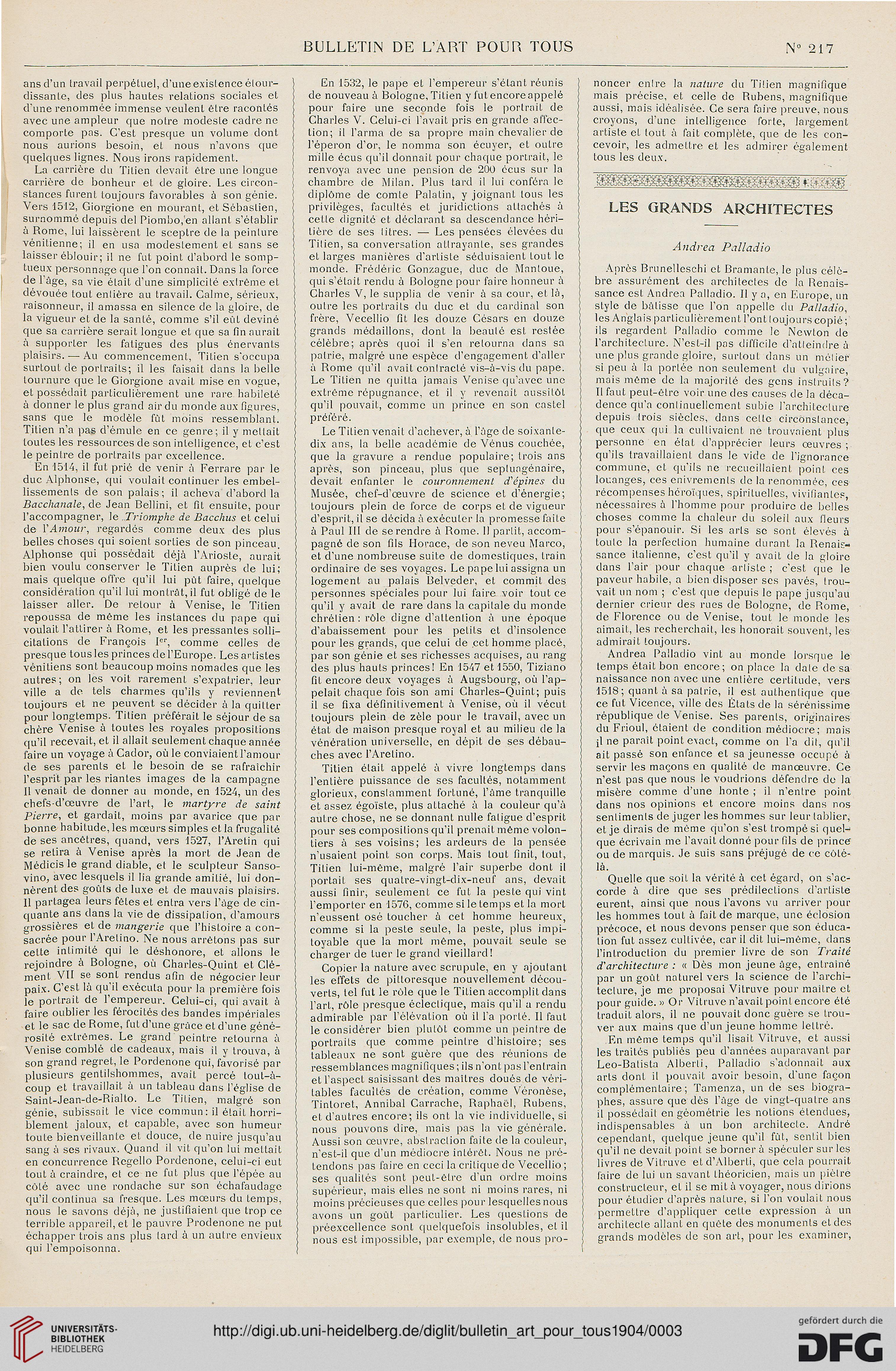BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
N0 2 1 7
ans d’un travail perpétuel, d’une existence étour- j
dissanie, des plus hautes relations sociales et
d’une renommée immense veulent être racontés !
avec une ampleur que noire modeste cadre ne
comporte pas. C’est presque un volume dont j
nous aurions besoin, et nous n’avons que
quelques lignes. Nous irons rapidement.
La carrière du Titien devait être une longue
carrière de bonheur et de gloire. Les circon- j
stances furent toujours favorables à son génie.
Vers 1512, Giorgione en mourant, et Sébastien, ;
surnommé depuis del Piombo,'en allant s’établir J
à Rome, lui laissèrent le sceptre de la peinture
vénitienne; il en usa modestement et sans se
laisser éblouir; il ne fut point d’abord le somp- !
tueux personnage que l’on connaît. Dans la force j
de l’âge, sa vie était d’une simplicité extrême et ;
dévouée tout entière au travail. Calme, sérieux, j
raisonneur, il amassa en silence de la gloire, de j
la vigueur et de la santé, comme s’il eùL deviné
que sa carrière serait longue et que sa fin aurait )
à supporter les fatigues des plus énervants ;
plaisirs. •— Au commencement, Titien s'occupa j
surtout de portraits; il les faisait dans la belle !
tournure que le Giorgione avait mise en vogue,
et possédait particulièrement une rare habileté j
à donner le plus grand air du monde aux figures, !
sans que le modèle fût moins ressemblant, j
Titien n’a pas d’émule en ce genre; il y mettait )
toutes les ressources de son intelligence, et c’est
le peintre de portraits par excellence.
En 1514, il fut prié de venir à Ferrare par le J
duc Alphonse, qui voulait continuer les embel-
lissements de son palais; il acheva d’abord la
Bacchanale, de Jean Bellini, et fit ensuite, pour
l’accompagner, le Triomphe de Bacchns et celui î
de F Amour, regardés comme deux des plus
belles choses qui soient sorties de son pinceau.
Alphonse qui possédait déjà l’Arioste, aurait
bien voulu conserver le Titien auprès de lui; ■;
mais quelque offre qu’il lui pût faire, quelque
considération qu’il lui montrât, il fut obligé de le
laisser aller. De retour à Venise, le Titien
repoussa de même les instances du pape qui
voulait l’attirer à Rome, et les pressantes solli-
citations de François Ier, comme celles de j
presque tous les princes de l’Europe. Les artistes j
vénitiens sont beaucoup moins nomades que les
autres; on les voit rarement s’expatrier, leur
ville a de tels charmes qu’ils y reviennent J
toujours et ne peuvent se décider à la quitter
pour longtemps. Titien préférait le séjour de sa j
chère Venise à toutes les royales propositions
qu’il recevait, et il allait seulement chaque année
faire un voyage à Cador, où le conviaient l’amour j
de ses parents et le besoin de se rafraîchir
l’esprit par les riantes images de la campagne
Il venait de donner au monde, en 1524, un des !
chefs-d’œuvre de Fart, le martyre de saint j
Pierre, et gardait, moins par avarice que par j
bonne habitude, les mœurs simples et la frugalité
de ses ancêtres, quand, vers 1527, l’Aretin qui j
se retira à Venise après la mort de Jean de
Médicis le grand diable, et le sculpteur Sanso- j
vino, avec lesquels il lia grande amitié, lui don- j
nèrent des goûts de luxe et de mauvais plaisirs, j
11 partagea leurs fêles et entra vers l’âge de ein-
quante ans dans la vie de dissipation, d’amours
grossières et de mangerie que l’histoire a con-
sacrée pour l’Arelino. Ne nous arrêtons pas sur
cette intimité qui le déshonore, et allons le [
rejoindre à Bologne, où Charles-Quint et Clé-
ment VII se sont rendus afin de négocier leur
paix. C’est la qu il exécuta pour la première fois j
le portrait de l’empereur. Celui-ci, qui avait à
faire oublier les férocités des bandes impériales
et le sac de Rome, fut d’une grâce et d’une géné-
rosité extrêmes. Le grand peintre retourna à
Venise comblé de cadeaux, mais il y trouva, à
son grand regret, le Pordenone qui, favorisé par
plusieurs gentilshommes, avait percé tout-à-
coup et travaillait à un tableau dans l’église de
Saint-Jean-de-Rialto. Le Titien, malgré son
génie, subissait le vice commun : il était horri-
blement jaloux, et capable, avec son humeur
toute bienveillante et douce, de nuire jusqu’au j
sang à ses rivaux. Quand il vit qu’on lui mettait
en concurrence Regello Pordenone, celui-ci eut
tout à craindre, cl ce ne fut plus que l’épée au j
côlé avec une rondache sur son échafaudage
qu’il continua sa fresque. Les mœurs du temps,
nous le savons déjà, ne justifiaient que trop ce
terrible appareil, et le pauvre Prodenone ne put j
échapper trois ans plus lard à un autre envieux
qui l’empoisonna. j
En 1532, le pape et l’empereur s’étant réunis
de nouveau à Bologne, Titien y fut encore appelé
pour faire une seconde fois le portrait de
Charles V. Celui-ci l’avait pris en grande affec-
tion; il l’arma de sa propre main chevalier de
l’éperon d’or, le nomma son écuyer, et outre
mille écus qu’il donnait pour chaque portrait, le
renvoya avec une pension de 200 écus sur la
chambre de Milan. Plus tard il lui conféra le
diplôme de comte Palatin, y joignant tous les
privilèges, facultés et juridictions attachés à
cette dignité et déclarant sa descendance héri-
tière de ses titres. — Les pensées élevées du
Titien, sa conversation attrayante, ses grandes
et larges manières d’artiste séduisaient tout le
monde. Frédéric Gonzague, duc de Mnntoue,
qui s’était rendu à Bologne pour faire honneur à
Charles V, le supplia de venir à sa cour, et là,
outre les portraits du duc et du cardinal son
frère, Vecellio fit les douze Césars en douze
grands médaillons, dont la beauté est restée
célèbre; après quoi il s’en retourna dans sa
patrie, malgré une espèce d’engagement d’aller
à Rome qu’il avait contracté vis-à-vis du pape.
Le Titien ne quitta jamais Venise qu’avec une
extrême répugnance, et il y revenait aussitôt
qu’il pouvait, comme un prince en son castel
préféré.
Le Titien venait d’achever, à l’âge de soixante-
dix ans, la belle academie de Vénus couchée,
que la gravure a rendue populaire; trois ans
après, son pinceau, plus que septuagénaire,
devait enfanter le couronnement d'épines du
Musée, chef-d’œuvre de science et d’énergie;
toujours plein de force de corps et de vigueur
d’esprit, il se décida à exécuter la promesse faite
à Paul III de se rendre à Rome. 11 partit, accom-
pagné de son fils Horace, de son neveu Marco,
et d’une nombreuse suite de domestiques, train
ordinaire de ses voyages. Le pape lui assigna un
logement au palais Belveder, et commit des
personnes spéciales pour lui faire voir tout ce
qu’il y avait de rare dans la capitale du monde
chrétien : rôle digne d’attention à une époque
d’abaissement pour les petits et d’insolence
pour les grands, que celui de ,cet homme placé,
par son génie et ses richesses acquises, au rang
des plus hauts princes! En 1547 et 1550, Tiziano
fit encore deux voyages à Augsbourg, où l’ap-
pelait chaque fois son ami Charles-Quint; puis
il se fixa définitivement à Venise, où il vécut
toujours plein de zèle pour le travail, avec un
état de maison presque royal et au milieu de la
vénération universelle, en dépit de ses débau-
ches avec. l’Aretino.
Titien était appelé à vivre longtemps dans
l’entière puissance de ses facultés, notamment
glorieux, constamment fortuné, l’âme tranquille
et assez égoïste, plus attaché à la couleur qu’à
autre chose, ne se donnant nulle fatigue d’esprit
pour ses compositions qu’il prenait même volon-
tiers à ses voisins; les ardeurs de la pensée
n’usaient point son corps. Mais tout finit, tout,
Titien lui-même, malgré l’air superbe dont il
portait ses quatre-vingt-dix-neuf ans, devait
aussi finir, seulement ce fut la peste qui vint
l’emporter en 1576, comme si le temps et la mort
n’eussent osé loucher à cet homme heureux,
comme si la peste seule, la peste, plus impi-
toyable que la mort même, pouvait seule se
charger de tuer le grand vieillard!
Copier la nature avec scrupule, en y ajoutanL
les effets de pittoresque nouvellement décou-
verts, tel fut le rôle que le Titien accomplit dans
l’art, rôle presque éclectique, mais qu’il a rendu
admirable par l’élévation où il Fa porté. Il faut
le considérer bien plutôt comme un peintre de
portraits que comme peintre d’histoire; ses
tableaux ne sont guère que des réunions de
ressemblances magnifiques; ils n’ont pas l’entrain
et l’aspect saisissant des maîtres doués de véri-
tables facultés de création, comme Véronèse,
Tinloret, Annibal Carrache, Raphaël, Rubens,
et d’autres encore; ils ont la vie individuelle, si
nous pouvons dire, mais pas la vie générale.
Aussi son œuvre, abstraction faite de la couleur,
n’est-il que d’un médiocre intérêt. Nous ne pré-
tendons pas faire en ceci la critique de Vecellio ;
ses qualités sont peut-être cl’un ordre moins
supérieur, mais elles ne sont ni moins rares, ni
moins précieuses que celles pour lesquelles nous
avons un goût particulier. Les questions de
préexcellence sont quelquefois insolubles, et il
nous est impossible, par exemple, de nous pro-
noncer entre la nature du Titien magnifique
mais précise, et celle de Rubens, magnifique
aussi, mais idéalisée. Ce sera faire preuve, nous
croyons, d’une intelligence forte, largement
artiste et tout à fait complète, que de les con-
cevoir, les admettre et les admirer également
tous les deux.
LES GRANDS ARCHITECTES
Andrea Palladio
Après Brunelleschi et Bramante, le plus célè-
bre assurément des architectes de la Renais-
\ sance est Andrea Palladio. Il y a, en Europe, un
| style de bâtisse que l’on appelle du Palladio,
j les Anglais particulièrement Font toujours copié;
' ils regardent Palladio comme le Newton de
; l’architecture. N’est-il pas difficile d’atleindre à
5 une plus grande gloire, surtout dans un métier
j si peu à la portée non seulement du vulgaire,
mais même de la majorité des gens instruits?
I II faut peut-être voir une des causes de la déca-
j dence qu’a continuellement subie l’architecture
\ depuis trois siècles, dans cette circonstance,
j que ceux qui la cultivaient ne trouvaient plus
personne en état d’apprécier leurs œuvres ;
qu’ils travaillaient dans le vide de l’ignorance
j commune, et qu’ils ne recueillaient point ces
! louanges, ces enivrements de la renommée, ces
; récompenses héroïques, spirituelles, vivifiantes,
nécessaires à l'homme pour produire de belles
j choses comme la chaleur du soleil aux fleurs
pour s’épanouir. Si les arts se sont élevés à
toute la perfection humaine durant la Renais-
J sance italienne, c’est qu’il y avait de la gloire
; dans l’air pour chaque artiste ; c'est que le
j paveur habile, a bien disposer scs pavés, trou-
| vait un nom ; c’est que depuis le pape jusqu’au
J dernier crieur des rues de Bologne, de Rome,
| de Florence ou de Venise, tout le monde les
| aimait, les recherchait, les honorait souvent, les
| admirait toujours.
j Andrea Palladio vint au monde lorsque le
temps était bon encore; on place la date de sa
naissance non avec une entière certitude, vers
j 1518; quant à sa patrie, il est authentique que
ce fut Vicence, ville des États de la sérénissime
république de Venise. Ses parents, originaires
! du Frioul, étaient de condition médiocre; mais
| ;1 ne parait point exact, comme on Fa dit, qu’il
: ait passé son enfance et sa jeunesse occupé à
; servir les maçons en qualité de manœuvre. Ce
j n’est pas que nous le voudrions défendre do la
misère comme d’une honte ; il n’entre point
dans nos opinions et encore moins dans nos
! sentiments de juger les hommes sur leur tablier,
et je dirais de même qu’on s’est trompé si quel-
que écrivain me l’avait donné pour fils de prince
j ou de marquis. Je suis sans préjugé de ce côté-
j là.
Quelle que soit la vérité à cet égard, on s’ac-
\ corde à dire que ses prédilections d’artiste
i eurent, ainsi que nous l’avons vu arriver pour
) les hommes tout à fait de marque, une éclosion
j précoce, et nous devons penser que son éduca-
j lion fut assez cultivée, car il dit lui-même, dans
l’introduction du premier livre de son Traité
j d'architecture : « Dès mon jeune âge, entraîné
i par un goût naturel vers la science de l’archi-
; tecture, je me proposai Vitruve pour maître et
’ pour guide. » Or Vitruve n’avait point encore été
! traduit alors, il ne pouvait donc guère se Lrou-
\ ver aux mains que d’un jeune homme lettré.
En même temps qu’il lisait Vitruve, et aussi
les traités publiés peu d’années auparavant par
Leo-Batista Alberti, Palladio s’adonnait aux
arts dont il pouvait avoir besoin, d’une façon
complémentaire; Tamenza, un de ses biogra-
- phes, assure que dès l’âge de vingt-quatre ans
i il possédait en géométrie les notions étendues,
! indispensables à un bon architecte. André
\ cependant, quelque jeune qu’il fût, sentit bien
! qu’il ne devait point se borner à spéculer sur les
i livres de Vitruve etd’Alberti, que cela pourrait
j faire de lui un savant théoricien, mais un piètre
I constructeur, et il se mit à voyager, nous dirions
j pour étudier d’après nature, si l’on voulait nous
! permettre d’appliquer cette expression à un
| architecte allant en quête des monuments et des
: grands modèles de son art, pour les examiner,
i
N0 2 1 7
ans d’un travail perpétuel, d’une existence étour- j
dissanie, des plus hautes relations sociales et
d’une renommée immense veulent être racontés !
avec une ampleur que noire modeste cadre ne
comporte pas. C’est presque un volume dont j
nous aurions besoin, et nous n’avons que
quelques lignes. Nous irons rapidement.
La carrière du Titien devait être une longue
carrière de bonheur et de gloire. Les circon- j
stances furent toujours favorables à son génie.
Vers 1512, Giorgione en mourant, et Sébastien, ;
surnommé depuis del Piombo,'en allant s’établir J
à Rome, lui laissèrent le sceptre de la peinture
vénitienne; il en usa modestement et sans se
laisser éblouir; il ne fut point d’abord le somp- !
tueux personnage que l’on connaît. Dans la force j
de l’âge, sa vie était d’une simplicité extrême et ;
dévouée tout entière au travail. Calme, sérieux, j
raisonneur, il amassa en silence de la gloire, de j
la vigueur et de la santé, comme s’il eùL deviné
que sa carrière serait longue et que sa fin aurait )
à supporter les fatigues des plus énervants ;
plaisirs. •— Au commencement, Titien s'occupa j
surtout de portraits; il les faisait dans la belle !
tournure que le Giorgione avait mise en vogue,
et possédait particulièrement une rare habileté j
à donner le plus grand air du monde aux figures, !
sans que le modèle fût moins ressemblant, j
Titien n’a pas d’émule en ce genre; il y mettait )
toutes les ressources de son intelligence, et c’est
le peintre de portraits par excellence.
En 1514, il fut prié de venir à Ferrare par le J
duc Alphonse, qui voulait continuer les embel-
lissements de son palais; il acheva d’abord la
Bacchanale, de Jean Bellini, et fit ensuite, pour
l’accompagner, le Triomphe de Bacchns et celui î
de F Amour, regardés comme deux des plus
belles choses qui soient sorties de son pinceau.
Alphonse qui possédait déjà l’Arioste, aurait
bien voulu conserver le Titien auprès de lui; ■;
mais quelque offre qu’il lui pût faire, quelque
considération qu’il lui montrât, il fut obligé de le
laisser aller. De retour à Venise, le Titien
repoussa de même les instances du pape qui
voulait l’attirer à Rome, et les pressantes solli-
citations de François Ier, comme celles de j
presque tous les princes de l’Europe. Les artistes j
vénitiens sont beaucoup moins nomades que les
autres; on les voit rarement s’expatrier, leur
ville a de tels charmes qu’ils y reviennent J
toujours et ne peuvent se décider à la quitter
pour longtemps. Titien préférait le séjour de sa j
chère Venise à toutes les royales propositions
qu’il recevait, et il allait seulement chaque année
faire un voyage à Cador, où le conviaient l’amour j
de ses parents et le besoin de se rafraîchir
l’esprit par les riantes images de la campagne
Il venait de donner au monde, en 1524, un des !
chefs-d’œuvre de Fart, le martyre de saint j
Pierre, et gardait, moins par avarice que par j
bonne habitude, les mœurs simples et la frugalité
de ses ancêtres, quand, vers 1527, l’Aretin qui j
se retira à Venise après la mort de Jean de
Médicis le grand diable, et le sculpteur Sanso- j
vino, avec lesquels il lia grande amitié, lui don- j
nèrent des goûts de luxe et de mauvais plaisirs, j
11 partagea leurs fêles et entra vers l’âge de ein-
quante ans dans la vie de dissipation, d’amours
grossières et de mangerie que l’histoire a con-
sacrée pour l’Arelino. Ne nous arrêtons pas sur
cette intimité qui le déshonore, et allons le [
rejoindre à Bologne, où Charles-Quint et Clé-
ment VII se sont rendus afin de négocier leur
paix. C’est la qu il exécuta pour la première fois j
le portrait de l’empereur. Celui-ci, qui avait à
faire oublier les férocités des bandes impériales
et le sac de Rome, fut d’une grâce et d’une géné-
rosité extrêmes. Le grand peintre retourna à
Venise comblé de cadeaux, mais il y trouva, à
son grand regret, le Pordenone qui, favorisé par
plusieurs gentilshommes, avait percé tout-à-
coup et travaillait à un tableau dans l’église de
Saint-Jean-de-Rialto. Le Titien, malgré son
génie, subissait le vice commun : il était horri-
blement jaloux, et capable, avec son humeur
toute bienveillante et douce, de nuire jusqu’au j
sang à ses rivaux. Quand il vit qu’on lui mettait
en concurrence Regello Pordenone, celui-ci eut
tout à craindre, cl ce ne fut plus que l’épée au j
côlé avec une rondache sur son échafaudage
qu’il continua sa fresque. Les mœurs du temps,
nous le savons déjà, ne justifiaient que trop ce
terrible appareil, et le pauvre Prodenone ne put j
échapper trois ans plus lard à un autre envieux
qui l’empoisonna. j
En 1532, le pape et l’empereur s’étant réunis
de nouveau à Bologne, Titien y fut encore appelé
pour faire une seconde fois le portrait de
Charles V. Celui-ci l’avait pris en grande affec-
tion; il l’arma de sa propre main chevalier de
l’éperon d’or, le nomma son écuyer, et outre
mille écus qu’il donnait pour chaque portrait, le
renvoya avec une pension de 200 écus sur la
chambre de Milan. Plus tard il lui conféra le
diplôme de comte Palatin, y joignant tous les
privilèges, facultés et juridictions attachés à
cette dignité et déclarant sa descendance héri-
tière de ses titres. — Les pensées élevées du
Titien, sa conversation attrayante, ses grandes
et larges manières d’artiste séduisaient tout le
monde. Frédéric Gonzague, duc de Mnntoue,
qui s’était rendu à Bologne pour faire honneur à
Charles V, le supplia de venir à sa cour, et là,
outre les portraits du duc et du cardinal son
frère, Vecellio fit les douze Césars en douze
grands médaillons, dont la beauté est restée
célèbre; après quoi il s’en retourna dans sa
patrie, malgré une espèce d’engagement d’aller
à Rome qu’il avait contracté vis-à-vis du pape.
Le Titien ne quitta jamais Venise qu’avec une
extrême répugnance, et il y revenait aussitôt
qu’il pouvait, comme un prince en son castel
préféré.
Le Titien venait d’achever, à l’âge de soixante-
dix ans, la belle academie de Vénus couchée,
que la gravure a rendue populaire; trois ans
après, son pinceau, plus que septuagénaire,
devait enfanter le couronnement d'épines du
Musée, chef-d’œuvre de science et d’énergie;
toujours plein de force de corps et de vigueur
d’esprit, il se décida à exécuter la promesse faite
à Paul III de se rendre à Rome. 11 partit, accom-
pagné de son fils Horace, de son neveu Marco,
et d’une nombreuse suite de domestiques, train
ordinaire de ses voyages. Le pape lui assigna un
logement au palais Belveder, et commit des
personnes spéciales pour lui faire voir tout ce
qu’il y avait de rare dans la capitale du monde
chrétien : rôle digne d’attention à une époque
d’abaissement pour les petits et d’insolence
pour les grands, que celui de ,cet homme placé,
par son génie et ses richesses acquises, au rang
des plus hauts princes! En 1547 et 1550, Tiziano
fit encore deux voyages à Augsbourg, où l’ap-
pelait chaque fois son ami Charles-Quint; puis
il se fixa définitivement à Venise, où il vécut
toujours plein de zèle pour le travail, avec un
état de maison presque royal et au milieu de la
vénération universelle, en dépit de ses débau-
ches avec. l’Aretino.
Titien était appelé à vivre longtemps dans
l’entière puissance de ses facultés, notamment
glorieux, constamment fortuné, l’âme tranquille
et assez égoïste, plus attaché à la couleur qu’à
autre chose, ne se donnant nulle fatigue d’esprit
pour ses compositions qu’il prenait même volon-
tiers à ses voisins; les ardeurs de la pensée
n’usaient point son corps. Mais tout finit, tout,
Titien lui-même, malgré l’air superbe dont il
portait ses quatre-vingt-dix-neuf ans, devait
aussi finir, seulement ce fut la peste qui vint
l’emporter en 1576, comme si le temps et la mort
n’eussent osé loucher à cet homme heureux,
comme si la peste seule, la peste, plus impi-
toyable que la mort même, pouvait seule se
charger de tuer le grand vieillard!
Copier la nature avec scrupule, en y ajoutanL
les effets de pittoresque nouvellement décou-
verts, tel fut le rôle que le Titien accomplit dans
l’art, rôle presque éclectique, mais qu’il a rendu
admirable par l’élévation où il Fa porté. Il faut
le considérer bien plutôt comme un peintre de
portraits que comme peintre d’histoire; ses
tableaux ne sont guère que des réunions de
ressemblances magnifiques; ils n’ont pas l’entrain
et l’aspect saisissant des maîtres doués de véri-
tables facultés de création, comme Véronèse,
Tinloret, Annibal Carrache, Raphaël, Rubens,
et d’autres encore; ils ont la vie individuelle, si
nous pouvons dire, mais pas la vie générale.
Aussi son œuvre, abstraction faite de la couleur,
n’est-il que d’un médiocre intérêt. Nous ne pré-
tendons pas faire en ceci la critique de Vecellio ;
ses qualités sont peut-être cl’un ordre moins
supérieur, mais elles ne sont ni moins rares, ni
moins précieuses que celles pour lesquelles nous
avons un goût particulier. Les questions de
préexcellence sont quelquefois insolubles, et il
nous est impossible, par exemple, de nous pro-
noncer entre la nature du Titien magnifique
mais précise, et celle de Rubens, magnifique
aussi, mais idéalisée. Ce sera faire preuve, nous
croyons, d’une intelligence forte, largement
artiste et tout à fait complète, que de les con-
cevoir, les admettre et les admirer également
tous les deux.
LES GRANDS ARCHITECTES
Andrea Palladio
Après Brunelleschi et Bramante, le plus célè-
bre assurément des architectes de la Renais-
\ sance est Andrea Palladio. Il y a, en Europe, un
| style de bâtisse que l’on appelle du Palladio,
j les Anglais particulièrement Font toujours copié;
' ils regardent Palladio comme le Newton de
; l’architecture. N’est-il pas difficile d’atleindre à
5 une plus grande gloire, surtout dans un métier
j si peu à la portée non seulement du vulgaire,
mais même de la majorité des gens instruits?
I II faut peut-être voir une des causes de la déca-
j dence qu’a continuellement subie l’architecture
\ depuis trois siècles, dans cette circonstance,
j que ceux qui la cultivaient ne trouvaient plus
personne en état d’apprécier leurs œuvres ;
qu’ils travaillaient dans le vide de l’ignorance
j commune, et qu’ils ne recueillaient point ces
! louanges, ces enivrements de la renommée, ces
; récompenses héroïques, spirituelles, vivifiantes,
nécessaires à l'homme pour produire de belles
j choses comme la chaleur du soleil aux fleurs
pour s’épanouir. Si les arts se sont élevés à
toute la perfection humaine durant la Renais-
J sance italienne, c’est qu’il y avait de la gloire
; dans l’air pour chaque artiste ; c'est que le
j paveur habile, a bien disposer scs pavés, trou-
| vait un nom ; c’est que depuis le pape jusqu’au
J dernier crieur des rues de Bologne, de Rome,
| de Florence ou de Venise, tout le monde les
| aimait, les recherchait, les honorait souvent, les
| admirait toujours.
j Andrea Palladio vint au monde lorsque le
temps était bon encore; on place la date de sa
naissance non avec une entière certitude, vers
j 1518; quant à sa patrie, il est authentique que
ce fut Vicence, ville des États de la sérénissime
république de Venise. Ses parents, originaires
! du Frioul, étaient de condition médiocre; mais
| ;1 ne parait point exact, comme on Fa dit, qu’il
: ait passé son enfance et sa jeunesse occupé à
; servir les maçons en qualité de manœuvre. Ce
j n’est pas que nous le voudrions défendre do la
misère comme d’une honte ; il n’entre point
dans nos opinions et encore moins dans nos
! sentiments de juger les hommes sur leur tablier,
et je dirais de même qu’on s’est trompé si quel-
que écrivain me l’avait donné pour fils de prince
j ou de marquis. Je suis sans préjugé de ce côté-
j là.
Quelle que soit la vérité à cet égard, on s’ac-
\ corde à dire que ses prédilections d’artiste
i eurent, ainsi que nous l’avons vu arriver pour
) les hommes tout à fait de marque, une éclosion
j précoce, et nous devons penser que son éduca-
j lion fut assez cultivée, car il dit lui-même, dans
l’introduction du premier livre de son Traité
j d'architecture : « Dès mon jeune âge, entraîné
i par un goût naturel vers la science de l’archi-
; tecture, je me proposai Vitruve pour maître et
’ pour guide. » Or Vitruve n’avait point encore été
! traduit alors, il ne pouvait donc guère se Lrou-
\ ver aux mains que d’un jeune homme lettré.
En même temps qu’il lisait Vitruve, et aussi
les traités publiés peu d’années auparavant par
Leo-Batista Alberti, Palladio s’adonnait aux
arts dont il pouvait avoir besoin, d’une façon
complémentaire; Tamenza, un de ses biogra-
- phes, assure que dès l’âge de vingt-quatre ans
i il possédait en géométrie les notions étendues,
! indispensables à un bon architecte. André
\ cependant, quelque jeune qu’il fût, sentit bien
! qu’il ne devait point se borner à spéculer sur les
i livres de Vitruve etd’Alberti, que cela pourrait
j faire de lui un savant théoricien, mais un piètre
I constructeur, et il se mit à voyager, nous dirions
j pour étudier d’après nature, si l’on voulait nous
! permettre d’appliquer cette expression à un
| architecte allant en quête des monuments et des
: grands modèles de son art, pour les examiner,
i