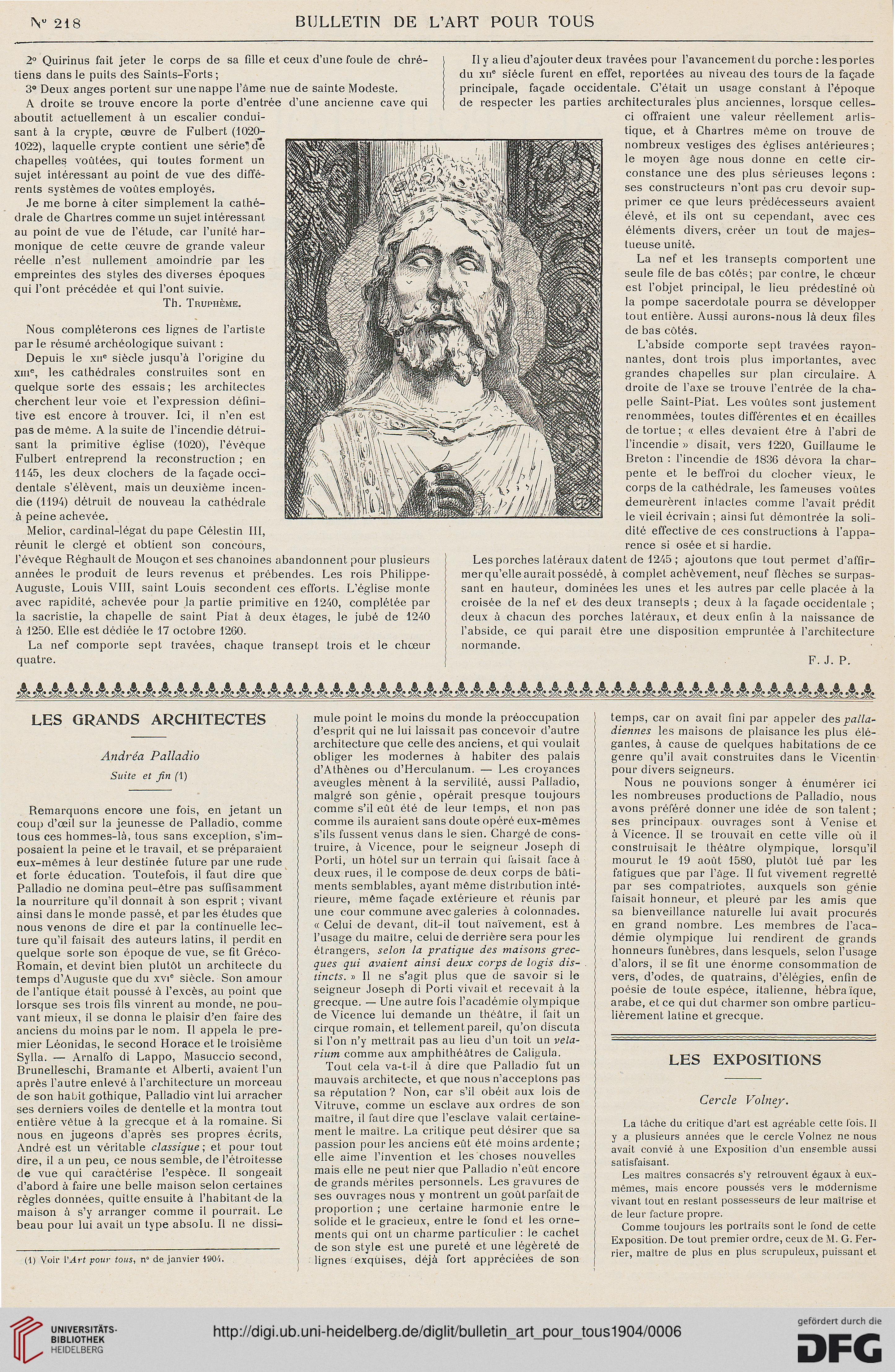V 218
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
2° Quirinus fait jeter le corps de sa fille et ceux d’une foule de chré-
tiens dans le puits des Saints-Forts;
3° Deux anges portent sur une nappe l’âme nue de sainte Modeste.
A droite se trouve encore la porte d’entrée d’une ancienne cave qui
aboutit actuellement à un escalier condui-
sant à la crypte, œuvre de Fulbert (1020-
1022), laquelle crypte contient une série’1.de
chapelles voûtées, qui toutes forment un
sujet intéressant au point de vue des diffé-
rents systèmes de voûtes employés.
Je me borne à citer simplement la cathé-
drale de Chartres comme un sujet intéressant
au point de vue de l’étude, car l’unité har-
monique de cette œuvre de grande valeur
réelle n’est nullement amoindrie par les
empreintes des styles des diverses époques
qui l’ont précédée et qui l’ont suivie.
Th. Trupiième.
Nous compléterons ces lignes de l’artiste
par le résumé archéologique suivant :
Depuis le xue siècle jusqu’à l’origine du
xine, les cathédrales construites sont en
quelque sorte des essais; les architectes
cherchent leur voie et l’expression défini-
tive est encore à trouver. Ici, il n’en est
pas de même. A la suite de l’incendie détrui-
sant la primitive église (1020), l’évêque
Fulbert entreprend la reconstruction ; en
1145, les deux clochers de la façade occi-
dentale s’élèvent, mais un deuxième incen-
die (1194) détruit de nouveau la cathédrale
à peine achevée.
Melior, cardinal-légat du pape Gélestin III,
réunit le clergé et obtient son concours,
l’évêque Réghaullde Mouçon et ses chanoines abandonnent pour plusieurs
années le produit de leurs revenus et prébendes. Les rois Philippe-
Auguste, Louis VIII, saint Louis secondent ces efforts. L’église monte
avec rapidité, achevée pour la partie primitive en 1240, complétée par
la sacristie, la chapelle de saint Pial à deux étages, le jubé de 1240
à 1250. Elle est dédiée le 17 octobre 1260.
La nef comporte sept travées, chaque transept trois et le chœur
quatre.
Il y a lieu d’ajouter deux travées pour l’avancement du porche : les portes
du xue siècle furent en effet, reportées au niveau des tours de la façade
principale, façade occidentale. C’était un usage constant à l’époque
de respecter les parties architecturales plus anciennes, lorsque celles-
ci offraient une valeur réellement artis-
tique, et à Chartres même on trouve de
nombreux vestiges des églises antérieures ;
le moyen âge nous donne en cette cir-
constance une des plus sérieuses leçons :
ses constructeurs n’ont pas cru devoir sup-
primer ce que leurs prédécesseurs avaient
élevé, et ils ont su cependant, avec ces
éléments divers, créer un tout de majes-
tueuse unité.
La nef et les transepts comportent une
seule file de bas côtés; par contre, le chœur
est l’objet principal, le lieu prédestiné où
la pompe sacerdotale pourra se développer
tout entière. Aussi aurons-nous là deux files
de bas côtés.
L’abside comporte sept travées rayon-
nantes, dont trois plus importantes, avec
grandes chapelles sur plan circulaire. A
droite de l’axe se trouve l’entrée de la cha-
pelle Saint-Piat. Les voûtes sont justement
renommées, toutes différentes et en écailles
de tortue ; « elles devaient être à l’abri de
l’incendie » disait, vers 1220, Guillaume le
Breton : l’incendie de 1836 dévora la char-
pente et le beffroi du clocher vieux, le
corps de la cathédrale, les fameuses voûtes
demeurèrent intactes comme l’avait prédit
le vieil écrivain ; ainsi fut démontrée la soli-
dité effective de ces constructions à l’appa-
rence si osée et si hardie.
Les porches latéraux datent de 1245 ; ajoutons que tout permet d’affir-
merqu’elle aurait possédé, à complet achèvement, neuf flèches se surpas-
sant en hauteur, dominées les unes et les autres par celle placée à la
croisée de la nef et des deux transepts ; deux à la façade occidentale ;
deux à chacun des porches latéraux, et deux enfin à la naissance de
l’abside, ce qui paraît être une disposition empruntée à l’architecture
normande.
F. J. P.
LES GRANDS ARCHITECTES
Andréa Palladio
Suite et fin (1)
Remarquons encore une fois, en jetant un
coup d’œil sur la jeunesse de Palladio, comme
tous ces hommes-là, tous sans exception, s’im-
posaient la peine et le travail, et se préparaient
eux-mêmes à leur destinée future par une rude
et forte éducation. Toutefois, il faut dire que
Palladio ne domina peut-être pas suffisamment
la nourriture qu’il donnait à son esprit ; vivant
ainsi dans le monde passé, et parles études que
nous venons de dire et par la continuelle lec-
ture qu’il faisait des auteurs latins, il perdit en
quelque sorte son époque de vue, se fit Gréco-
Romain, et devint bien plutôt un architecte du
temps d’Auguste que du xvp siècle. Son amour
de l’antique était poussé à l’excès, au point que
lorsque ses trois fils vinrent au monde, ne pou-
vant mieux, il se donna le plaisir d’en faire des
anciens du moins par le nom. Il appela le pre-
mier Léonidas, le second Horace et le troisième
Sylla. — Arnalfo di Lappo, Masuccio second,
Brunelleschi, Bramante et Alberti, avaient l’un
après l’autre enlevé à l’architecture un morceau
de son habit gothique, Palladio vint lui arracher
ses derniers voiles de dentelle et la montra tout
entière vêtue à la grecque et à la romaine. Si
nous en jugeons d’après ses propres écrits,
André est un véritable classique ; et pour tout
dire, il a un peu, ce nous semble, de l’étroitesse
de vue qui caractérise l’espèce. II songeait
d’abord à faire une belle maison selon certaines
règles données, quitte ensuite à l’habitant de la
maison à s’y arranger comme il pourrait. Le
beau pour lui avait un type absolu. Il ne dissi-
(1) Voir l’Art pour tous, n° de janvier 1904.
mule point le moins du monde la préoccupation
d’esprit qui ne lui laissait pas concevoir d’autre
architecture que celle des anciens, et qui voulait
obliger les modernes à habiter des palais
d’Athènes ou d’Herculanum. — Les croyances
aveugles mènent à la servilité, aussi Palladio,
malgré son génie, opérait presque toujours
comme s’il eût été de leur temps, et non pas
comme ils auraient sans doute opéré eux-mêmes
s’ils fussent venus dans le sien. Chargé de cons-
truire, à Vicence, pour le seigneur Joseph di
Porti, un hôtel sur un terrain qui l'aisait face à
deux rues, il le compose de deux corps de bâti-
ments semblables, ayant même distribution inté-
rieure, même façade extérieure et réunis par
une cour commune avec galeries à colonnades.
« Celui de devant, dit-il tout naïvement, est à
l’usage du maître, celui de derrière sera pour les
étrangers, selon la pratique des maisons grec-
ques qui avaient ainsi deux corps de logis dis-
tincts. » Il ne s’agit plus que de savoir si le
seigneur Joseph di Porti vivait et recevait à la
grecque. — Une autre fois l’académie olympique
de Vicence lui demande un théâtre, il fait un
cirque romain, et tellement pareil, qu’on discuta
si l’on n’y mettrait pas au lieu d’un toit un vela-
rium comme aux amphithéâtres de Galigula.
Toul cela va-t-il à dire que Palladio fut un
mauvais architecte, et que nous n’acceptons pas
sa réputation? Non, car s’il obéit aux lois de
Vitruve, comme un esclave aux ordres de son
maître, il faut dire que l’esclave valait certaine-
ment le maître. La critique peut désirer que sa
passion pour les anciens eût été moins ardente ;
elle aime l’invention et les choses nouvelles
mais elle ne peut nier que Palladio n’eût encore
de grands mérites personnels. Les gravures de
ses ouvrages nous y montrent un goût parfait de
proportion ; une certaine harmonie entre le
solide et le gracieux, entre le fond et les orne-
ments qui ont un charme particulier : le cachet
de son style est une pureté et une légèreté de
lignes exquises, déjà fort appréciées de son
temps, car on avait fini par appeler des palla-
diennes les maisons de plaisance les plus élé-
gantes, à cause de quelques habitations de ce
genre qu’il avait construites dans le Vicentin
pour divers seigneurs.
Nous ne pouvions songer à énumérer ici
les nombreuses productions de Palladio, nous
avons préféré donner une idée de son talent ;
ses principaux ouvrages sont à Venise et
à Vicence. Il se trouvait en cette ville où il
construisait le théâtre olympique, lorsqu’il
mourut le 19 août 1580, plutôt tué par les
fatigues que par l’âge. Il fut vivement regretté
par ses compatriotes, auxquels son génie
faisait honneur, et pleuré par les amis que
sa bienveillance naturelle lui avait procurés
en grand nombre. Les membres de l’aca-
démie olympique lui rendirent de grands
honneurs funèbres, dans lesquels, selon l’usage
d’alors, il se fit une énorme consommation de
vers, d’odes, de quatrains, d’élégies, enfin de
poésie de toute espèce, italienne, hébraïque,
arabe, et ce qui dut charmer son ombre particu-
lièrement latine et grecque.
LES EXPOSITIONS
Cercle Volney.
La tâche du critique d’art est agréable cette fois. 11
y a plusieurs années que le cercle Volnez ne nous
avait convié à une Exposition d’un ensemble aussi
satisfaisant.
Les maîtres consacrés s’y retrouvent égaux à eux-
mêmes, mais encore poussés vers le modernisme
vivant tout en restant possesseurs de leur maîtrise et
de leur facture propre.
Comme toujours les portraits sont le fond de cette
Exposition. De tout premier ordre, ceux de M. G. Fer-
rier, maître de plus en plus scrupuleux, puissant et
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
2° Quirinus fait jeter le corps de sa fille et ceux d’une foule de chré-
tiens dans le puits des Saints-Forts;
3° Deux anges portent sur une nappe l’âme nue de sainte Modeste.
A droite se trouve encore la porte d’entrée d’une ancienne cave qui
aboutit actuellement à un escalier condui-
sant à la crypte, œuvre de Fulbert (1020-
1022), laquelle crypte contient une série’1.de
chapelles voûtées, qui toutes forment un
sujet intéressant au point de vue des diffé-
rents systèmes de voûtes employés.
Je me borne à citer simplement la cathé-
drale de Chartres comme un sujet intéressant
au point de vue de l’étude, car l’unité har-
monique de cette œuvre de grande valeur
réelle n’est nullement amoindrie par les
empreintes des styles des diverses époques
qui l’ont précédée et qui l’ont suivie.
Th. Trupiième.
Nous compléterons ces lignes de l’artiste
par le résumé archéologique suivant :
Depuis le xue siècle jusqu’à l’origine du
xine, les cathédrales construites sont en
quelque sorte des essais; les architectes
cherchent leur voie et l’expression défini-
tive est encore à trouver. Ici, il n’en est
pas de même. A la suite de l’incendie détrui-
sant la primitive église (1020), l’évêque
Fulbert entreprend la reconstruction ; en
1145, les deux clochers de la façade occi-
dentale s’élèvent, mais un deuxième incen-
die (1194) détruit de nouveau la cathédrale
à peine achevée.
Melior, cardinal-légat du pape Gélestin III,
réunit le clergé et obtient son concours,
l’évêque Réghaullde Mouçon et ses chanoines abandonnent pour plusieurs
années le produit de leurs revenus et prébendes. Les rois Philippe-
Auguste, Louis VIII, saint Louis secondent ces efforts. L’église monte
avec rapidité, achevée pour la partie primitive en 1240, complétée par
la sacristie, la chapelle de saint Pial à deux étages, le jubé de 1240
à 1250. Elle est dédiée le 17 octobre 1260.
La nef comporte sept travées, chaque transept trois et le chœur
quatre.
Il y a lieu d’ajouter deux travées pour l’avancement du porche : les portes
du xue siècle furent en effet, reportées au niveau des tours de la façade
principale, façade occidentale. C’était un usage constant à l’époque
de respecter les parties architecturales plus anciennes, lorsque celles-
ci offraient une valeur réellement artis-
tique, et à Chartres même on trouve de
nombreux vestiges des églises antérieures ;
le moyen âge nous donne en cette cir-
constance une des plus sérieuses leçons :
ses constructeurs n’ont pas cru devoir sup-
primer ce que leurs prédécesseurs avaient
élevé, et ils ont su cependant, avec ces
éléments divers, créer un tout de majes-
tueuse unité.
La nef et les transepts comportent une
seule file de bas côtés; par contre, le chœur
est l’objet principal, le lieu prédestiné où
la pompe sacerdotale pourra se développer
tout entière. Aussi aurons-nous là deux files
de bas côtés.
L’abside comporte sept travées rayon-
nantes, dont trois plus importantes, avec
grandes chapelles sur plan circulaire. A
droite de l’axe se trouve l’entrée de la cha-
pelle Saint-Piat. Les voûtes sont justement
renommées, toutes différentes et en écailles
de tortue ; « elles devaient être à l’abri de
l’incendie » disait, vers 1220, Guillaume le
Breton : l’incendie de 1836 dévora la char-
pente et le beffroi du clocher vieux, le
corps de la cathédrale, les fameuses voûtes
demeurèrent intactes comme l’avait prédit
le vieil écrivain ; ainsi fut démontrée la soli-
dité effective de ces constructions à l’appa-
rence si osée et si hardie.
Les porches latéraux datent de 1245 ; ajoutons que tout permet d’affir-
merqu’elle aurait possédé, à complet achèvement, neuf flèches se surpas-
sant en hauteur, dominées les unes et les autres par celle placée à la
croisée de la nef et des deux transepts ; deux à la façade occidentale ;
deux à chacun des porches latéraux, et deux enfin à la naissance de
l’abside, ce qui paraît être une disposition empruntée à l’architecture
normande.
F. J. P.
LES GRANDS ARCHITECTES
Andréa Palladio
Suite et fin (1)
Remarquons encore une fois, en jetant un
coup d’œil sur la jeunesse de Palladio, comme
tous ces hommes-là, tous sans exception, s’im-
posaient la peine et le travail, et se préparaient
eux-mêmes à leur destinée future par une rude
et forte éducation. Toutefois, il faut dire que
Palladio ne domina peut-être pas suffisamment
la nourriture qu’il donnait à son esprit ; vivant
ainsi dans le monde passé, et parles études que
nous venons de dire et par la continuelle lec-
ture qu’il faisait des auteurs latins, il perdit en
quelque sorte son époque de vue, se fit Gréco-
Romain, et devint bien plutôt un architecte du
temps d’Auguste que du xvp siècle. Son amour
de l’antique était poussé à l’excès, au point que
lorsque ses trois fils vinrent au monde, ne pou-
vant mieux, il se donna le plaisir d’en faire des
anciens du moins par le nom. Il appela le pre-
mier Léonidas, le second Horace et le troisième
Sylla. — Arnalfo di Lappo, Masuccio second,
Brunelleschi, Bramante et Alberti, avaient l’un
après l’autre enlevé à l’architecture un morceau
de son habit gothique, Palladio vint lui arracher
ses derniers voiles de dentelle et la montra tout
entière vêtue à la grecque et à la romaine. Si
nous en jugeons d’après ses propres écrits,
André est un véritable classique ; et pour tout
dire, il a un peu, ce nous semble, de l’étroitesse
de vue qui caractérise l’espèce. II songeait
d’abord à faire une belle maison selon certaines
règles données, quitte ensuite à l’habitant de la
maison à s’y arranger comme il pourrait. Le
beau pour lui avait un type absolu. Il ne dissi-
(1) Voir l’Art pour tous, n° de janvier 1904.
mule point le moins du monde la préoccupation
d’esprit qui ne lui laissait pas concevoir d’autre
architecture que celle des anciens, et qui voulait
obliger les modernes à habiter des palais
d’Athènes ou d’Herculanum. — Les croyances
aveugles mènent à la servilité, aussi Palladio,
malgré son génie, opérait presque toujours
comme s’il eût été de leur temps, et non pas
comme ils auraient sans doute opéré eux-mêmes
s’ils fussent venus dans le sien. Chargé de cons-
truire, à Vicence, pour le seigneur Joseph di
Porti, un hôtel sur un terrain qui l'aisait face à
deux rues, il le compose de deux corps de bâti-
ments semblables, ayant même distribution inté-
rieure, même façade extérieure et réunis par
une cour commune avec galeries à colonnades.
« Celui de devant, dit-il tout naïvement, est à
l’usage du maître, celui de derrière sera pour les
étrangers, selon la pratique des maisons grec-
ques qui avaient ainsi deux corps de logis dis-
tincts. » Il ne s’agit plus que de savoir si le
seigneur Joseph di Porti vivait et recevait à la
grecque. — Une autre fois l’académie olympique
de Vicence lui demande un théâtre, il fait un
cirque romain, et tellement pareil, qu’on discuta
si l’on n’y mettrait pas au lieu d’un toit un vela-
rium comme aux amphithéâtres de Galigula.
Toul cela va-t-il à dire que Palladio fut un
mauvais architecte, et que nous n’acceptons pas
sa réputation? Non, car s’il obéit aux lois de
Vitruve, comme un esclave aux ordres de son
maître, il faut dire que l’esclave valait certaine-
ment le maître. La critique peut désirer que sa
passion pour les anciens eût été moins ardente ;
elle aime l’invention et les choses nouvelles
mais elle ne peut nier que Palladio n’eût encore
de grands mérites personnels. Les gravures de
ses ouvrages nous y montrent un goût parfait de
proportion ; une certaine harmonie entre le
solide et le gracieux, entre le fond et les orne-
ments qui ont un charme particulier : le cachet
de son style est une pureté et une légèreté de
lignes exquises, déjà fort appréciées de son
temps, car on avait fini par appeler des palla-
diennes les maisons de plaisance les plus élé-
gantes, à cause de quelques habitations de ce
genre qu’il avait construites dans le Vicentin
pour divers seigneurs.
Nous ne pouvions songer à énumérer ici
les nombreuses productions de Palladio, nous
avons préféré donner une idée de son talent ;
ses principaux ouvrages sont à Venise et
à Vicence. Il se trouvait en cette ville où il
construisait le théâtre olympique, lorsqu’il
mourut le 19 août 1580, plutôt tué par les
fatigues que par l’âge. Il fut vivement regretté
par ses compatriotes, auxquels son génie
faisait honneur, et pleuré par les amis que
sa bienveillance naturelle lui avait procurés
en grand nombre. Les membres de l’aca-
démie olympique lui rendirent de grands
honneurs funèbres, dans lesquels, selon l’usage
d’alors, il se fit une énorme consommation de
vers, d’odes, de quatrains, d’élégies, enfin de
poésie de toute espèce, italienne, hébraïque,
arabe, et ce qui dut charmer son ombre particu-
lièrement latine et grecque.
LES EXPOSITIONS
Cercle Volney.
La tâche du critique d’art est agréable cette fois. 11
y a plusieurs années que le cercle Volnez ne nous
avait convié à une Exposition d’un ensemble aussi
satisfaisant.
Les maîtres consacrés s’y retrouvent égaux à eux-
mêmes, mais encore poussés vers le modernisme
vivant tout en restant possesseurs de leur maîtrise et
de leur facture propre.
Comme toujours les portraits sont le fond de cette
Exposition. De tout premier ordre, ceux de M. G. Fer-
rier, maître de plus en plus scrupuleux, puissant et