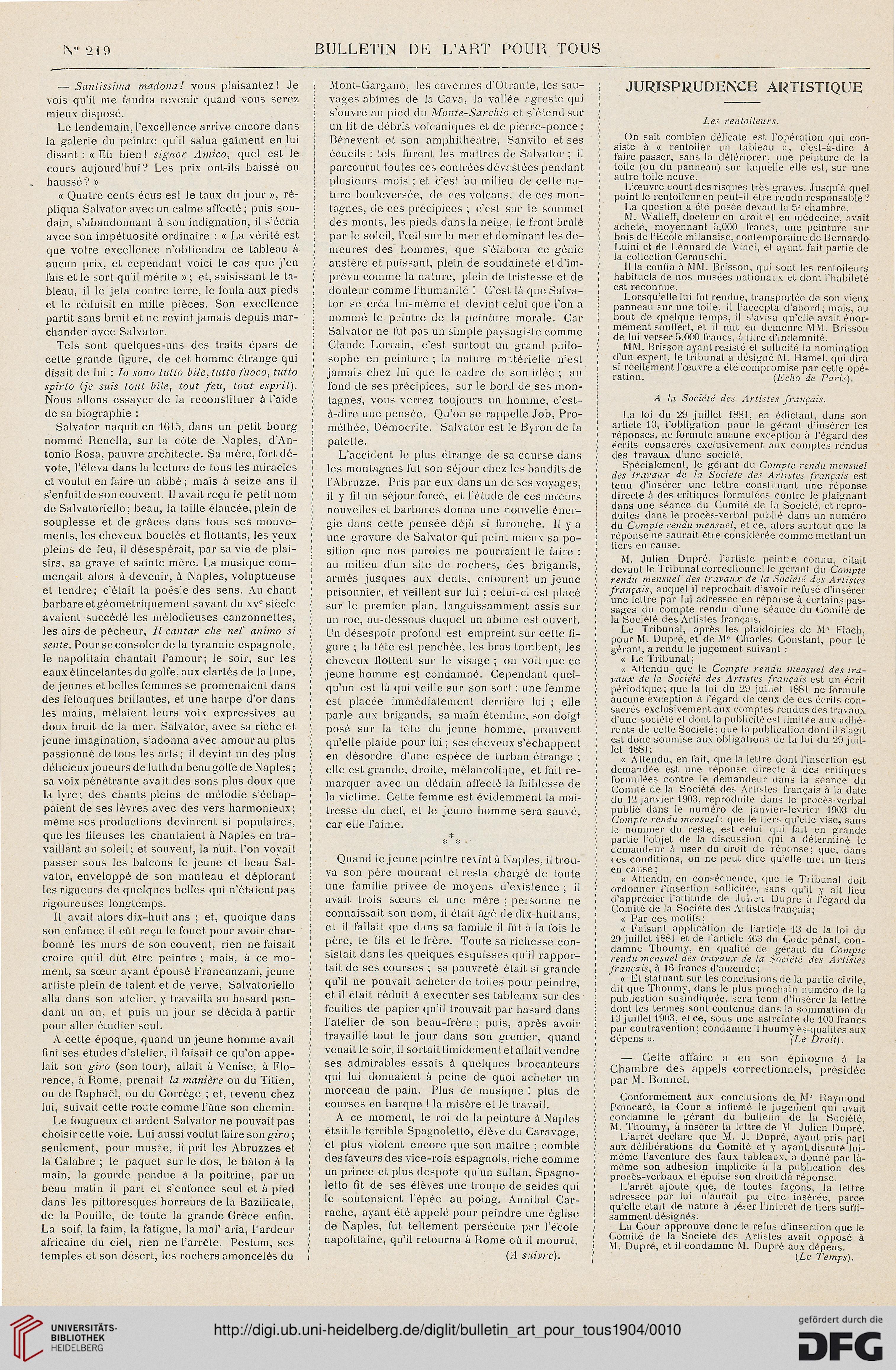IV 219
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
— Santissima madona! vous plaisantez! Je
vois qu’il me faudra revenir quand vous serez
mieux disposé.
Le lendemain, l'excellence arrive encore dans
la galerie du peintre qu’il salua gaîment en lui
disant : « Eh bien ! signor Amico, quel est le
cours aujourd’hui? Les prix ont-ils baissé ou
haussé? »
« Quatre cents écus est le taux du jour », ré-
pliqua Salvalor avec un calme affeclé ; puis sou-
dain, s’abandonnant à son indignation, il s’écria
avec son impétuosité ordinaire : « La vérité est
que votre excellence n’obtiendra ce tableau à
aucun prix, et cependant voici le cas que j’en
fais et le sort qu’il mérite » ; et, saisissant le ta-
bleau, il le jeta contre terre, le foula aux pieds
et le réduisit en mille pièces. Son excellence
partit sans bruit et ne revint jamais depuis mar-
chander avec Salvator.
Tels sont quelques-uns des traits épars de
celte grande figure, de cet homme étrange qui
disait de lui : Io sono tutlo bilè,tutto fuoco, tutto
spirto {je suis tout bile, tout feu, tout esprit).
Nous allons essayer de la reconstituer à l’aide
de sa biographie :
Salvator naquit en 1C15, dans un petit bourg-
nommé Renella, sur la côte de Naples, d’An-
tonio Rosa, pauvre architecte. Sa mère, fort dé-
vote, l’éleva dans la lecture de tous les miracles
et voulut en faire un abbé; mais à seize ans il
s’enfuit de son couvent. 11 avait reçu Je petit nom
de Salvatoriello; beau, la taille élancée, plein de
souplesse et de grâces dans tous ses mouve-
ments, les cheveux bouclés et flottants, les yeux |
pleins de feu, il désespérait, par sa vie de plai-
sirs, sa grave et sainte mère. La musique com- !
mençait alors à devenir, à Naples, voluptueuse j
et tendre; c’était la poésie des sens. Au chant \
barbareetgéométriquemenl savant du xve siècle !
avaient succédé les mélodieuses canzonnettes,
les airs de pêcheur, Il cantar che ne! animo si j
sente. Pour se consoler de la tyrannie espagnole,
le napolitain chantait l’amour; le soir, sur les
eaux élincelantes du golfe, aux clartés de la lune,
de jeunes et belles femmes se promenaient dans
des felouques brillantes, et une harpe d’or dans
les mains, mêlaient leurs voix expressives au \
doux bruit de la mer. Salvator, avec sa riche et j
jeune imagination, s’adonna avec amour au plus
passionné de tous les arts; il devint un des plus 1
délicieux joueurs de luth du beau golfe de Naples ; i
sa voix pénétrante avait des sons plus doux que
la lyre; des chants pleins de mélodie s’échap- j
paient de ses lèvres avec des vers harmonieux; !
même ses productions devinrent si populaires, j
que les fileuses les chantaient à Naples en tra- j
vaillant au soleil; et souvent, la nuit, l’on voyait
passer sous les balcons le jeune et beau Sal-
vator, enveloppé de son manteau et déplorant j
les rigueurs de quelques belles qui n’élaienlpas !
rigoureuses longtemps.
11 avait alors dix-huit ans ; et, quoique dans
son enfance il eût reçu le fouet pour avoir char- j
bonné les murs de son couvent, rien ne faisait j
croire qu’il dut être peintre ; mais, à ce mo- j
ment, sa sœur ayant épousé Francanzani, jeune j
artiste plein de talent et de verve, Salvatoriello '
alla dans son atelier, y travailla au hasard pen-
dant un an, et puis un jour se décida à partir
pour aller étudier seul. |
A cette époque, quand un jeune homme avait j
fini ses études d’atelier, il faisait ce qu’on appe- t
lait son giro (son tour), allait à Venise, à Flo- j
rence, à Rome, prenait la manière ou du Titien, j
ou de Raphaël, ou du Corrège ; et, îevenu chez
lui, suivait cette route comme l’âne son chemin.
Le fougueux et ardent Salvator ne pouvait pas !
choisir cette voie. Lui aussi voulut faire son giro-, j
seulement, pour musée, ii p ri t les Abruzzes et j
la Calabre ; le paquet sur le dos, le bâton à la }
main, la gourde pendue à la poitrine, par un
beau matin il part et s’enfonce seul et à pied j
dans les pittoresques horreurs de la Bazilicale,
de la Pouille, de toute la grande Grèce enfin.
La soif, la faim, la fatigue, la mal’ aria, l'ardeur
africaine du ciel, rien ne l’arrête. Pestum, ses
temples et son désert, les rochers amoncelés du l
Mont-Gargano, les cavernes d’Otrante, les sau-
vages abîmes de la Gava, la vallée agreste qui
s’ouvre au pied du Monte-Sarcliio et s’étend sur
un lit de débris volcaniques et de pierre-ponce;
Bénevent et son amphithéâtre, Sanvito et ses
écueils : tels furent les maîtres de Salvator ; il
parcourut toutes ces contrées dévastées pendant
plusieurs mois ; et c’est au milieu de cette na-
ture bouleversée, de ces volcans, de ces mon-
tagnes, de ces précipices ; c’est sur le sommet
des monts, les pieds dans la neige, le front brûlé
par le soleil, l’œil sur la mer et dominant les de-
meures des hommes, que s’élabora ce génie
austère et puissant, plein de soudaineté et d’im-
prévu comme la nature, plein de tristesse et de
douleur comme l’humanité ! C’est là que Salva-
Lor se créa lui-même et devint celui que l’on a
nommé le peintre de la peinture morale. Car
Salvalor ne fut pas un simple paysagiste comme
Claude Lorrain, c’est surtout un grand philo-
sophe en peinture ; la nature matérielle n’est
jamais chez lui que le cadre de son idée ; au
fond de ses précipices, sur le bord de scs mon-
tagnes, vous verrez toujours un homme, c'est-
à-dire une pensée. Qu’on se rappelle Job, Pro-
mélhée, Démocrile. Salvator est le Byron de la
palette.
L’accident le plus étrange de sa course dans
les montagnes fut son séjour chez les bandits de
l’Abruzze. Pris par eux dans un de ses voyages,
il y fit un séjour forcé, et l’étude de ccs mœurs
nouvelles et barbares donna une nouvelle éner-
gie dans cette pensée déjà si farouche. 11 y a
une gravure de Salvator qui peint mieux sa po-
sition que nos paroles ne pourraient le faire :
au milieu d’un site de rochers, des brigands,
armés jusques aux dents, entourent un jeune
prisonnier, et veillent sur lui ; celui-ci est placé
sur le premier plan, languissamment assis sur
un roc, au-dessous duquel un abîme est ouvert.
Un désespoir profond est empreint sur cette fi-
gure ; la tête est penchée, les bras tombent, les
cheveux flottent sur le visage ; on voit que ce
jeune homme est condamné. Cependant quel-
qu’un est là qui veille sur son sort : une femme
est placée immédiatement derrière lui ; elle
parle aux brigands, sa main étendue, son doigt
posé sur la tète du jeune homme, prouvent
qu’elle plaide pour lui ; ses cheveux s’échappent
en désordre d’une espèce de turban étrange ;
elle est grande, droite, mélancolique, et fait re-
marquer avec un dédain affecté la faiblesse de
la victime. Cette femme est évidemment la maî-
tresse du chef, et le jeune homme sera sauvé,
car elle l’aime.
*
* *
Quand le jeune peintre revint à Naples, il trou-
va son père mourant et resta chargé de toute
une famille privée de moyens d’existence ; il
avait trois sœurs et une mère ; personne ne
connaissait son nom, il était âgé de dix-huit ans,
et il fallait que dans sa famille il fût à la fois le
père, le fils et le frère. Toute sa richesse con-
sistait dans les quelques esquisses qu’il rappor-
tait de ses courses ; sa pauvreté était si grande
qu’il ne pouvait acheter de toiles pour peindre,
et il était réduit à exécuter ses tableaux sur des
feuilles de papier qu’il trouvait par hasard dans
l’atelier de son beau-frère ; puis, après avoir
travaillé tout le jour dans son grenier, quand
venait le soir, il sortait timidement et allait vendre
ses admirables essais à quelques brocanteurs
qui lui donnaient à peine de quoi acheter un
morceau de pain. Plus de musique ! plus de
courses en barque ! la misère et le travail.
A ce moment, le roi de la peinture à Naples
élait le terrible Spagnoletlo, élève du Caravage,
et plus violent encore que son maître ; comblé
des faveurs des vice-rois espagnols, riche comme
un prince et plus despote qu’un sultan, Spagno-
letlo fit de ses élèves une troupe de seïdes qui
le soutenaient l’épée au poing. Annibal Car-
rache, ayant été appelé pour peindre une église
de Naples, fut tellement persécuté par l’école
napolitaine, qu’il retourna à Rome où il mourut.
(A suivre).
JURISPRUDENCE ARTISTIQUE
Les rentoileurs.
On sait combien délicate est l’opération qui con-
j siste à « rentoiler un tableau », c’est-à-dire à
i faire passer, sans la détériorer, une peinture de la
j toile (ou du panneau) sur laquelle elle est, sur une
autre toile neuve.
L’œuvre court des risques très graves. Jusqu’à quel
| point le rentoilcuren peut-il être rendu responsable?
La question a été posée devant la 5e chambre.
M. Walleff, docteur en droit et en médecine, avait
! acheté, moyennant 5,000 francs, une peinture sur
! bois de l’Ecole milanaise, contemporaine de Bernardo
j Luini et de Léonard de Vinci, et ayant fait partie de
la collection Cernuschi.
11 la confia à MM. Brisson, qui sont les rentoileurs
j habituels de nos musées nationaux et dont l’habileté
est reconnue.
Lorsqu’elle lui fut rendue, transportée de son vieux
j panneau sur une toile, il l’accepta d’abord; mais, au
! bout de quelque temps, il s’avisa qu’elle avait énor-
| mément souffert, et il mit en demeure MM. Brisson
! de lui verser 5,000 francs, à titre d’indemnité,
j MM. Brisson ayant résisté et sollicité la nomination
j d’un expert, le tribunal a désigné M. Hamel, qui dira
) si réellement l’œuvre a été compromise par cette opé-
j ration. {Echo de Paris).
A la Société des Artistes français.
\ La loi du 29 juillet 1881, en édictant, dans son
( article 13, l’obligaiion pour le gérant d’insérer les
j réponses, ne formule aucune exceplion à l’égard des
écrits consacrés exclusivement aux comptes rendus
des travaux d’une société.
Spécialement, le géiant du Compte rendu mensuel
j des travaux de la Société des Artistes français est
| tenu d’insérer une lettre constiluant une réponse
i directe à des critiques formulées contre le plaignant
j dans une séance du Comité de la Société, et repro-
i duites dans le procès-verbal publié dans un numéro
du Compte rendu mensuel, et ce, alors surtout que la
réponse ne saurait être considérée comme mettant un
I tiers en cause.
M. Julien Dupré, l’arlisle peintie connu, citait
! devant le Tribunal correctionnel le gérant du Compte
j rendu mensuel des travaux de la Société des Artistes
i français, auquel il reprochait d’avoir refusé d’insérer
| une lettre par lui adressée en réponse à certains pas-
sages du compte rendu d’une séance du Comité de
la Société des Artistes français.
Le Tribunal, après les plaidoiries de M° Flach,
pour M. Dupré, et de M* Charles Constant, pour le
gérant, a rendu le jugement suivant :
( « Le Tribunal ;
j « Attendu que le Compte rendu mensuel des tra-
! vaux de la Société des Artistes français est un écrit
j périodique; que la loi du 29 juillet 1881 ne formule
aucune exception à l’égard de ceux de ces écrits con-
sacrés exclusivement aux comptes rendus des travaux
{ d’une société et dont la publicité est limitée aux adhé-
( rents de cette Société; que la publication dont il s’agit
est donc soumise aux obligations de la loi du 29 juil-
| let 1881;
« Attendu, en fait, que la lettre dont l’insertion est
j demandée est une réponse directe à des critiques
formulées contre le demandeur dans la séance du
Comité de la Société des Artistes français à la date
du 12 janvier 1903, reproduite dans le procès-verbal
j publié dans le numéro de janvier-février 1903 du
i Compte rendit mensuel', que le tiers qu’elle vise, sans
j le nommer du reste, est celui qui fait en grande
: partie l’objet de la discussion qui a déterminé le
j demandeur à user du droit de réponse; que, dans
ces conditions, on ne peut dire qu’elle met un tiers
en cause ;
j « Attendu, en conséquence, que le Tribunal doit
J ordonner l’insertion sollicitée, sans qu’il y ait lieu
I d’apprécier l’attitude de .lui,eu Dupré à l’égard du
j Comité de la Société des Ai tisles français;
j « Par ces motifs;
« Faisant application de l’article 13 de la loi du
29 juillet 1881 et de l’article 463 du Code pénal, con-
damne Thoumy, en qualité de gérant du Compte
rendu mensuel des travaux de la Société des Artistes
1 français, à 16 francs d’amende;
« Et statuant sur les conclusions de ta partie civile,
dit que Thoumy, dans le plus prochain numéro de la
publication susindiquée, sera tenu d’insérer la letlre
dont les termes sont contenus dans la sommation du
13 juillet 1903, et ce, sous une astreinte de 100 francs
par contravention; condamne Thoumy ès-qualités aux
dépens ». . (Le Droit).
— Gette affaire a eu son épilogue à la
Chambre des appels correctionnels, présidée
par M. Bonnet.
Conformément aux conclusions det M" Raymond
j Poincaré, la Cour a infirmé le jugement qui avait
j condamné le gérant du bulletin de la Société,
J M. Thoumy, à insérer la lettre de M Julien Dupré.
L’arrêt déclare que M. J. Dupré, ayant pris part
j aux délibérations du Comité et y ayant.discuté lui-
j même l’aventure des faux tableaux, a donné par là-
même son adhésion implicite à la publication des
procès-verbaux et épuise son droit de réponse.
| L’arrêt ajoute que, de toutes façons, la lettre
adressée par lui n’aurait pu être insérée, parce
j qu’elle était de nature à léser l’intérêt de tiers suffi-
samment désignés,
i La Cour approuve donc le refus d’inserlion que le
\ Comité de la Société des Artistes avait opposé à
M. Dupré, et il condamne M. Dupré aux dépens.
{Le Temps).
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
— Santissima madona! vous plaisantez! Je
vois qu’il me faudra revenir quand vous serez
mieux disposé.
Le lendemain, l'excellence arrive encore dans
la galerie du peintre qu’il salua gaîment en lui
disant : « Eh bien ! signor Amico, quel est le
cours aujourd’hui? Les prix ont-ils baissé ou
haussé? »
« Quatre cents écus est le taux du jour », ré-
pliqua Salvalor avec un calme affeclé ; puis sou-
dain, s’abandonnant à son indignation, il s’écria
avec son impétuosité ordinaire : « La vérité est
que votre excellence n’obtiendra ce tableau à
aucun prix, et cependant voici le cas que j’en
fais et le sort qu’il mérite » ; et, saisissant le ta-
bleau, il le jeta contre terre, le foula aux pieds
et le réduisit en mille pièces. Son excellence
partit sans bruit et ne revint jamais depuis mar-
chander avec Salvator.
Tels sont quelques-uns des traits épars de
celte grande figure, de cet homme étrange qui
disait de lui : Io sono tutlo bilè,tutto fuoco, tutto
spirto {je suis tout bile, tout feu, tout esprit).
Nous allons essayer de la reconstituer à l’aide
de sa biographie :
Salvator naquit en 1C15, dans un petit bourg-
nommé Renella, sur la côte de Naples, d’An-
tonio Rosa, pauvre architecte. Sa mère, fort dé-
vote, l’éleva dans la lecture de tous les miracles
et voulut en faire un abbé; mais à seize ans il
s’enfuit de son couvent. 11 avait reçu Je petit nom
de Salvatoriello; beau, la taille élancée, plein de
souplesse et de grâces dans tous ses mouve-
ments, les cheveux bouclés et flottants, les yeux |
pleins de feu, il désespérait, par sa vie de plai-
sirs, sa grave et sainte mère. La musique com- !
mençait alors à devenir, à Naples, voluptueuse j
et tendre; c’était la poésie des sens. Au chant \
barbareetgéométriquemenl savant du xve siècle !
avaient succédé les mélodieuses canzonnettes,
les airs de pêcheur, Il cantar che ne! animo si j
sente. Pour se consoler de la tyrannie espagnole,
le napolitain chantait l’amour; le soir, sur les
eaux élincelantes du golfe, aux clartés de la lune,
de jeunes et belles femmes se promenaient dans
des felouques brillantes, et une harpe d’or dans
les mains, mêlaient leurs voix expressives au \
doux bruit de la mer. Salvator, avec sa riche et j
jeune imagination, s’adonna avec amour au plus
passionné de tous les arts; il devint un des plus 1
délicieux joueurs de luth du beau golfe de Naples ; i
sa voix pénétrante avait des sons plus doux que
la lyre; des chants pleins de mélodie s’échap- j
paient de ses lèvres avec des vers harmonieux; !
même ses productions devinrent si populaires, j
que les fileuses les chantaient à Naples en tra- j
vaillant au soleil; et souvent, la nuit, l’on voyait
passer sous les balcons le jeune et beau Sal-
vator, enveloppé de son manteau et déplorant j
les rigueurs de quelques belles qui n’élaienlpas !
rigoureuses longtemps.
11 avait alors dix-huit ans ; et, quoique dans
son enfance il eût reçu le fouet pour avoir char- j
bonné les murs de son couvent, rien ne faisait j
croire qu’il dut être peintre ; mais, à ce mo- j
ment, sa sœur ayant épousé Francanzani, jeune j
artiste plein de talent et de verve, Salvatoriello '
alla dans son atelier, y travailla au hasard pen-
dant un an, et puis un jour se décida à partir
pour aller étudier seul. |
A cette époque, quand un jeune homme avait j
fini ses études d’atelier, il faisait ce qu’on appe- t
lait son giro (son tour), allait à Venise, à Flo- j
rence, à Rome, prenait la manière ou du Titien, j
ou de Raphaël, ou du Corrège ; et, îevenu chez
lui, suivait cette route comme l’âne son chemin.
Le fougueux et ardent Salvator ne pouvait pas !
choisir cette voie. Lui aussi voulut faire son giro-, j
seulement, pour musée, ii p ri t les Abruzzes et j
la Calabre ; le paquet sur le dos, le bâton à la }
main, la gourde pendue à la poitrine, par un
beau matin il part et s’enfonce seul et à pied j
dans les pittoresques horreurs de la Bazilicale,
de la Pouille, de toute la grande Grèce enfin.
La soif, la faim, la fatigue, la mal’ aria, l'ardeur
africaine du ciel, rien ne l’arrête. Pestum, ses
temples et son désert, les rochers amoncelés du l
Mont-Gargano, les cavernes d’Otrante, les sau-
vages abîmes de la Gava, la vallée agreste qui
s’ouvre au pied du Monte-Sarcliio et s’étend sur
un lit de débris volcaniques et de pierre-ponce;
Bénevent et son amphithéâtre, Sanvito et ses
écueils : tels furent les maîtres de Salvator ; il
parcourut toutes ces contrées dévastées pendant
plusieurs mois ; et c’est au milieu de cette na-
ture bouleversée, de ces volcans, de ces mon-
tagnes, de ces précipices ; c’est sur le sommet
des monts, les pieds dans la neige, le front brûlé
par le soleil, l’œil sur la mer et dominant les de-
meures des hommes, que s’élabora ce génie
austère et puissant, plein de soudaineté et d’im-
prévu comme la nature, plein de tristesse et de
douleur comme l’humanité ! C’est là que Salva-
Lor se créa lui-même et devint celui que l’on a
nommé le peintre de la peinture morale. Car
Salvalor ne fut pas un simple paysagiste comme
Claude Lorrain, c’est surtout un grand philo-
sophe en peinture ; la nature matérielle n’est
jamais chez lui que le cadre de son idée ; au
fond de ses précipices, sur le bord de scs mon-
tagnes, vous verrez toujours un homme, c'est-
à-dire une pensée. Qu’on se rappelle Job, Pro-
mélhée, Démocrile. Salvator est le Byron de la
palette.
L’accident le plus étrange de sa course dans
les montagnes fut son séjour chez les bandits de
l’Abruzze. Pris par eux dans un de ses voyages,
il y fit un séjour forcé, et l’étude de ccs mœurs
nouvelles et barbares donna une nouvelle éner-
gie dans cette pensée déjà si farouche. 11 y a
une gravure de Salvator qui peint mieux sa po-
sition que nos paroles ne pourraient le faire :
au milieu d’un site de rochers, des brigands,
armés jusques aux dents, entourent un jeune
prisonnier, et veillent sur lui ; celui-ci est placé
sur le premier plan, languissamment assis sur
un roc, au-dessous duquel un abîme est ouvert.
Un désespoir profond est empreint sur cette fi-
gure ; la tête est penchée, les bras tombent, les
cheveux flottent sur le visage ; on voit que ce
jeune homme est condamné. Cependant quel-
qu’un est là qui veille sur son sort : une femme
est placée immédiatement derrière lui ; elle
parle aux brigands, sa main étendue, son doigt
posé sur la tète du jeune homme, prouvent
qu’elle plaide pour lui ; ses cheveux s’échappent
en désordre d’une espèce de turban étrange ;
elle est grande, droite, mélancolique, et fait re-
marquer avec un dédain affecté la faiblesse de
la victime. Cette femme est évidemment la maî-
tresse du chef, et le jeune homme sera sauvé,
car elle l’aime.
*
* *
Quand le jeune peintre revint à Naples, il trou-
va son père mourant et resta chargé de toute
une famille privée de moyens d’existence ; il
avait trois sœurs et une mère ; personne ne
connaissait son nom, il était âgé de dix-huit ans,
et il fallait que dans sa famille il fût à la fois le
père, le fils et le frère. Toute sa richesse con-
sistait dans les quelques esquisses qu’il rappor-
tait de ses courses ; sa pauvreté était si grande
qu’il ne pouvait acheter de toiles pour peindre,
et il était réduit à exécuter ses tableaux sur des
feuilles de papier qu’il trouvait par hasard dans
l’atelier de son beau-frère ; puis, après avoir
travaillé tout le jour dans son grenier, quand
venait le soir, il sortait timidement et allait vendre
ses admirables essais à quelques brocanteurs
qui lui donnaient à peine de quoi acheter un
morceau de pain. Plus de musique ! plus de
courses en barque ! la misère et le travail.
A ce moment, le roi de la peinture à Naples
élait le terrible Spagnoletlo, élève du Caravage,
et plus violent encore que son maître ; comblé
des faveurs des vice-rois espagnols, riche comme
un prince et plus despote qu’un sultan, Spagno-
letlo fit de ses élèves une troupe de seïdes qui
le soutenaient l’épée au poing. Annibal Car-
rache, ayant été appelé pour peindre une église
de Naples, fut tellement persécuté par l’école
napolitaine, qu’il retourna à Rome où il mourut.
(A suivre).
JURISPRUDENCE ARTISTIQUE
Les rentoileurs.
On sait combien délicate est l’opération qui con-
j siste à « rentoiler un tableau », c’est-à-dire à
i faire passer, sans la détériorer, une peinture de la
j toile (ou du panneau) sur laquelle elle est, sur une
autre toile neuve.
L’œuvre court des risques très graves. Jusqu’à quel
| point le rentoilcuren peut-il être rendu responsable?
La question a été posée devant la 5e chambre.
M. Walleff, docteur en droit et en médecine, avait
! acheté, moyennant 5,000 francs, une peinture sur
! bois de l’Ecole milanaise, contemporaine de Bernardo
j Luini et de Léonard de Vinci, et ayant fait partie de
la collection Cernuschi.
11 la confia à MM. Brisson, qui sont les rentoileurs
j habituels de nos musées nationaux et dont l’habileté
est reconnue.
Lorsqu’elle lui fut rendue, transportée de son vieux
j panneau sur une toile, il l’accepta d’abord; mais, au
! bout de quelque temps, il s’avisa qu’elle avait énor-
| mément souffert, et il mit en demeure MM. Brisson
! de lui verser 5,000 francs, à titre d’indemnité,
j MM. Brisson ayant résisté et sollicité la nomination
j d’un expert, le tribunal a désigné M. Hamel, qui dira
) si réellement l’œuvre a été compromise par cette opé-
j ration. {Echo de Paris).
A la Société des Artistes français.
\ La loi du 29 juillet 1881, en édictant, dans son
( article 13, l’obligaiion pour le gérant d’insérer les
j réponses, ne formule aucune exceplion à l’égard des
écrits consacrés exclusivement aux comptes rendus
des travaux d’une société.
Spécialement, le géiant du Compte rendu mensuel
j des travaux de la Société des Artistes français est
| tenu d’insérer une lettre constiluant une réponse
i directe à des critiques formulées contre le plaignant
j dans une séance du Comité de la Société, et repro-
i duites dans le procès-verbal publié dans un numéro
du Compte rendu mensuel, et ce, alors surtout que la
réponse ne saurait être considérée comme mettant un
I tiers en cause.
M. Julien Dupré, l’arlisle peintie connu, citait
! devant le Tribunal correctionnel le gérant du Compte
j rendu mensuel des travaux de la Société des Artistes
i français, auquel il reprochait d’avoir refusé d’insérer
| une lettre par lui adressée en réponse à certains pas-
sages du compte rendu d’une séance du Comité de
la Société des Artistes français.
Le Tribunal, après les plaidoiries de M° Flach,
pour M. Dupré, et de M* Charles Constant, pour le
gérant, a rendu le jugement suivant :
( « Le Tribunal ;
j « Attendu que le Compte rendu mensuel des tra-
! vaux de la Société des Artistes français est un écrit
j périodique; que la loi du 29 juillet 1881 ne formule
aucune exception à l’égard de ceux de ces écrits con-
sacrés exclusivement aux comptes rendus des travaux
{ d’une société et dont la publicité est limitée aux adhé-
( rents de cette Société; que la publication dont il s’agit
est donc soumise aux obligations de la loi du 29 juil-
| let 1881;
« Attendu, en fait, que la lettre dont l’insertion est
j demandée est une réponse directe à des critiques
formulées contre le demandeur dans la séance du
Comité de la Société des Artistes français à la date
du 12 janvier 1903, reproduite dans le procès-verbal
j publié dans le numéro de janvier-février 1903 du
i Compte rendit mensuel', que le tiers qu’elle vise, sans
j le nommer du reste, est celui qui fait en grande
: partie l’objet de la discussion qui a déterminé le
j demandeur à user du droit de réponse; que, dans
ces conditions, on ne peut dire qu’elle met un tiers
en cause ;
j « Attendu, en conséquence, que le Tribunal doit
J ordonner l’insertion sollicitée, sans qu’il y ait lieu
I d’apprécier l’attitude de .lui,eu Dupré à l’égard du
j Comité de la Société des Ai tisles français;
j « Par ces motifs;
« Faisant application de l’article 13 de la loi du
29 juillet 1881 et de l’article 463 du Code pénal, con-
damne Thoumy, en qualité de gérant du Compte
rendu mensuel des travaux de la Société des Artistes
1 français, à 16 francs d’amende;
« Et statuant sur les conclusions de ta partie civile,
dit que Thoumy, dans le plus prochain numéro de la
publication susindiquée, sera tenu d’insérer la letlre
dont les termes sont contenus dans la sommation du
13 juillet 1903, et ce, sous une astreinte de 100 francs
par contravention; condamne Thoumy ès-qualités aux
dépens ». . (Le Droit).
— Gette affaire a eu son épilogue à la
Chambre des appels correctionnels, présidée
par M. Bonnet.
Conformément aux conclusions det M" Raymond
j Poincaré, la Cour a infirmé le jugement qui avait
j condamné le gérant du bulletin de la Société,
J M. Thoumy, à insérer la lettre de M Julien Dupré.
L’arrêt déclare que M. J. Dupré, ayant pris part
j aux délibérations du Comité et y ayant.discuté lui-
j même l’aventure des faux tableaux, a donné par là-
même son adhésion implicite à la publication des
procès-verbaux et épuise son droit de réponse.
| L’arrêt ajoute que, de toutes façons, la lettre
adressée par lui n’aurait pu être insérée, parce
j qu’elle était de nature à léser l’intérêt de tiers suffi-
samment désignés,
i La Cour approuve donc le refus d’inserlion que le
\ Comité de la Société des Artistes avait opposé à
M. Dupré, et il condamne M. Dupré aux dépens.
{Le Temps).