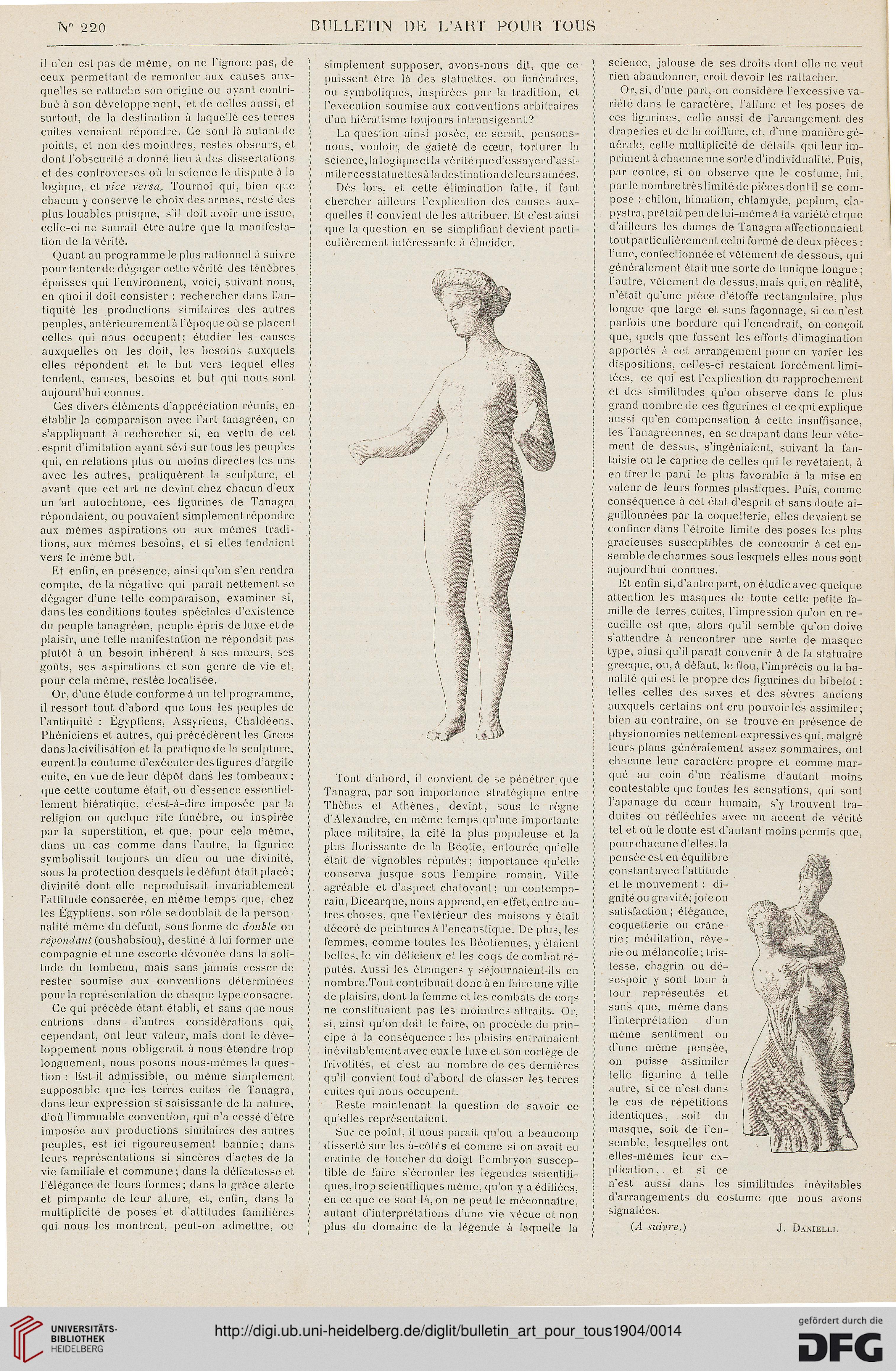IV 220
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
il n’en est pas de même, on ne l’ignore pas, de )
ceux permettant de remonter aux causes aux-
quelles se rattache son origine ou ayant contri-
bue à son développement, et de celles aussi, cL j
surtout, de la destination à laquelle ces terres
cuites venaient répondre. Ce sont là autant de
points, et non des moindres, restés obscurs, et
dont l’obscurité a donné lieu à des dissertations
et des controverses où la science le dispute à la |
logique, et vice versa. Tournoi qui, bien cpie
chacun y conserve le choix des armes, reste des j
plus louables puisque, s’il doit avoir une issue,
celle-ci ne saurait être autre que la manifesta-
tion de la vérité.
Quant au programme le plus rationnel à suivre j
pour lenterde dégager celle vérité des ténèbres
épaisses qui l’environnent, voici, suivant nous,
en quoi il doit consister : rechercher dans l’an-
tiquité les productions similaires des autres
peuples, antérieurement à l’époque où se placent
celles qui nous occupent; étudier les causes
auxquelles on les doit, les besoins auxquels
elles répondent et le but vers lequel elles
tendent, causes, besoins et but qui nous sont j
aujourd’hui connus.
Ces divers éléments d’appréciation réunis, en
établir la comparaison avec l’art tanagréen, en
s’appliquant à rechercher si, en vertu de cet
. esprit d’imitation ayant sévi sur tous les peuples
qui, en relations plus ou moins directes les uns
avec les autres, pratiquèrent la sculpture, et
avant que cet art ne devînt chez chacun d’eux
un art autochtone, ces figurines de Tanagra
répondaient, ou pouvaient simplement répondre
aux mêmes aspirations ou aux mêmes tradi-
tions, aux mêmes besoins, et si elles tendaient
vers le même but. i
Et enfin, en présence, ainsi qu’on s’en rendra
compte, de la négative cpti paraît nettement se ;
dégager d’une telle comparaison, examiner si,
dans les conditions toutes spéciales d’existence !
du peuple tanagréen, peuple épris de luxe eide
plaisir, une telle manifestation ne répondait pas
plutôt à un besoin inhérent à scs mœurs, ses
goûts, ses aspirations et son genre de vie et,
pour cela môme, restée localisée.
Or, d’une élude conforme à un tel programme,
il ressort tout d’abord que tous les peuples de
l’antiquité : Égyptiens, Assyriens, Chaldéens,
Phéniciens et autres, qui précédèrent les Grecs
dans la civilisation et la pratique de la sculpture,
eurent la coutume d’exécuter des figures d’argile ;
cuite, en vue de leur dépôt dans les tombeaux ; !
que cette coutume élait, ou d’essence essentiel-
lement hiératique, c’est-à-dire imposée par la i
religion ou quelque rite funèbre, ou inspirée
par la superstition, et que, pour cela même,
dans un cas comme dans l’autre, la figurine
symbolisait toujours un dieu ou une divinité,
sous la protection desquels le défunt était placé;
divinité dont elle reproduisait invariablement
l'altitude consacrée, en même temps que, chez
les Égyptiens, son rôle se doublait de la person-
nalité même du défunt, sous forme de double ou j
répondant (oushabsiou), destiné à lui former une
compagnie et une escorte dévouée dans la soli- j
tude du tombeau, mais sans jamais cesser de j
rester soumise aux conventions déterminées
pour la représentation de chaque type consacré.
Ce qui précède étant établi, et sans que nous j
entrions dans d’autres considérations qui, j
cependant, ont leur valeur, mais dont le déve-
loppement nous obligerait à nous étendre trop
longuement, nous posons nous-mêmes la ques-
tion : Est-il admissible, ou même simplement \
supposable que les terres cuites de Tanagra,
dans leur expression si saisissante de la nature,
d’où l’immuable convention, qui n’a cessé d’être
imposée aux productions similaires des autres
peuples, est ici rigoureusement bannie; dans
leurs représentations si sincères d’actes de la
vie familiale el commune ; dans la délicatesse et
l’élégance de leurs formes; dans la grâce alerte
et pimpante de leur allure, et, enfin, dans la
multiplicité de poses et d’altitudes familières
qui nous les montrent, peut-on admettre, ou
simplement supposer, avons-nous dit, que ce
puissent être là des statuettes, ou funéraires,
ou symboliques, inspirées par la tradition, et
l’exécution soumise aux conventions arbitraires
d’un hiératisme toujours intransigeant?
La question ainsi posée, ce serait, pensons-
nous, vouloir, de gaieté de cœur, torturer la
science, la logique et la vérité que d’essayerd’assi-
rnilcr ccs statuettes à la destina lion de leurs aînées.
Dès lors, et celle élimination faite, il faut
chercher ailleurs l’explication des causes aux-
quelles il convient de les attribuer. Et c’est ainsi
que la question en se simplifiant devient parti-
culièrement intéressante à élucider.
Tout d’abord, il convient de se pénétrer (pie
Tanagra, par son importance stratégique entre
Thcbes et Athènes, devint, sous le règne
d’Alexandre, en même temps qu’une importante
place militaire, la cité la plus populeuse et la
plus florissante de la Béotie, entourée qu’elle
élait de vignobles réputés; importance qu’elle
conserva jusque sous l’empire romain. Ville
agréable et d’aspect chatoyant; un contempo-
rain, Dicearquc, nous apprend, en effet,entre au-
tres choses, que l’extérieur des maisons y était
décoré de peintures à l’encaustique. De plus, les
femmes, comme toutes les Béotiennes, y étaient
belles, le vin délicieux el les coqs de combat ré-
putés. Aussi les étrangers y séjournaient-ils en
nombre.Tout contribuait donc à en faire une ville
de plaisirs, dont la femme et les combats de coqs
ne constituaient pas les moindres attraits. Or,
si, ainsi qu’on doit le faire, on procède du prin-
cipe à la conséquence : les plaisirs entraînaient
inévitablement avec eux le luxe et son cortège de
frivolités, et c’est au nombre de ces dernières
qu’il convient tout d’abord de classer les terres
cuites qui nous occupent.
Reste maintenant la question de savoir ce
qu’elles représentaient.
Sur ce point, il nous paraît qu’on a beaucoup
disserté sur les à-côtés et comme si on avait eu
crainte de toucher du doigt l’embryon suscep-
tible de faire s’écrouler les légendes scientifi-
ques, trop scientifiques même, qu’on y a édifiées,
en ce que ce sont là, on ne peut le méconnaître,
autant d’interprétations d’une vie vécue el non
plus du domaine de la légende à laquelle la
science, jalouse de ses droits dont elle ne veut
rien abandonner, croit devoir les rattacher.
Or, si, d'une pari, on considère l’excessive va-
riété dans le caractère, l’allure et les poses de
ccs figurines, celle aussi de l’arrangement des
draperies et de la coiffure, et, d’une manière gé-
nérale, cette multiplicité de détails qui leur im-
priment à chacune une sorte d’individualité. Puis,
par contre, si on observe que le costume, lui,
parle nombre très limité de pièces dont il se com-
pose : chilon, himation, chlamyde, péplum, cla-
pyslra, prêtait peu de lui-même à la variété et que
d’ailleurs les dames de Tanagra affectionnaient
tout particulièrement celui formé de deux pièces :
l’une, confectionnée et vêlement de dessous, qui
généralement était une sorte de tunique longue ;
l’autre, vêlement de dessus, mais qui, en réalité,
n’était qu’une pièce d’étoffe rectangulaire, plus
longue que large et sans façonnage, si ce n’est
parfois une bordure qui l’encadrait, on conçoit
que, quels que fussent les efforts d’imagination
apportés à cet arrangement pour en varier les
dispositions, celles-ci restaient forcément limi-
tées, ce qui est l’explication du rapprochement
et des similitudes qu’on observe dans le plus
grand nombre de ces figurines et ce qui explique
aussi qu’en compensation à cette insuffisance,
les Tanagréennes, en se drapant dans leur vête-
ment de dessus, s’ingéniaient, suivant la fan-
taisie ou le caprice de celles qui le revêtaient, à
en tirer le parti le plus favorable à la mise en
valeur de leurs formes plastiques. Puis, comme
conséquence à cet état d’esprit et sans doute ai-
guillonnées par la coquetterie, elles devaient se
confiner dans l’étroite limite des poses les plus
gracieuses susceptibles de concourir à cet en-
semble de charmes sous lesquels elles nous sont
aujourd’hui connues.
Et enfin si, d’autre part, on étudie avec quelque
attention les masques de toute cette petite fa-
mille de terres cuites, l’impression qu’on en re-
cueille est que, alors qu’il semble qu’on doive
s’attendre à rencontrer une sorte de masque
type, ainsi qu’il paraît convenir à de la statuaire
grecque, ou, à défaut, le flou, l’imprécis ou la ba-
nalité qui est le propre des figurines du bibelot :
telles celles des saxes et des sèvres anciens
auxquels certains ont cru pouvoirles assimiler;
bien au contraire, on se trouve en présence de
physionomies nettement expressives qui, malgré
leurs plans généralement assez sommaires, ont
chacune leur caractère propre et comme mar-
qué au coin d’un réalisme d’autant moins
contestable que toutes les sensations, qui sont
l’apanage du cœur humain, s'y trouvent tra-
duites ou réfléchies avec un accent de vérité
tel et où le doute est d’autant moins permis que,
pour chacune d'elles, la
pensée est en équilibre
constant avec l’attitude
et le mouvement : di-
gnité ou gravité; joieou
satisfaction; élégance,
coquetterie ou crâne-
rie ; méditation, rêve-
rie ou mélancolie; tris-
tesse, chagrin ou dé-
sespoir y sont tour à
tour représentés et
sans que, même dans
l’interprétation d’un
même sentiment ou
d’une même pensée,
on puisse assimiler
telle figurine à telle
autre, si ce n’est dans
le cas de répétitions
identiques, soit du
masque, soit de l’en-
semble, lesquelles onL
elles-mêmes leur ex-
plication , et si ce
n’est aussi dans les similitudes inévitables
d’arrangements du costume que nous avons
signalées.
(A suivre.) J. Danielli.
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
il n’en est pas de même, on ne l’ignore pas, de )
ceux permettant de remonter aux causes aux-
quelles se rattache son origine ou ayant contri-
bue à son développement, et de celles aussi, cL j
surtout, de la destination à laquelle ces terres
cuites venaient répondre. Ce sont là autant de
points, et non des moindres, restés obscurs, et
dont l’obscurité a donné lieu à des dissertations
et des controverses où la science le dispute à la |
logique, et vice versa. Tournoi qui, bien cpie
chacun y conserve le choix des armes, reste des j
plus louables puisque, s’il doit avoir une issue,
celle-ci ne saurait être autre que la manifesta-
tion de la vérité.
Quant au programme le plus rationnel à suivre j
pour lenterde dégager celle vérité des ténèbres
épaisses qui l’environnent, voici, suivant nous,
en quoi il doit consister : rechercher dans l’an-
tiquité les productions similaires des autres
peuples, antérieurement à l’époque où se placent
celles qui nous occupent; étudier les causes
auxquelles on les doit, les besoins auxquels
elles répondent et le but vers lequel elles
tendent, causes, besoins et but qui nous sont j
aujourd’hui connus.
Ces divers éléments d’appréciation réunis, en
établir la comparaison avec l’art tanagréen, en
s’appliquant à rechercher si, en vertu de cet
. esprit d’imitation ayant sévi sur tous les peuples
qui, en relations plus ou moins directes les uns
avec les autres, pratiquèrent la sculpture, et
avant que cet art ne devînt chez chacun d’eux
un art autochtone, ces figurines de Tanagra
répondaient, ou pouvaient simplement répondre
aux mêmes aspirations ou aux mêmes tradi-
tions, aux mêmes besoins, et si elles tendaient
vers le même but. i
Et enfin, en présence, ainsi qu’on s’en rendra
compte, de la négative cpti paraît nettement se ;
dégager d’une telle comparaison, examiner si,
dans les conditions toutes spéciales d’existence !
du peuple tanagréen, peuple épris de luxe eide
plaisir, une telle manifestation ne répondait pas
plutôt à un besoin inhérent à scs mœurs, ses
goûts, ses aspirations et son genre de vie et,
pour cela môme, restée localisée.
Or, d’une élude conforme à un tel programme,
il ressort tout d’abord que tous les peuples de
l’antiquité : Égyptiens, Assyriens, Chaldéens,
Phéniciens et autres, qui précédèrent les Grecs
dans la civilisation et la pratique de la sculpture,
eurent la coutume d’exécuter des figures d’argile ;
cuite, en vue de leur dépôt dans les tombeaux ; !
que cette coutume élait, ou d’essence essentiel-
lement hiératique, c’est-à-dire imposée par la i
religion ou quelque rite funèbre, ou inspirée
par la superstition, et que, pour cela même,
dans un cas comme dans l’autre, la figurine
symbolisait toujours un dieu ou une divinité,
sous la protection desquels le défunt était placé;
divinité dont elle reproduisait invariablement
l'altitude consacrée, en même temps que, chez
les Égyptiens, son rôle se doublait de la person-
nalité même du défunt, sous forme de double ou j
répondant (oushabsiou), destiné à lui former une
compagnie et une escorte dévouée dans la soli- j
tude du tombeau, mais sans jamais cesser de j
rester soumise aux conventions déterminées
pour la représentation de chaque type consacré.
Ce qui précède étant établi, et sans que nous j
entrions dans d’autres considérations qui, j
cependant, ont leur valeur, mais dont le déve-
loppement nous obligerait à nous étendre trop
longuement, nous posons nous-mêmes la ques-
tion : Est-il admissible, ou même simplement \
supposable que les terres cuites de Tanagra,
dans leur expression si saisissante de la nature,
d’où l’immuable convention, qui n’a cessé d’être
imposée aux productions similaires des autres
peuples, est ici rigoureusement bannie; dans
leurs représentations si sincères d’actes de la
vie familiale el commune ; dans la délicatesse et
l’élégance de leurs formes; dans la grâce alerte
et pimpante de leur allure, et, enfin, dans la
multiplicité de poses et d’altitudes familières
qui nous les montrent, peut-on admettre, ou
simplement supposer, avons-nous dit, que ce
puissent être là des statuettes, ou funéraires,
ou symboliques, inspirées par la tradition, et
l’exécution soumise aux conventions arbitraires
d’un hiératisme toujours intransigeant?
La question ainsi posée, ce serait, pensons-
nous, vouloir, de gaieté de cœur, torturer la
science, la logique et la vérité que d’essayerd’assi-
rnilcr ccs statuettes à la destina lion de leurs aînées.
Dès lors, et celle élimination faite, il faut
chercher ailleurs l’explication des causes aux-
quelles il convient de les attribuer. Et c’est ainsi
que la question en se simplifiant devient parti-
culièrement intéressante à élucider.
Tout d’abord, il convient de se pénétrer (pie
Tanagra, par son importance stratégique entre
Thcbes et Athènes, devint, sous le règne
d’Alexandre, en même temps qu’une importante
place militaire, la cité la plus populeuse et la
plus florissante de la Béotie, entourée qu’elle
élait de vignobles réputés; importance qu’elle
conserva jusque sous l’empire romain. Ville
agréable et d’aspect chatoyant; un contempo-
rain, Dicearquc, nous apprend, en effet,entre au-
tres choses, que l’extérieur des maisons y était
décoré de peintures à l’encaustique. De plus, les
femmes, comme toutes les Béotiennes, y étaient
belles, le vin délicieux el les coqs de combat ré-
putés. Aussi les étrangers y séjournaient-ils en
nombre.Tout contribuait donc à en faire une ville
de plaisirs, dont la femme et les combats de coqs
ne constituaient pas les moindres attraits. Or,
si, ainsi qu’on doit le faire, on procède du prin-
cipe à la conséquence : les plaisirs entraînaient
inévitablement avec eux le luxe et son cortège de
frivolités, et c’est au nombre de ces dernières
qu’il convient tout d’abord de classer les terres
cuites qui nous occupent.
Reste maintenant la question de savoir ce
qu’elles représentaient.
Sur ce point, il nous paraît qu’on a beaucoup
disserté sur les à-côtés et comme si on avait eu
crainte de toucher du doigt l’embryon suscep-
tible de faire s’écrouler les légendes scientifi-
ques, trop scientifiques même, qu’on y a édifiées,
en ce que ce sont là, on ne peut le méconnaître,
autant d’interprétations d’une vie vécue el non
plus du domaine de la légende à laquelle la
science, jalouse de ses droits dont elle ne veut
rien abandonner, croit devoir les rattacher.
Or, si, d'une pari, on considère l’excessive va-
riété dans le caractère, l’allure et les poses de
ccs figurines, celle aussi de l’arrangement des
draperies et de la coiffure, et, d’une manière gé-
nérale, cette multiplicité de détails qui leur im-
priment à chacune une sorte d’individualité. Puis,
par contre, si on observe que le costume, lui,
parle nombre très limité de pièces dont il se com-
pose : chilon, himation, chlamyde, péplum, cla-
pyslra, prêtait peu de lui-même à la variété et que
d’ailleurs les dames de Tanagra affectionnaient
tout particulièrement celui formé de deux pièces :
l’une, confectionnée et vêlement de dessous, qui
généralement était une sorte de tunique longue ;
l’autre, vêlement de dessus, mais qui, en réalité,
n’était qu’une pièce d’étoffe rectangulaire, plus
longue que large et sans façonnage, si ce n’est
parfois une bordure qui l’encadrait, on conçoit
que, quels que fussent les efforts d’imagination
apportés à cet arrangement pour en varier les
dispositions, celles-ci restaient forcément limi-
tées, ce qui est l’explication du rapprochement
et des similitudes qu’on observe dans le plus
grand nombre de ces figurines et ce qui explique
aussi qu’en compensation à cette insuffisance,
les Tanagréennes, en se drapant dans leur vête-
ment de dessus, s’ingéniaient, suivant la fan-
taisie ou le caprice de celles qui le revêtaient, à
en tirer le parti le plus favorable à la mise en
valeur de leurs formes plastiques. Puis, comme
conséquence à cet état d’esprit et sans doute ai-
guillonnées par la coquetterie, elles devaient se
confiner dans l’étroite limite des poses les plus
gracieuses susceptibles de concourir à cet en-
semble de charmes sous lesquels elles nous sont
aujourd’hui connues.
Et enfin si, d’autre part, on étudie avec quelque
attention les masques de toute cette petite fa-
mille de terres cuites, l’impression qu’on en re-
cueille est que, alors qu’il semble qu’on doive
s’attendre à rencontrer une sorte de masque
type, ainsi qu’il paraît convenir à de la statuaire
grecque, ou, à défaut, le flou, l’imprécis ou la ba-
nalité qui est le propre des figurines du bibelot :
telles celles des saxes et des sèvres anciens
auxquels certains ont cru pouvoirles assimiler;
bien au contraire, on se trouve en présence de
physionomies nettement expressives qui, malgré
leurs plans généralement assez sommaires, ont
chacune leur caractère propre et comme mar-
qué au coin d’un réalisme d’autant moins
contestable que toutes les sensations, qui sont
l’apanage du cœur humain, s'y trouvent tra-
duites ou réfléchies avec un accent de vérité
tel et où le doute est d’autant moins permis que,
pour chacune d'elles, la
pensée est en équilibre
constant avec l’attitude
et le mouvement : di-
gnité ou gravité; joieou
satisfaction; élégance,
coquetterie ou crâne-
rie ; méditation, rêve-
rie ou mélancolie; tris-
tesse, chagrin ou dé-
sespoir y sont tour à
tour représentés et
sans que, même dans
l’interprétation d’un
même sentiment ou
d’une même pensée,
on puisse assimiler
telle figurine à telle
autre, si ce n’est dans
le cas de répétitions
identiques, soit du
masque, soit de l’en-
semble, lesquelles onL
elles-mêmes leur ex-
plication , et si ce
n’est aussi dans les similitudes inévitables
d’arrangements du costume que nous avons
signalées.
(A suivre.) J. Danielli.