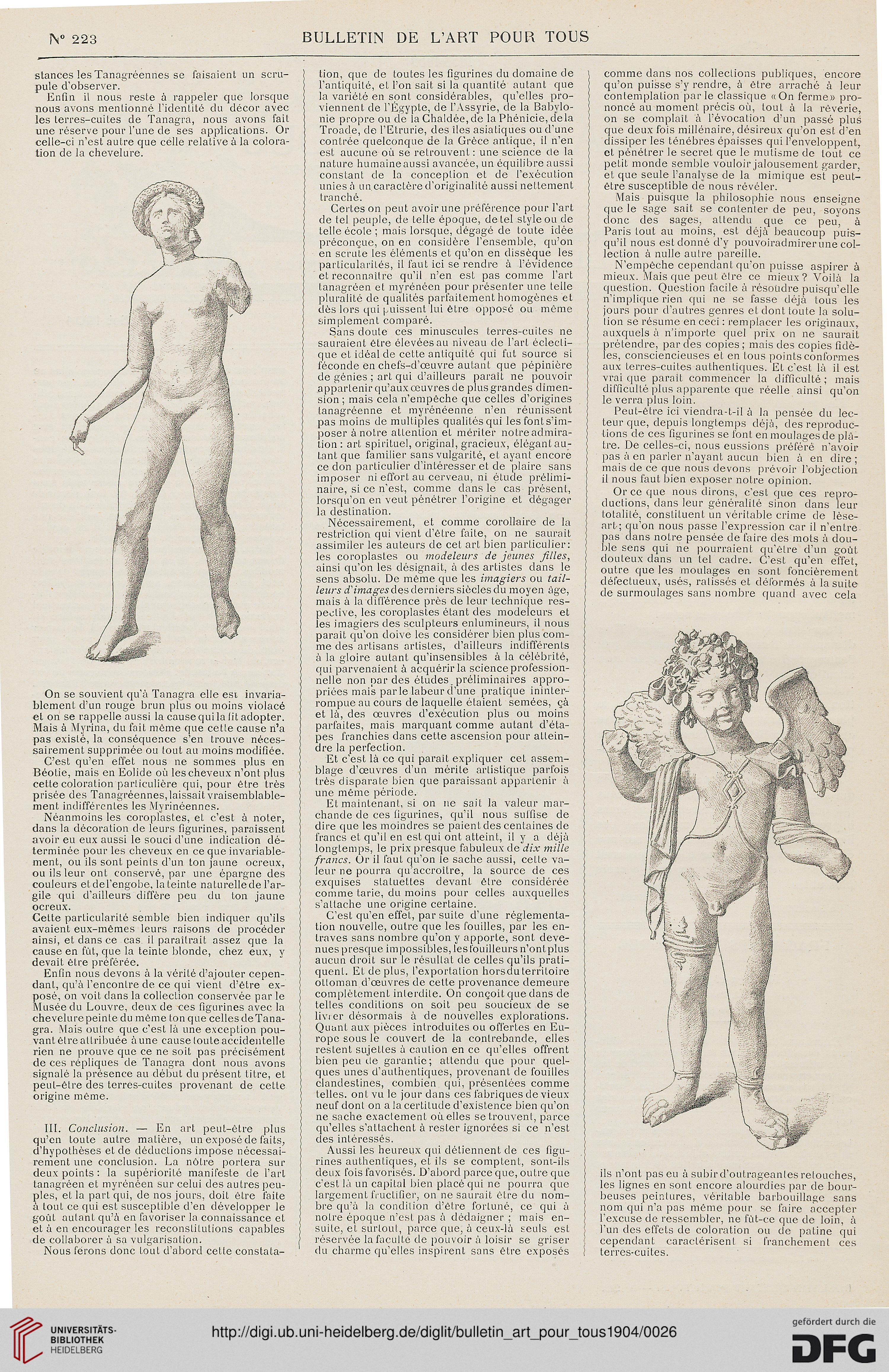IV 223
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
stances les Tanagréennes se faisaient un scru-
pule d’observer.
Enfin il nous reste à rappeler que lorsque
nous avons mentionné l’identité du décor avec
les terres-cuites de Tanagra, nous avons fait
une réserve pour l’une de ses applications. Or
celle-ci n’est autre que celle relative à la colora-
tion de la chevelure.
On se souvient qu’à Tanagra elle est invaria-
blement d’un rouge brun plus ou moins violacé
et on se rappelle aussi la cause qui la fit adopter.
Mais à Myrina, du fait même que cette cause n’a
pas existé, la conséquence s’en Irouve néces-
sairement supprimée ou tout au moins modifiée.
C’est qu’en effet nous ne sommes plus en
Béotie, mais en Eolide où les cheveux n’ont plus
cette coloration particulière qui, pour être très
prisée des Tanagréennes, laissait vraisemblable-
ment indifférentes les Myrinéennes.
Néanmoins les coroplastes, et c’est à noter,
dans la décoration de leurs figurines, paraissent
avoir eu eux aussi le souci d’une indication dé-
terminée pour les cheveux en ce que invariable-
ment, ou ils sont peints d’un ton jaune ocreux,
ou ils leur ont conservé, par une épargne des
couleurs etdel’engobe, la teinte naturelle de l’ar-
gile qui d’ailleurs diffère peu du ton jaune
ocreux.
Cette particularité semble bien indiquer qu’ils
avaient eux-mêmes leurs raisons de procéder
ainsi, et dans ce cas il paraîtrait assez que la
cause en fût, que la teinte blonde, chez eux, y
devait être préférée.
Enfin nous devons à la vérité d’ajouter cepen-
dant, qu’à l’encontre de ce qui vient d’être ex-
posé, on voit dans la collection conservée par le
Musée du Louvre, deux de ces figurines avec la
chevelurepeinte du même ton que cellesdeTana-
gra. Mais outre que c’est là une exception pou-
vant être attribuée à une cause toute accidentelle
rien ne prouve que ce ne soit pas précisément
de ces répliques de Tanagra dont nous avons
signalé la présence au début du présent titre, et
peut-être des terres-cuites provenant de cette
origine même.
III. Conclusion. — En art peut-être plus
qu’en toute autre matière, un exposé de faits,
d’hypothèses et de déductions impose nécessai-
rement une conclusion. La nôtre portera sur
deux points : la supériorité manifeste de l’art
tanagréen et myrénéen sur celui des autres peu-
ples, et la part qui, de nos jours, doit être faite
à tout ce qui est susceptible d’en développer le
goût autant qu’à en favoriser la connaissance et
et à en encourager les reconstitutions capables
de collaborer à sa vulgarisation.
Nous ferons donc tout d’abord cette constata-
tion, que de toutes les figurines du domaine de
l’antiquité, et l’on sait si la quantité autant que
la variété en sont considérables, qu’elles pro-
viennent de l’Égypte, de l’Assyrie, de la Babylo-
nie propre ou de laChaldée,de la Phénicie, delà
Troade, de l’Etrurie, des îles asiatiques ou d’une
contrée quelconque de la Grèce antique, il n’en
est aucune où se retrouvent : une science de la
nature humaine aussi avancée, un équilibre aussi
constant de la conception et de l’exécution
unies à un caractère d’originalité aussi nettement
tranché.
Certes on peut avoir une préférence pour l’art
de tel peuple, de telle époque, de tel style ou de
telle école ; mais lorsque, dégagé de toute idée
préconçue, on en considère l’ensemble, qu’on
en scrute les éléments et qu’on en dissèque les
particularités, il faut ici se rendre à l’évidence
et reconnaître qu’il n’en est pas comme l’art
tanagréen et myrénéen pour présenter une telle
pluralité de qualités parfaitement homogènes et
dès lors qui puissent lui être opposé ou même
simplement comparé.
Sans doute ces minuscules terres-cuites ne
sauraient être élevées au niveau de l’art éclecti-
que et idéal de cette antiquité qui fut source si
féconde en chefs-d’œuvre autant que pépinière
de génies ; art qui d’ailleurs paraît ne pouvoir
appartenir qu’aux œuvres de plus grandes dimen-
sion ; mais cela n’empêche que celles d’origines
tanagréenne et myrénéenne n’en réunissent I
pas moins de multiples qualités qui les fonts’im- |
poser à notre attention et mériter notre admira- j
tion : art spirituel, original, gracieux, élégant au- <
tant que familier sans vulgarité, et ayant encore
ce don particulier d’intéresser et de plaire sans j
imposer ni effort au cerveau, ni élude prélimi- j
naire, si ce n’est, comme dans le cas présent,
lorsqu’on en veut pénétrer l’origine et dégager
la destination.
Nécessairement, et comme corollaire de la
restriction qui vient d’être faite, on ne saurait
assimiler les auteurs de cet art bien particulier: !
les coroplastes ou modeleurs de jeunes filles, j
ainsi qu’on les désignait, à des artistes dans le
sens absolu. De même que les imagiers ou tail- [
leurs d'images des derniers siècles du moyen âge, j
mais à la différence près de leur technique res-
peetive, les coroplastes étant des modeleurs et j
les imagiers des sculpteurs enlumineurs, il nous
parait qu’on doive les considérer bien plus com-
me des artisans artistes, d’ailleurs indifférents
à la gloire autant qu’insensibles à la célébrité, j
qui parvenaient à acquérir la science profession- ;
nelle non par des études.préliminaires appro- j
priées mais parle labeur d’une pratique ininter-
rompue au cours de laquelle étaient semées, çà j
et là, des œuvres d’exécution plus ou moins
parfaites, mais marquant comme autant d’éta-
pes franchies dans cette ascension pour attein-
dre la perfection.
Et c’est là ce qui parait expliquer cet assem-
blage d’œuvres d’un mérite artistique parfois ;
très disparate bien que paraissant appartenir à \
une même période.
Et maintenant, si on ne sait la valeur mar-
chande de ces figurines, qu’il nous suffise de ;
dire que les moindres se paient des centaines de
francs et qu’il en est qui ont atteint, il y a déjà
longtemps, le prix presque fabuleux de dix mille i
francs. Ur il faut qu’on le sache aussi, cette va- ;
leur ne pourra qu’accroître, la source de ces !
exquises statuettes devant être considérée j
comme tarie, du moins pour celles auxquelles >
s’attache une origine certaine.
C’est qu’en effet, par suite d’une réglementa- !
tion nouvelle, outre que les fouilles, par les en- ;
traves sans nombre qu’on y apporte, sont deve- j
nues presque impossibles, lesfouilieurs n’ont plus
aucun droit sur le résultat de celles qu’ils prati- !
quent. Et déplus, l’exportation horsduterritoire j
ottoman d’œuvres de cette provenance demeure \
complètement interdite. On conçoit que dans de \
telles conditions on soit peu soucieux de se
livrer désormais à de nouvelles explorations.
Quant aux pièces introduites ou offertes en Eu- J
rope sous le couvert de la contrebande, elles
restent sujettes à caution en ce qu’elles offrent j
bien peu rie garantie; attendu que pour quel-
ques unes d’authentiques, provenant de fouilles
clandestines, combien qui, présentées comme j
telles, ont vu le jour dans ces fabriques de vieux
neuf dont on a la certitude d’existence bien qu’on !
ne sache exactement où elles se trouvent, parce
qu’elles s’attachent à rester ignorées si ce n’est
des intéressés.
Aussi les heureux qui détiennent de ces figu-
rines authentiques, et ils se comptent, sont-ils
deux fois favorisés. D’abord parce que, outre que
c’est là un capital bien placé qui ne pourra que
largement fructifier, on ne saurait être du nom-
bre qu’à la condition d’être fortuné, ce qui à |
notre époque n’est pas à dédaigner ; mais en-
suite, et surtout, parce que, à ceux-là seuls est
réservée la faculté de pouvoir à loisir se griser (
du charme qu’elles inspirent sans être exposés \
comme dans nos collections publiques, encore
qu’on puisse s’y rendre, à être arraché à leur
contemplation parle classique «On ferme» pro-
noncé au moment précis où, tout à la rêverie,
on se complaît à l’évocation d’un passé plus
que deux fois millénaire, désireux qu’on est d’en
dissiper les ténèbres épaisses qui l’enveloppent,
et pénétrer le secret que le mutisme de tout ce
petit monde semble vouloir jalousement garder,
et que seule l’analyse de la mimique est’ peut-
être susceptible de nous révéler.
Mais puisque la philosophie nous enseigne
que le sage sait se contenter de peu, soyons
donc des sages, attendu que ce peu, à
Paris tout au moins, est déjà beaucoup puis-
qu’il nous est donné d’y pouvoiradmirer une col-
lection à nulle autre pareille.
N’empêche cependant qu’on puisse aspirer à
mieux. Mais que peut être ce mieux? Voilà la
question. Question facile à résoudre puisqu’elle
n’implique rien qui ne se fasse déjà tous les
jours pour d’autres genres et dont toute la solu-
tion se résume en ceci : remplacer les originaux,
auxquels à n’importe quel prix on ne saurait
prétendre, par des copies ; mais des copies fidè-
les, consciencieuses et en tous points conformes
aux terres-cuites authentiques. Et c’est là il est
vrai que parait commencer la difficulté ; mais
difficulté plus apparente que réelle ainsi qu’on
le verra plus loin.
Peut-être ici viendra-t-il à la pensée du lec-
teur que, depuis longtemps déjà, des reproduc-
tions de ces figurines se font en moulages de plâ-
tre. De celles-ci, nous eussions préféré n’avoir
pas à en parler n’ayant aucun bien à en dire ;
mais de ce que nous devons prévoir l’objection
il nous faut bien exposer notre opinion.
Or ce que nous dirons, c’est que ces repro-
ductions, dans leur généralité sinon dans leur
totalité, constituent un véritable crime de lèse-
art; qu’on nous passe l’expression car il n’entre
pas dans notre pensée de faire des mots à dou-
ble sens qui ne pourraient qu’être d’un goût
douteux dans un tel cadre. C’est qu’en effet,
outre que les moulages en sont foncièrement
défectueux, usés, ratissés et déformés à la suite
de surmoulages sans nombre quand avec cela
ils n’ont pas eu à subird’outrageantes retouches,
les lignes en sont encore alourdies par de bour-
beuses peintures, véritable barbouillage sans
nom qui n’a pas même pour se faire accepter
l’excuse de ressembler, ne fût-ce que de loin, à
l’un des effets de coloration ou de patine qui
cependant caractérisent si franchement ces
terres-cuites.
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
stances les Tanagréennes se faisaient un scru-
pule d’observer.
Enfin il nous reste à rappeler que lorsque
nous avons mentionné l’identité du décor avec
les terres-cuites de Tanagra, nous avons fait
une réserve pour l’une de ses applications. Or
celle-ci n’est autre que celle relative à la colora-
tion de la chevelure.
On se souvient qu’à Tanagra elle est invaria-
blement d’un rouge brun plus ou moins violacé
et on se rappelle aussi la cause qui la fit adopter.
Mais à Myrina, du fait même que cette cause n’a
pas existé, la conséquence s’en Irouve néces-
sairement supprimée ou tout au moins modifiée.
C’est qu’en effet nous ne sommes plus en
Béotie, mais en Eolide où les cheveux n’ont plus
cette coloration particulière qui, pour être très
prisée des Tanagréennes, laissait vraisemblable-
ment indifférentes les Myrinéennes.
Néanmoins les coroplastes, et c’est à noter,
dans la décoration de leurs figurines, paraissent
avoir eu eux aussi le souci d’une indication dé-
terminée pour les cheveux en ce que invariable-
ment, ou ils sont peints d’un ton jaune ocreux,
ou ils leur ont conservé, par une épargne des
couleurs etdel’engobe, la teinte naturelle de l’ar-
gile qui d’ailleurs diffère peu du ton jaune
ocreux.
Cette particularité semble bien indiquer qu’ils
avaient eux-mêmes leurs raisons de procéder
ainsi, et dans ce cas il paraîtrait assez que la
cause en fût, que la teinte blonde, chez eux, y
devait être préférée.
Enfin nous devons à la vérité d’ajouter cepen-
dant, qu’à l’encontre de ce qui vient d’être ex-
posé, on voit dans la collection conservée par le
Musée du Louvre, deux de ces figurines avec la
chevelurepeinte du même ton que cellesdeTana-
gra. Mais outre que c’est là une exception pou-
vant être attribuée à une cause toute accidentelle
rien ne prouve que ce ne soit pas précisément
de ces répliques de Tanagra dont nous avons
signalé la présence au début du présent titre, et
peut-être des terres-cuites provenant de cette
origine même.
III. Conclusion. — En art peut-être plus
qu’en toute autre matière, un exposé de faits,
d’hypothèses et de déductions impose nécessai-
rement une conclusion. La nôtre portera sur
deux points : la supériorité manifeste de l’art
tanagréen et myrénéen sur celui des autres peu-
ples, et la part qui, de nos jours, doit être faite
à tout ce qui est susceptible d’en développer le
goût autant qu’à en favoriser la connaissance et
et à en encourager les reconstitutions capables
de collaborer à sa vulgarisation.
Nous ferons donc tout d’abord cette constata-
tion, que de toutes les figurines du domaine de
l’antiquité, et l’on sait si la quantité autant que
la variété en sont considérables, qu’elles pro-
viennent de l’Égypte, de l’Assyrie, de la Babylo-
nie propre ou de laChaldée,de la Phénicie, delà
Troade, de l’Etrurie, des îles asiatiques ou d’une
contrée quelconque de la Grèce antique, il n’en
est aucune où se retrouvent : une science de la
nature humaine aussi avancée, un équilibre aussi
constant de la conception et de l’exécution
unies à un caractère d’originalité aussi nettement
tranché.
Certes on peut avoir une préférence pour l’art
de tel peuple, de telle époque, de tel style ou de
telle école ; mais lorsque, dégagé de toute idée
préconçue, on en considère l’ensemble, qu’on
en scrute les éléments et qu’on en dissèque les
particularités, il faut ici se rendre à l’évidence
et reconnaître qu’il n’en est pas comme l’art
tanagréen et myrénéen pour présenter une telle
pluralité de qualités parfaitement homogènes et
dès lors qui puissent lui être opposé ou même
simplement comparé.
Sans doute ces minuscules terres-cuites ne
sauraient être élevées au niveau de l’art éclecti-
que et idéal de cette antiquité qui fut source si
féconde en chefs-d’œuvre autant que pépinière
de génies ; art qui d’ailleurs paraît ne pouvoir
appartenir qu’aux œuvres de plus grandes dimen-
sion ; mais cela n’empêche que celles d’origines
tanagréenne et myrénéenne n’en réunissent I
pas moins de multiples qualités qui les fonts’im- |
poser à notre attention et mériter notre admira- j
tion : art spirituel, original, gracieux, élégant au- <
tant que familier sans vulgarité, et ayant encore
ce don particulier d’intéresser et de plaire sans j
imposer ni effort au cerveau, ni élude prélimi- j
naire, si ce n’est, comme dans le cas présent,
lorsqu’on en veut pénétrer l’origine et dégager
la destination.
Nécessairement, et comme corollaire de la
restriction qui vient d’être faite, on ne saurait
assimiler les auteurs de cet art bien particulier: !
les coroplastes ou modeleurs de jeunes filles, j
ainsi qu’on les désignait, à des artistes dans le
sens absolu. De même que les imagiers ou tail- [
leurs d'images des derniers siècles du moyen âge, j
mais à la différence près de leur technique res-
peetive, les coroplastes étant des modeleurs et j
les imagiers des sculpteurs enlumineurs, il nous
parait qu’on doive les considérer bien plus com-
me des artisans artistes, d’ailleurs indifférents
à la gloire autant qu’insensibles à la célébrité, j
qui parvenaient à acquérir la science profession- ;
nelle non par des études.préliminaires appro- j
priées mais parle labeur d’une pratique ininter-
rompue au cours de laquelle étaient semées, çà j
et là, des œuvres d’exécution plus ou moins
parfaites, mais marquant comme autant d’éta-
pes franchies dans cette ascension pour attein-
dre la perfection.
Et c’est là ce qui parait expliquer cet assem-
blage d’œuvres d’un mérite artistique parfois ;
très disparate bien que paraissant appartenir à \
une même période.
Et maintenant, si on ne sait la valeur mar-
chande de ces figurines, qu’il nous suffise de ;
dire que les moindres se paient des centaines de
francs et qu’il en est qui ont atteint, il y a déjà
longtemps, le prix presque fabuleux de dix mille i
francs. Ur il faut qu’on le sache aussi, cette va- ;
leur ne pourra qu’accroître, la source de ces !
exquises statuettes devant être considérée j
comme tarie, du moins pour celles auxquelles >
s’attache une origine certaine.
C’est qu’en effet, par suite d’une réglementa- !
tion nouvelle, outre que les fouilles, par les en- ;
traves sans nombre qu’on y apporte, sont deve- j
nues presque impossibles, lesfouilieurs n’ont plus
aucun droit sur le résultat de celles qu’ils prati- !
quent. Et déplus, l’exportation horsduterritoire j
ottoman d’œuvres de cette provenance demeure \
complètement interdite. On conçoit que dans de \
telles conditions on soit peu soucieux de se
livrer désormais à de nouvelles explorations.
Quant aux pièces introduites ou offertes en Eu- J
rope sous le couvert de la contrebande, elles
restent sujettes à caution en ce qu’elles offrent j
bien peu rie garantie; attendu que pour quel-
ques unes d’authentiques, provenant de fouilles
clandestines, combien qui, présentées comme j
telles, ont vu le jour dans ces fabriques de vieux
neuf dont on a la certitude d’existence bien qu’on !
ne sache exactement où elles se trouvent, parce
qu’elles s’attachent à rester ignorées si ce n’est
des intéressés.
Aussi les heureux qui détiennent de ces figu-
rines authentiques, et ils se comptent, sont-ils
deux fois favorisés. D’abord parce que, outre que
c’est là un capital bien placé qui ne pourra que
largement fructifier, on ne saurait être du nom-
bre qu’à la condition d’être fortuné, ce qui à |
notre époque n’est pas à dédaigner ; mais en-
suite, et surtout, parce que, à ceux-là seuls est
réservée la faculté de pouvoir à loisir se griser (
du charme qu’elles inspirent sans être exposés \
comme dans nos collections publiques, encore
qu’on puisse s’y rendre, à être arraché à leur
contemplation parle classique «On ferme» pro-
noncé au moment précis où, tout à la rêverie,
on se complaît à l’évocation d’un passé plus
que deux fois millénaire, désireux qu’on est d’en
dissiper les ténèbres épaisses qui l’enveloppent,
et pénétrer le secret que le mutisme de tout ce
petit monde semble vouloir jalousement garder,
et que seule l’analyse de la mimique est’ peut-
être susceptible de nous révéler.
Mais puisque la philosophie nous enseigne
que le sage sait se contenter de peu, soyons
donc des sages, attendu que ce peu, à
Paris tout au moins, est déjà beaucoup puis-
qu’il nous est donné d’y pouvoiradmirer une col-
lection à nulle autre pareille.
N’empêche cependant qu’on puisse aspirer à
mieux. Mais que peut être ce mieux? Voilà la
question. Question facile à résoudre puisqu’elle
n’implique rien qui ne se fasse déjà tous les
jours pour d’autres genres et dont toute la solu-
tion se résume en ceci : remplacer les originaux,
auxquels à n’importe quel prix on ne saurait
prétendre, par des copies ; mais des copies fidè-
les, consciencieuses et en tous points conformes
aux terres-cuites authentiques. Et c’est là il est
vrai que parait commencer la difficulté ; mais
difficulté plus apparente que réelle ainsi qu’on
le verra plus loin.
Peut-être ici viendra-t-il à la pensée du lec-
teur que, depuis longtemps déjà, des reproduc-
tions de ces figurines se font en moulages de plâ-
tre. De celles-ci, nous eussions préféré n’avoir
pas à en parler n’ayant aucun bien à en dire ;
mais de ce que nous devons prévoir l’objection
il nous faut bien exposer notre opinion.
Or ce que nous dirons, c’est que ces repro-
ductions, dans leur généralité sinon dans leur
totalité, constituent un véritable crime de lèse-
art; qu’on nous passe l’expression car il n’entre
pas dans notre pensée de faire des mots à dou-
ble sens qui ne pourraient qu’être d’un goût
douteux dans un tel cadre. C’est qu’en effet,
outre que les moulages en sont foncièrement
défectueux, usés, ratissés et déformés à la suite
de surmoulages sans nombre quand avec cela
ils n’ont pas eu à subird’outrageantes retouches,
les lignes en sont encore alourdies par de bour-
beuses peintures, véritable barbouillage sans
nom qui n’a pas même pour se faire accepter
l’excuse de ressembler, ne fût-ce que de loin, à
l’un des effets de coloration ou de patine qui
cependant caractérisent si franchement ces
terres-cuites.