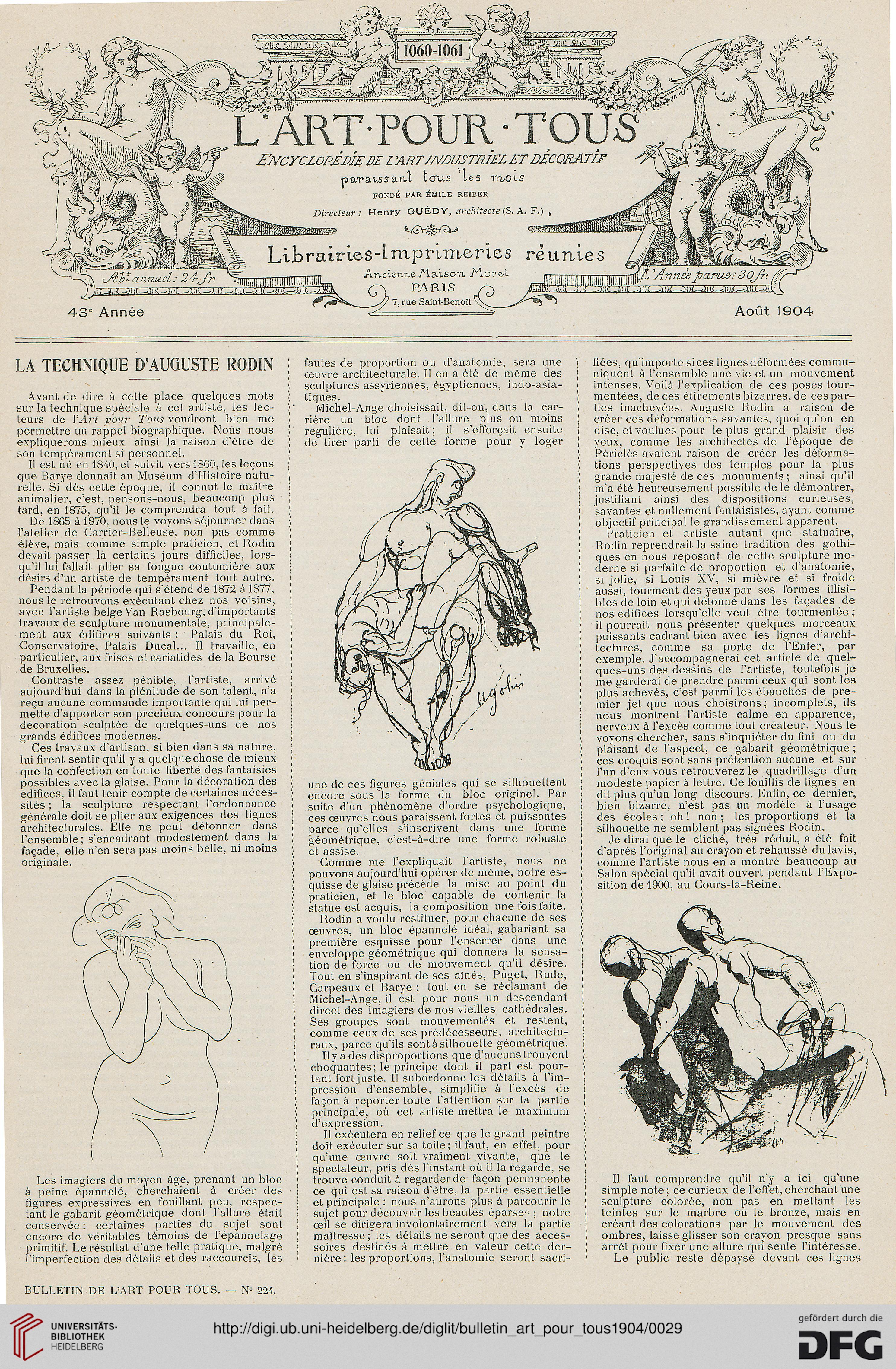A <£%
L'ARTPOUR - TOUS
ENCYCLOPEDIE RE L ARTINDUSTRIEL ET DECORATIF
•p serais s an.1 tous les iri/OtS
FONDÉ PAR ÉMILE REIBER
Directeur: Henry GUÉDY, architecte (S. A. F.)
’MWMiiiVSS
Librairies-Imprimeries rèunies
^'annue{:._ V^iïïïïIIi!Tïï7ÏÏ!r
43e Année
Ancienne .Maison -Mor&l
PARIS jyy ym
7, rue Saint-Benoît
Août 1904
LA TECHNIQUE D’AUGUSTE RODIN
Avant de dire à cette place quelques mots
sur la technique spéciale à cet artiste, les lec-
teurs de l’Art pour Tous voudront bien me
permettre un rappel biographique. Nous nous
expliquerons mieux ainsi la raison d’être de
son tempérament si personnel.
Il esL né en 1840, et suivit vers 1860, les leçons
que Barye donnait au Muséum d’Hisloire natu-
relle. Si dès cette époque, il connut le maître
animalier, c’est, pensons-nous, beaucoup plus
tard, en 1875, qu’il le comprendra tout à fait.
De 1865 à 1870, nous le voyons séjourner dans j
l’atelier de Garrier-Belleuse, non pas comme
élève, mais comme simple praticien, et Rodin
devait passer là certains jours difficiles, lors-
qu’il lui fallait plier sa fougue coutumière aux
désirs d’un artiste de tempérament tout autre.
Pendant la période qui s'étend de 1872 à 1877,
nous le retrouvons exécutant chez nos voisins,
avec l’artiste belge Van Rasbourg, d’importants
travaux de sculpture monumentale, principale-
ment aux édifices suivants : Palais du Roi,
Conservatoire, Palais Ducal... Il travaille, en
particulier, aux frises et cariatides de la Bourse
de Bruxelles.
Contraste assez pénible, l’artiste, arrivé j
aujourd’hui dans la plénitude de son talent, n’a j
reçu aucune commande importante qui lui per- j
mette d’apporter son précieux concours pour la
décoration sculptée de quelques-uns de nos
grands édifices modernes.
Ces travaux d’artisan, si bien dans sa nature,
lui firent sentir qu’il y a quelque chose de mieux j
que la confection en toute liberté des fantaisies j
possibles avec la glaise. Pour la décoration des i
édifices, il faut tenir compte de certaines néces-
sités ; la sculpture respectant l’ordonnance
générale doit se plier aux exigences des lignes
architecturales. Elle ne peut détonner dans
l’ensemble; s’encadrant modestement dans la
façade, elle n’en sera pas moins belle, ni moins
originale.
Les imagiers du moyen âge, prenant un bloc
à peine épannelé, cherchaient à créer des
figures expressives en fouillant peu, respec-
tant le gabarit géométrique dont l’allure était
conservée : certaines parties du sujet sont
encore de véritables témoins de l’épannelage
primitif. Le résultat d’une telle pratique, malgré
l’imperfection des détails et des raccourcis, les
fautes de proportion ou d’anatomie, sera une
œuvre architecturale. Il en a été de même des
sculptures assyriennes, égyptiennes, indo-asia-
tiques.
Michel-Ange choisissait, dit-on, dans la car-
rière un bloc dont l’allure plus ou moins
régulière, lui plaisait ; il s’efforçait ensuite
de tirer parti de cette forme pour y loger
suite d’un phénomène d’ordre psychologique,
ces œuvres nous paraissent fortes et puissantes
parce qu’elles s’inscrivent dans une forme
géométrique, c’est-à-dire une forme robuste
et assise.
Comme me l’expliquait l’artiste, nous ne
pouvons aujourd’hui opérer de même, notre es-
quisse de glaise précède la mise au point du
praticien, et le bloc capable de contenir la
statue est acquis, la composition une fois faite.
Rodin a voulu restituer, pour chacune de ses
œuvres, un bloc épannelé idéal, gabariant sa
première esquisse pour l’enserrer dans une
enveloppe géométrique qui donnera la sensa-
tion de force ou de mouvement qu’il désire.
Tout en s’inspirant de ses aînés, Puget, Rude,
Carpeaux et Barye ; tout en se réclamant de
Michel-Ange, il est pour nous un descendant
direct des imagiers de nos vieilles cathédrales.
Ses groupes sont mouvementés et restent,
comme ceux de ses prédécesseurs, architectu-
raux, parce qu’ils sont à silhouette géométrique.
Il y a des disproportions que d’aucuns trouvent
choquantes; le principe dont il part est pour-
tant fortjuste. Il subordonne les détails à l’im-
pression d’ensemble, simplifie à l'excès de
façon à reporter toute l’attention sur la partie
principale, où cet artiste mettra le maximum
d’expression.
Il exécutera en relief ce que le grand peintre
doit exécuter sur sa toile; il faut, en effet, pour
qu’une œuvre soit vraiment vivante, que le
spectateur, pris dès l’instant où il la regarde, se
trouve conduit à regarder de façon permanente
ce qui esL sa raison d’être, la partie essentielle
et principale : nous n’aurons plus à parcourir le
sujet pour découvrir les beautés éparses ; notre
œil se dirigera involontairement vers la partie •
maîtresse; les détails ne seront que des acces-
soires destinés à mettre en valeur cette der-
nière : les proportions, l’anatomie seront sacri-
fiées, qu’importe si ces lignes déformées commu-
niquent à l’ensemble une vie et un mouvement
intenses. Voilà l’explication de ces poses tour-
mentées, de ces étirements bizarres, de ces par-
ties inachevées. Auguste Rodin a raison de
créer ces déformations savantes, quoi qu’on en
dise, et voulues pour le plus grand plaisir des
yeux, comme les architectes de l’époque de
Pèriclès avaient raison de créer les déforma-
tions perspeclives des temples pour la plus
grande majesté de ces monuments; ainsi qu’il
m’a été heureusement possible de le démontrer,
justifiant ainsi des dispositions curieuses,
savantes et nullement fantaisistes, ayant comme
objectif principal le grandissement apparent.
Praticien et artiste autant que statuaire,
Rodin reprendrait la saine tradition des gothi-
ques en nous reposant de cette sculpture mo-
derne si parfaite de proportion et d’anatomie,
si jolie, si Louis XV, si mièvre et si froide
aussi, tourment des yeux par ses formes illisi-
bles de loin et qui détonne dans les façades de
nos édifices lorsqu’elle veut être tourmentée ;
il pourrait nous présenter quelques morceaux
puissants cadrant bien avec les lignes d’archi-
tectures, comme sa porte de l’Enfer, par
exemple. J’accompagnerai cet article de quel-
ques-uns des dessins de l’artiste, toutefois je
me garderai de prendre parmi ceux qui sont les
plus achevés, c’est parmi les ébauches de pre-
mier jet que nous choisirons ; incomplets, ils
nous montrent l’artiste calme en apparence,
nerveux à l’excès comme tout créateur. Nous le
voyons chercher, sans s’inquiéter du fini ou du
plaisant de l’aspect, ce gabarit géométrique ;
ces croquis sont sans prétention aucune et sur
l’un d’eux vous retrouverez le quadrillage d’un
modeste papier à lettre. Ce fouillis de lignes en
dit plus qu’un long discours. Enfin, ce dernier,
bien bizarre, n’est pas un modèle à l’usage
des écoles ; oh ! non ; les proportions et la
silhouette ne semblent pas signées Rodin.
Je dirai que le cliché, très réduit, a été fait
d’après l’original au crayon et rehaussé du lavis,
comme l’artiste nous en a montré beaucoup au
Salon spècial qu’il avait ouvert pendant l’Expo-
sition de 1900, au Cours-la-Reine.
Il faut comprendre qu’il n’y a ici qu’une
simple note; ce curieux de l’effet,cherchant une
sculpture colorée, non pas en mettant les
teintes sur le marbre ou le bronze, mais en
créant des colorations par le mouvement des
ombres, laisse glisser son crayon presque sans
arrêt pour fixer une allure qui seule l’intéresse.
Le public reste dépaysé devant ces lignes
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS. — N» 224.
L'ARTPOUR - TOUS
ENCYCLOPEDIE RE L ARTINDUSTRIEL ET DECORATIF
•p serais s an.1 tous les iri/OtS
FONDÉ PAR ÉMILE REIBER
Directeur: Henry GUÉDY, architecte (S. A. F.)
’MWMiiiVSS
Librairies-Imprimeries rèunies
^'annue{:._ V^iïïïïIIi!Tïï7ÏÏ!r
43e Année
Ancienne .Maison -Mor&l
PARIS jyy ym
7, rue Saint-Benoît
Août 1904
LA TECHNIQUE D’AUGUSTE RODIN
Avant de dire à cette place quelques mots
sur la technique spéciale à cet artiste, les lec-
teurs de l’Art pour Tous voudront bien me
permettre un rappel biographique. Nous nous
expliquerons mieux ainsi la raison d’être de
son tempérament si personnel.
Il esL né en 1840, et suivit vers 1860, les leçons
que Barye donnait au Muséum d’Hisloire natu-
relle. Si dès cette époque, il connut le maître
animalier, c’est, pensons-nous, beaucoup plus
tard, en 1875, qu’il le comprendra tout à fait.
De 1865 à 1870, nous le voyons séjourner dans j
l’atelier de Garrier-Belleuse, non pas comme
élève, mais comme simple praticien, et Rodin
devait passer là certains jours difficiles, lors-
qu’il lui fallait plier sa fougue coutumière aux
désirs d’un artiste de tempérament tout autre.
Pendant la période qui s'étend de 1872 à 1877,
nous le retrouvons exécutant chez nos voisins,
avec l’artiste belge Van Rasbourg, d’importants
travaux de sculpture monumentale, principale-
ment aux édifices suivants : Palais du Roi,
Conservatoire, Palais Ducal... Il travaille, en
particulier, aux frises et cariatides de la Bourse
de Bruxelles.
Contraste assez pénible, l’artiste, arrivé j
aujourd’hui dans la plénitude de son talent, n’a j
reçu aucune commande importante qui lui per- j
mette d’apporter son précieux concours pour la
décoration sculptée de quelques-uns de nos
grands édifices modernes.
Ces travaux d’artisan, si bien dans sa nature,
lui firent sentir qu’il y a quelque chose de mieux j
que la confection en toute liberté des fantaisies j
possibles avec la glaise. Pour la décoration des i
édifices, il faut tenir compte de certaines néces-
sités ; la sculpture respectant l’ordonnance
générale doit se plier aux exigences des lignes
architecturales. Elle ne peut détonner dans
l’ensemble; s’encadrant modestement dans la
façade, elle n’en sera pas moins belle, ni moins
originale.
Les imagiers du moyen âge, prenant un bloc
à peine épannelé, cherchaient à créer des
figures expressives en fouillant peu, respec-
tant le gabarit géométrique dont l’allure était
conservée : certaines parties du sujet sont
encore de véritables témoins de l’épannelage
primitif. Le résultat d’une telle pratique, malgré
l’imperfection des détails et des raccourcis, les
fautes de proportion ou d’anatomie, sera une
œuvre architecturale. Il en a été de même des
sculptures assyriennes, égyptiennes, indo-asia-
tiques.
Michel-Ange choisissait, dit-on, dans la car-
rière un bloc dont l’allure plus ou moins
régulière, lui plaisait ; il s’efforçait ensuite
de tirer parti de cette forme pour y loger
suite d’un phénomène d’ordre psychologique,
ces œuvres nous paraissent fortes et puissantes
parce qu’elles s’inscrivent dans une forme
géométrique, c’est-à-dire une forme robuste
et assise.
Comme me l’expliquait l’artiste, nous ne
pouvons aujourd’hui opérer de même, notre es-
quisse de glaise précède la mise au point du
praticien, et le bloc capable de contenir la
statue est acquis, la composition une fois faite.
Rodin a voulu restituer, pour chacune de ses
œuvres, un bloc épannelé idéal, gabariant sa
première esquisse pour l’enserrer dans une
enveloppe géométrique qui donnera la sensa-
tion de force ou de mouvement qu’il désire.
Tout en s’inspirant de ses aînés, Puget, Rude,
Carpeaux et Barye ; tout en se réclamant de
Michel-Ange, il est pour nous un descendant
direct des imagiers de nos vieilles cathédrales.
Ses groupes sont mouvementés et restent,
comme ceux de ses prédécesseurs, architectu-
raux, parce qu’ils sont à silhouette géométrique.
Il y a des disproportions que d’aucuns trouvent
choquantes; le principe dont il part est pour-
tant fortjuste. Il subordonne les détails à l’im-
pression d’ensemble, simplifie à l'excès de
façon à reporter toute l’attention sur la partie
principale, où cet artiste mettra le maximum
d’expression.
Il exécutera en relief ce que le grand peintre
doit exécuter sur sa toile; il faut, en effet, pour
qu’une œuvre soit vraiment vivante, que le
spectateur, pris dès l’instant où il la regarde, se
trouve conduit à regarder de façon permanente
ce qui esL sa raison d’être, la partie essentielle
et principale : nous n’aurons plus à parcourir le
sujet pour découvrir les beautés éparses ; notre
œil se dirigera involontairement vers la partie •
maîtresse; les détails ne seront que des acces-
soires destinés à mettre en valeur cette der-
nière : les proportions, l’anatomie seront sacri-
fiées, qu’importe si ces lignes déformées commu-
niquent à l’ensemble une vie et un mouvement
intenses. Voilà l’explication de ces poses tour-
mentées, de ces étirements bizarres, de ces par-
ties inachevées. Auguste Rodin a raison de
créer ces déformations savantes, quoi qu’on en
dise, et voulues pour le plus grand plaisir des
yeux, comme les architectes de l’époque de
Pèriclès avaient raison de créer les déforma-
tions perspeclives des temples pour la plus
grande majesté de ces monuments; ainsi qu’il
m’a été heureusement possible de le démontrer,
justifiant ainsi des dispositions curieuses,
savantes et nullement fantaisistes, ayant comme
objectif principal le grandissement apparent.
Praticien et artiste autant que statuaire,
Rodin reprendrait la saine tradition des gothi-
ques en nous reposant de cette sculpture mo-
derne si parfaite de proportion et d’anatomie,
si jolie, si Louis XV, si mièvre et si froide
aussi, tourment des yeux par ses formes illisi-
bles de loin et qui détonne dans les façades de
nos édifices lorsqu’elle veut être tourmentée ;
il pourrait nous présenter quelques morceaux
puissants cadrant bien avec les lignes d’archi-
tectures, comme sa porte de l’Enfer, par
exemple. J’accompagnerai cet article de quel-
ques-uns des dessins de l’artiste, toutefois je
me garderai de prendre parmi ceux qui sont les
plus achevés, c’est parmi les ébauches de pre-
mier jet que nous choisirons ; incomplets, ils
nous montrent l’artiste calme en apparence,
nerveux à l’excès comme tout créateur. Nous le
voyons chercher, sans s’inquiéter du fini ou du
plaisant de l’aspect, ce gabarit géométrique ;
ces croquis sont sans prétention aucune et sur
l’un d’eux vous retrouverez le quadrillage d’un
modeste papier à lettre. Ce fouillis de lignes en
dit plus qu’un long discours. Enfin, ce dernier,
bien bizarre, n’est pas un modèle à l’usage
des écoles ; oh ! non ; les proportions et la
silhouette ne semblent pas signées Rodin.
Je dirai que le cliché, très réduit, a été fait
d’après l’original au crayon et rehaussé du lavis,
comme l’artiste nous en a montré beaucoup au
Salon spècial qu’il avait ouvert pendant l’Expo-
sition de 1900, au Cours-la-Reine.
Il faut comprendre qu’il n’y a ici qu’une
simple note; ce curieux de l’effet,cherchant une
sculpture colorée, non pas en mettant les
teintes sur le marbre ou le bronze, mais en
créant des colorations par le mouvement des
ombres, laisse glisser son crayon presque sans
arrêt pour fixer une allure qui seule l’intéresse.
Le public reste dépaysé devant ces lignes
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS. — N» 224.