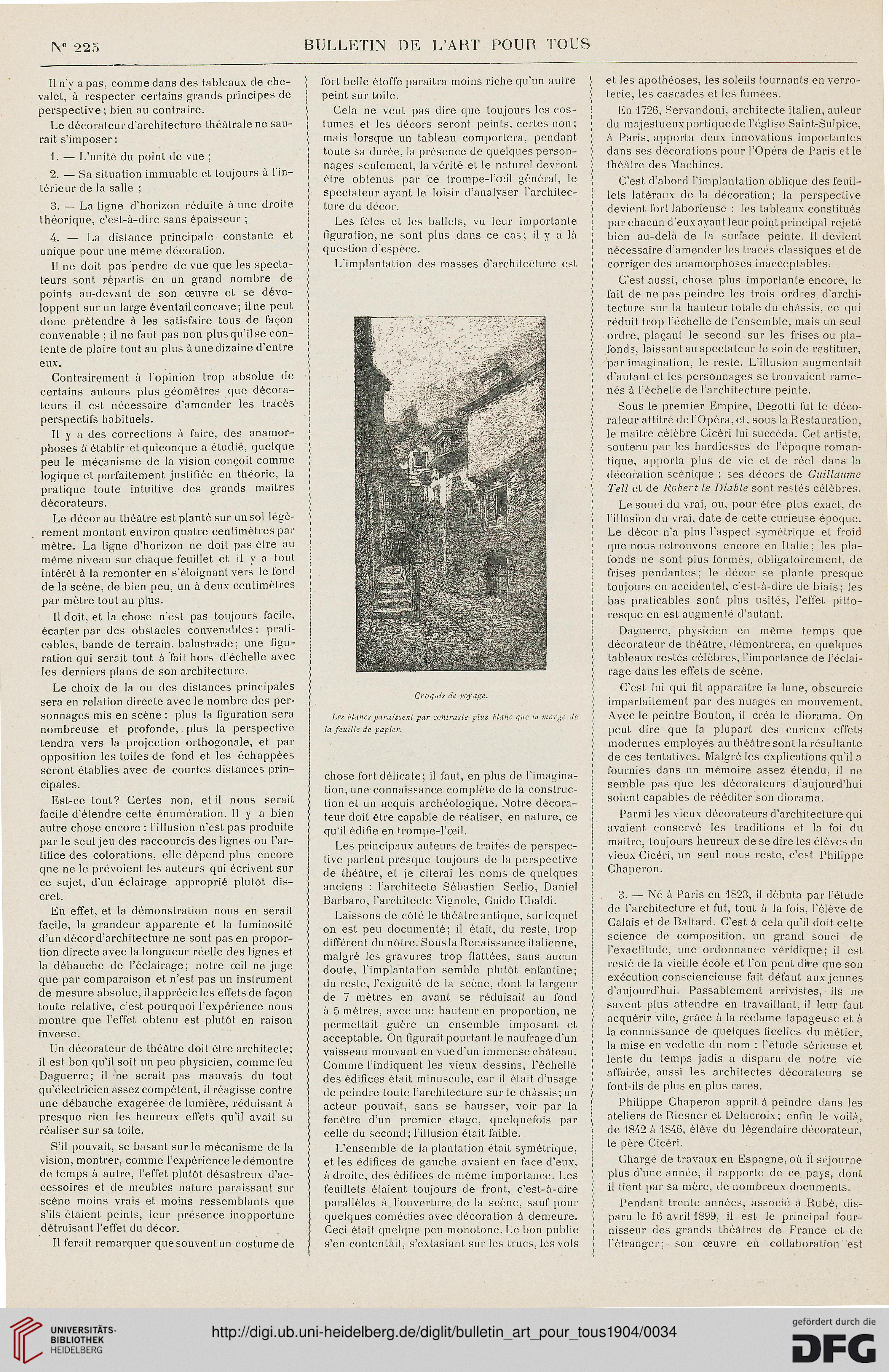N° 225
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
Il n’y a pas, comme dans des tableaux de che-
valet, à respecter certains grands principes de
perspective; bien au contraire.
Le décorateur d’architecture théâtrale ne sau-
rait s’imposer :
1. — L’unité du point de vue ;
2. — Sa situation immuable et toujours à l’in-
térieur de la salle ;
3. — La ligne d’horizon réduite à une droite
théorique, c’est-à-dire sans épaisseur ;
4. — La dislance principale constante et
unique pour une même décoration.
Il ne doit pas 'perdre de vue que les specta-
teurs sont répartis en un grand nombre de
points au-devant de son œuvre et se déve-
loppent sur un large éventail concave; il ne peut
donc prétendre à les satisfaire tous de façon
convenable ; il ne faut pas non plus qu’il se con-
tente de plaire tout au plus à une dizaine d’entre
eux.
Contrairement à l’opinion trop absolue de
certains auteurs plus géomètres que décora-
teurs il est nécessaire d’amender les tracés
perspectifs habituels.
Il y a des corrections à faire, des anamor-
phoses à établir et quiconque a étudié, quelque
peu le mécanisme de la vision conçoit comme
logique et parfaitement justifiée en théorie, la
pratique toute intuitive des grands maîtres
décorateurs.
Le décor au théâtre est planté sur un sol légè-
rement montant environ quatre centimètres par
mètre. La ligne d’horizon ne doit pas être au
même niveau sur chaque feuillet et il y a tout
intérêt à la remonter en s’éloignant vers le fond
de la scène, de bien peu, un à deux centimètres
par mètre tout au plus.
Il doit, et la chose n’est pas toujours facile,
écarter par des obstacles convenables: prati-
cables, bande de terrain, balustrade; une figu-
ration qui serait tout à fait hors d’échelle avec
les derniers plans de son architecture.
Le choix de la ou des disLances principales
sera en relation directe avec le nombre des per-
sonnages mis en scène : plus la figuration sera
nombreuse et profonde, plus la perspective
tendra vers la projection orthogonale, et par
opposition les toiles de fond et les échappées
seront établies avec de courtes disLances prin-
cipales.
Est-ce tout? Certes non, et il nous serait
facile d’étendre cette énumération. 11 y a bien
autre chose encore : l’illusion n’est pas produite
par le seul jeu des raccourcis des lignes ou l’ar-
tifice des colorations, elle dépend plus encore
qne ne le prévoient les auteurs qui écrivent sur
ce sujet, d’un éclairage approprié plutôt dis-
cret.
En effet, et la démonstration nous en serait
facile, la grandeur apparente et la luminosité
d’un décor d’architecture ne sont pas en propor-
tion directe avec la longueur réelle des lignes et
la débauche de l’éclairage; notre œil ne juge
que par comparaison et n’est pas un instrument
de mesure absolue, il apprécie les effets de façon
toute relative, c’est pourquoi l’expérience nous
montre que l’effet obtenu esL plutôt en raison
inverse.
Un décorateur de théâtre doit être architecte;
il est bon qu’il soit un peu physicien, comme feu
Daguerre; il ne serait pas mauvais du tout
qu’électricien assez compétent, il réagisse contre
une débauche exagérée de lumière, réduisant à
presque rien les heureux effets qu’il avait su
réaliser sur sa toile.
S’il pouvait, se basant sur le mécanisme de la
vision, montrer, comme l’expérience le démontre
de temps à autre, l’effet plutôt désastreux d’ac-
cessoires et de meubles nature paraissant sur
scène moins vrais et moins ressemblants que
s’ils étaient peints, leur présence inopportune
détruisant l’effet du décor.
II ferait remarquer que souvent un costume de
fort belle étoffe paraîtra moins riche qu’un autre
peint sur toile.
Cela ne veut pas dire que toujours les cos-
tumes et les décors seront peints, certes non;
mais lorsque un tableau comportera, pendant
toute sa durée, la présence de quelques person-
nages seulement, la vérité eL le naturel devront
être obtenus par ce trompe-l’œil général, le
spectateur ayant le loisir d’analyser l’architec-
ture du décor.
Les fêtes et les ballets, vu leur importante
figuration, ne sont plus dans ce cas; il y a là
question d’espèce.
L’implantation des niasses d’architecture est
Croquis de voyage.
Les blancs paraissent par contraste plus blanc que lu marge de
la feuille de papier.
chose fort délicate; il faut, en plus de l’imagina-
tion, une connaissance complète de la construc-
tion et un acquis archéologique. Notre décora-
teur doit être capable de réaliser, en nature, ce
qu il édifie en trompe-l’œil.
Les principaux auteurs de traités de perspec-
tive parlent presque toujours de la perspective
de théâtre, et je citerai les noms de quelques
anciens : l’architecte Sébastien Serlio, Daniel
Barbaro, l’architecte Vignole, Guido Ubaldi.
Laissons de côté le théâtre antique, sur lequel
on est peu documenté; il était, du reste, trop
différent du nôtre. Sous la Renaissance italienne,
malgré les gravures trop flattées, sans aucun
doute, l’implantation semble plutôt enfantine;
du reste, l’exiguité de la scène, dont la largeur
de 7 mètres en avant se réduisait au fond
à 5 mètres, avec une hauteur en proportion, ne
permettait guère un ensemble imposant et
acceptable. On figurait pourtant le naufrage d’un
vaisseau mouvant en vue d’un immense château.
Comme l’indiquent les vieux dessins, l’échelle
des édifices était minuscule, car il était d’usage
de peindre toute l’architecture sur le châssis; un
acteur pouvait, sans se hausser, voir par la
fenêtre d’un premier étage, quelquefois par
celle du second; l’illusion était faible.
L’ensemble de la plantation était symétrique,
et les édifices de gauche avaient en face d’eux,
à droite, des édifices de même importance. Les
feuillets étaient toujours de front, c’est-à-dire
parallèles à l’ouverture de la scène, sauf pour
quelques comédies avec décoration à demeure.
Ceci était quelque peu monotone. Le bon public
s’en contentait, s’extasiant sur les trucs, les vols
et les apothéoses, les soleils tournants en verro-
terie, les cascades et les fumées.
En 1726, Servandoni, architecte italien, auteur
du majestueux portique de l’église Saint-Sulpice,
à Paris, apporta deux innovations importantes
dans ses décorations pour l’Opéra de Paris et le
théâtre des Machines.
C’est d’abord l’implantation oblique des feuil-
lets latéraux de la décoration; la perspective
devient fort laborieuse : les tableaux constitués
par chacun d’eux ayant leur point principal rejeté
bien au-delà de la surface peinte. 11 devient
nécessaire d’amender les tracés classiques et de
corriger des anamorphoses inacceptables.
C’est aussi, chose plus importante encore, le
fait de ne pas peindre les trois ordres d’archi-
tecture sur la hauteur totale du châssis, ce qui
réduit trop l’échelle de l’ensemble, mais un seul
ordre, plaçant le second sur les frises ou pla-
fonds, laissant au specta teur le soin de restituer,
par imagination, le reste. L’illusion augmentait
d’autant et les personnages se trouvaient rame-
nés à l’échelle de l’architecture peinte.
Sous le premier Empire, Degotti fut le déco-
rateur attitré de l’Opéra, et, sous la Restauration,
le maître célèbre Cicéri lui succéda. Cet artiste,
soutenu par les hardiesses de l’époque roman-
tique, apporta plus de vie et de réel dans la
décoration scénique : ses décors de Guillaume
Tell et de Robert le Diable sont restés célèbres.
Le souci du vrai, ou, pour être plus exact, de
l’illusion du vrai, date de cette curieuse époque.
Le décor n’a plus l’aspect symétrique et froid
que nous retrouvons encore en Italie; les pla-
fonds ne sont plus formés, obligatoirement, de
frises pendantes; le décor se plante presque
toujours en accidentel, c’est-à-dire de biais; les
bas praticables sont plus usités, l’effet pitto-
resque en est augmenté d’autant.
Daguerre, physicien en même temps que
décorateur de théâtre, démontrera, en quelques
tableaux restés célèbres, l’importance de l’éclai-
rage dans les effets de scène.
C’est lui qui fit apparaître la lune, obscurcie
imparfaitement par des nuages en mouvement.
Avec le peintre Bouton, il créa le diorama. On
peut dire que la plupart des curieux effets
modernes employés au théâtre sont la résultante
de ces tentatives. Malgré les explications qu’il a
fournies dans un mémoire assez étendu, il ne
semble pas que les décorateurs d’aujourd’hui
soient capables de rééditer son diorama.
Parmi les vieux décorateurs d’architecture qui
avaient conservé les traditions et la foi du
maître, toujours heureux de se dire les élèves du
vieux Cicéri, un seul nous reste, c’est Philippe
Chaperon.
3. — Né à Paris en 1823, il débuta par l’étude
de l’architecture et fut, tout à la fois, l’élève de
Calais et de Baltard. C’est à cela qu’il doit cette
science de composition, un grand souci de
l’exacliLude, une ordonnance véridique; il est
resté de la vieille école et l’on peut dire que son
exécution consciencieuse fait défaut aux jeunes
d’aujourd’hui. Passablement arrivistes, ils ne
savent plus attendre en travaillant, il leur faut
acquérir vite, grâce à la réclame tapageuse et à
la connaissance de quelques ficelles du métier,
la mise en vedette du nom : l’étude sérieuse et
lente du temps jadis a disparu de notre vie
affairée, aussi les architectes décorateurs se
font-ils de plus en plus rares.
Philippe Chaperon apprit à peindre dans les
ateliers de Riesner et Delacroix; enfin le voilà,
de 1842 à 1846, élève du légendaire décorateur,
le père Cicéri.
Chargé de travaux en Espagne, où il séjourne
plus d’une année, il rapporle de ce pays, dont
il tient par sa mère, de. nombreux documents.
Pendant trente années, associé à Rubé, dis-
paru le 16 avril 1899, il est- le principal four-
nisseur des grands théâtres de France et de
l’étranger; son œuvre en collaboration est
BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
Il n’y a pas, comme dans des tableaux de che-
valet, à respecter certains grands principes de
perspective; bien au contraire.
Le décorateur d’architecture théâtrale ne sau-
rait s’imposer :
1. — L’unité du point de vue ;
2. — Sa situation immuable et toujours à l’in-
térieur de la salle ;
3. — La ligne d’horizon réduite à une droite
théorique, c’est-à-dire sans épaisseur ;
4. — La dislance principale constante et
unique pour une même décoration.
Il ne doit pas 'perdre de vue que les specta-
teurs sont répartis en un grand nombre de
points au-devant de son œuvre et se déve-
loppent sur un large éventail concave; il ne peut
donc prétendre à les satisfaire tous de façon
convenable ; il ne faut pas non plus qu’il se con-
tente de plaire tout au plus à une dizaine d’entre
eux.
Contrairement à l’opinion trop absolue de
certains auteurs plus géomètres que décora-
teurs il est nécessaire d’amender les tracés
perspectifs habituels.
Il y a des corrections à faire, des anamor-
phoses à établir et quiconque a étudié, quelque
peu le mécanisme de la vision conçoit comme
logique et parfaitement justifiée en théorie, la
pratique toute intuitive des grands maîtres
décorateurs.
Le décor au théâtre est planté sur un sol légè-
rement montant environ quatre centimètres par
mètre. La ligne d’horizon ne doit pas être au
même niveau sur chaque feuillet et il y a tout
intérêt à la remonter en s’éloignant vers le fond
de la scène, de bien peu, un à deux centimètres
par mètre tout au plus.
Il doit, et la chose n’est pas toujours facile,
écarter par des obstacles convenables: prati-
cables, bande de terrain, balustrade; une figu-
ration qui serait tout à fait hors d’échelle avec
les derniers plans de son architecture.
Le choix de la ou des disLances principales
sera en relation directe avec le nombre des per-
sonnages mis en scène : plus la figuration sera
nombreuse et profonde, plus la perspective
tendra vers la projection orthogonale, et par
opposition les toiles de fond et les échappées
seront établies avec de courtes disLances prin-
cipales.
Est-ce tout? Certes non, et il nous serait
facile d’étendre cette énumération. 11 y a bien
autre chose encore : l’illusion n’est pas produite
par le seul jeu des raccourcis des lignes ou l’ar-
tifice des colorations, elle dépend plus encore
qne ne le prévoient les auteurs qui écrivent sur
ce sujet, d’un éclairage approprié plutôt dis-
cret.
En effet, et la démonstration nous en serait
facile, la grandeur apparente et la luminosité
d’un décor d’architecture ne sont pas en propor-
tion directe avec la longueur réelle des lignes et
la débauche de l’éclairage; notre œil ne juge
que par comparaison et n’est pas un instrument
de mesure absolue, il apprécie les effets de façon
toute relative, c’est pourquoi l’expérience nous
montre que l’effet obtenu esL plutôt en raison
inverse.
Un décorateur de théâtre doit être architecte;
il est bon qu’il soit un peu physicien, comme feu
Daguerre; il ne serait pas mauvais du tout
qu’électricien assez compétent, il réagisse contre
une débauche exagérée de lumière, réduisant à
presque rien les heureux effets qu’il avait su
réaliser sur sa toile.
S’il pouvait, se basant sur le mécanisme de la
vision, montrer, comme l’expérience le démontre
de temps à autre, l’effet plutôt désastreux d’ac-
cessoires et de meubles nature paraissant sur
scène moins vrais et moins ressemblants que
s’ils étaient peints, leur présence inopportune
détruisant l’effet du décor.
II ferait remarquer que souvent un costume de
fort belle étoffe paraîtra moins riche qu’un autre
peint sur toile.
Cela ne veut pas dire que toujours les cos-
tumes et les décors seront peints, certes non;
mais lorsque un tableau comportera, pendant
toute sa durée, la présence de quelques person-
nages seulement, la vérité eL le naturel devront
être obtenus par ce trompe-l’œil général, le
spectateur ayant le loisir d’analyser l’architec-
ture du décor.
Les fêtes et les ballets, vu leur importante
figuration, ne sont plus dans ce cas; il y a là
question d’espèce.
L’implantation des niasses d’architecture est
Croquis de voyage.
Les blancs paraissent par contraste plus blanc que lu marge de
la feuille de papier.
chose fort délicate; il faut, en plus de l’imagina-
tion, une connaissance complète de la construc-
tion et un acquis archéologique. Notre décora-
teur doit être capable de réaliser, en nature, ce
qu il édifie en trompe-l’œil.
Les principaux auteurs de traités de perspec-
tive parlent presque toujours de la perspective
de théâtre, et je citerai les noms de quelques
anciens : l’architecte Sébastien Serlio, Daniel
Barbaro, l’architecte Vignole, Guido Ubaldi.
Laissons de côté le théâtre antique, sur lequel
on est peu documenté; il était, du reste, trop
différent du nôtre. Sous la Renaissance italienne,
malgré les gravures trop flattées, sans aucun
doute, l’implantation semble plutôt enfantine;
du reste, l’exiguité de la scène, dont la largeur
de 7 mètres en avant se réduisait au fond
à 5 mètres, avec une hauteur en proportion, ne
permettait guère un ensemble imposant et
acceptable. On figurait pourtant le naufrage d’un
vaisseau mouvant en vue d’un immense château.
Comme l’indiquent les vieux dessins, l’échelle
des édifices était minuscule, car il était d’usage
de peindre toute l’architecture sur le châssis; un
acteur pouvait, sans se hausser, voir par la
fenêtre d’un premier étage, quelquefois par
celle du second; l’illusion était faible.
L’ensemble de la plantation était symétrique,
et les édifices de gauche avaient en face d’eux,
à droite, des édifices de même importance. Les
feuillets étaient toujours de front, c’est-à-dire
parallèles à l’ouverture de la scène, sauf pour
quelques comédies avec décoration à demeure.
Ceci était quelque peu monotone. Le bon public
s’en contentait, s’extasiant sur les trucs, les vols
et les apothéoses, les soleils tournants en verro-
terie, les cascades et les fumées.
En 1726, Servandoni, architecte italien, auteur
du majestueux portique de l’église Saint-Sulpice,
à Paris, apporta deux innovations importantes
dans ses décorations pour l’Opéra de Paris et le
théâtre des Machines.
C’est d’abord l’implantation oblique des feuil-
lets latéraux de la décoration; la perspective
devient fort laborieuse : les tableaux constitués
par chacun d’eux ayant leur point principal rejeté
bien au-delà de la surface peinte. 11 devient
nécessaire d’amender les tracés classiques et de
corriger des anamorphoses inacceptables.
C’est aussi, chose plus importante encore, le
fait de ne pas peindre les trois ordres d’archi-
tecture sur la hauteur totale du châssis, ce qui
réduit trop l’échelle de l’ensemble, mais un seul
ordre, plaçant le second sur les frises ou pla-
fonds, laissant au specta teur le soin de restituer,
par imagination, le reste. L’illusion augmentait
d’autant et les personnages se trouvaient rame-
nés à l’échelle de l’architecture peinte.
Sous le premier Empire, Degotti fut le déco-
rateur attitré de l’Opéra, et, sous la Restauration,
le maître célèbre Cicéri lui succéda. Cet artiste,
soutenu par les hardiesses de l’époque roman-
tique, apporta plus de vie et de réel dans la
décoration scénique : ses décors de Guillaume
Tell et de Robert le Diable sont restés célèbres.
Le souci du vrai, ou, pour être plus exact, de
l’illusion du vrai, date de cette curieuse époque.
Le décor n’a plus l’aspect symétrique et froid
que nous retrouvons encore en Italie; les pla-
fonds ne sont plus formés, obligatoirement, de
frises pendantes; le décor se plante presque
toujours en accidentel, c’est-à-dire de biais; les
bas praticables sont plus usités, l’effet pitto-
resque en est augmenté d’autant.
Daguerre, physicien en même temps que
décorateur de théâtre, démontrera, en quelques
tableaux restés célèbres, l’importance de l’éclai-
rage dans les effets de scène.
C’est lui qui fit apparaître la lune, obscurcie
imparfaitement par des nuages en mouvement.
Avec le peintre Bouton, il créa le diorama. On
peut dire que la plupart des curieux effets
modernes employés au théâtre sont la résultante
de ces tentatives. Malgré les explications qu’il a
fournies dans un mémoire assez étendu, il ne
semble pas que les décorateurs d’aujourd’hui
soient capables de rééditer son diorama.
Parmi les vieux décorateurs d’architecture qui
avaient conservé les traditions et la foi du
maître, toujours heureux de se dire les élèves du
vieux Cicéri, un seul nous reste, c’est Philippe
Chaperon.
3. — Né à Paris en 1823, il débuta par l’étude
de l’architecture et fut, tout à la fois, l’élève de
Calais et de Baltard. C’est à cela qu’il doit cette
science de composition, un grand souci de
l’exacliLude, une ordonnance véridique; il est
resté de la vieille école et l’on peut dire que son
exécution consciencieuse fait défaut aux jeunes
d’aujourd’hui. Passablement arrivistes, ils ne
savent plus attendre en travaillant, il leur faut
acquérir vite, grâce à la réclame tapageuse et à
la connaissance de quelques ficelles du métier,
la mise en vedette du nom : l’étude sérieuse et
lente du temps jadis a disparu de notre vie
affairée, aussi les architectes décorateurs se
font-ils de plus en plus rares.
Philippe Chaperon apprit à peindre dans les
ateliers de Riesner et Delacroix; enfin le voilà,
de 1842 à 1846, élève du légendaire décorateur,
le père Cicéri.
Chargé de travaux en Espagne, où il séjourne
plus d’une année, il rapporle de ce pays, dont
il tient par sa mère, de. nombreux documents.
Pendant trente années, associé à Rubé, dis-
paru le 16 avril 1899, il est- le principal four-
nisseur des grands théâtres de France et de
l’étranger; son œuvre en collaboration est