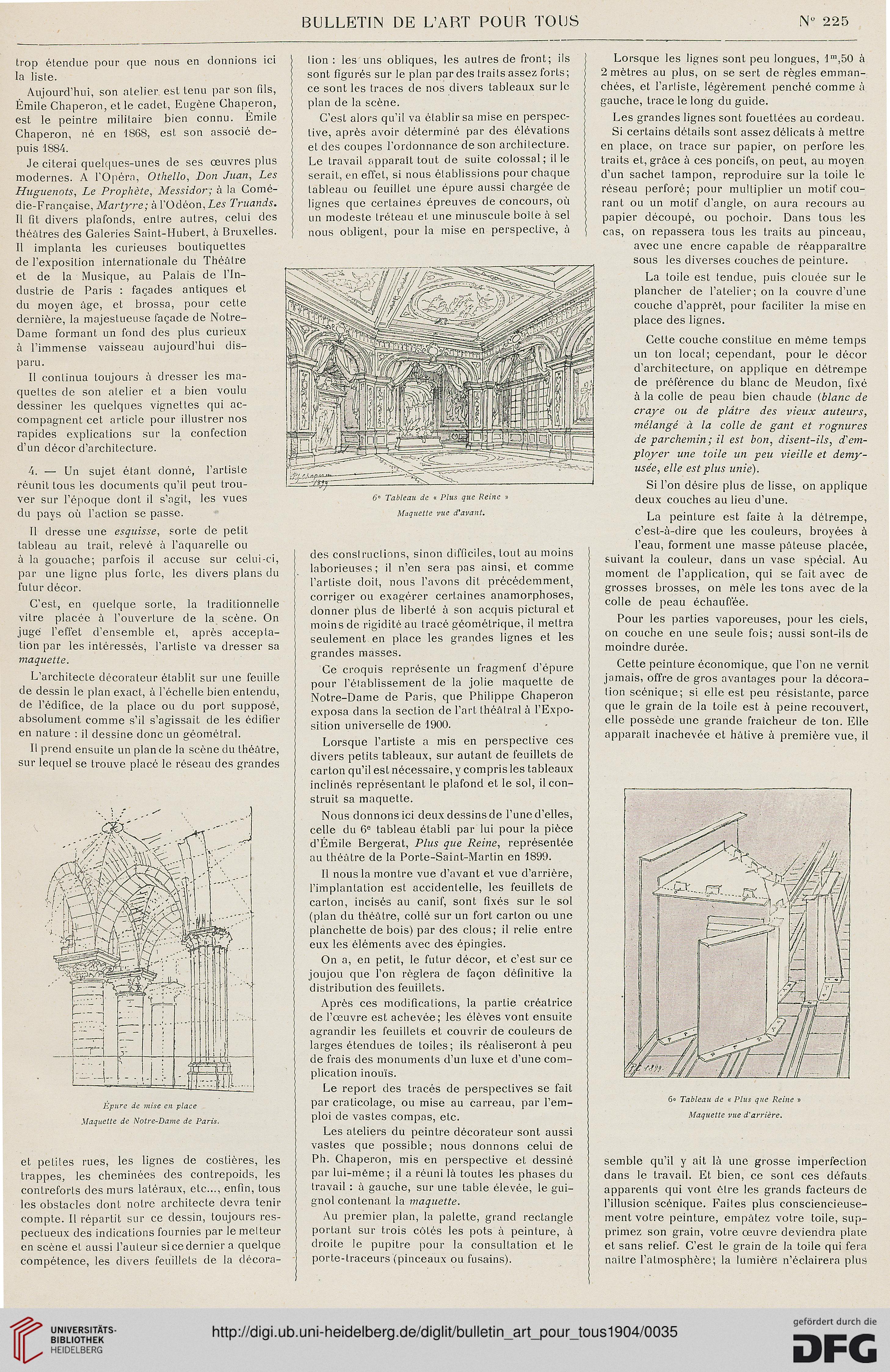BULLETIN DE L’ART POUR TOUS
N° 225
trop étendue pour que nous en donnions ici
la liste.
Aujourd’hui, son atelier, est tenu par son fils,
Émile Chaperon, et le cadet, Eugène Chaperon,
est le peintre militaire bien connu. Émile
Chaperon, né en 1868, est son associé de-
puis 1884.
Je citerai quelques-unes de ses œuvres plus
modernes. A l’Opéra, Othello, Don Juan, Les
Huguenots, Le Prophète, Messidor; à la Comé-
die-Française, Martyre; à l'Odéon, Les 1 ruands.
Il fit divers plafonds, entre autres, celui des
théâtres des Galeries Saint-Hubert, à Bruxelles.
Il implanta les curieuses bouliquettes
de l’exposition internationale du Théâtre
et de la Musique, au Palais de l’In-
dustrie de Paris : façades antiques et
du moyen âge, et brossa, pour cette
dernière, la majestueuse façade de Notre-
Dame formant un fond des plus curieux
à l’immense vaisseau aujourd’hui dis-
paru.
II continua toujours à dresser les ma-
quettes de son atelier et a bien voulu
dessiner les quelques vignettes qui ac-
compagnent cet article pour illustrer nos
rapides explications sur la confection
d’un décor d’architecture.
4. — Un sujet élanl donné, l’artiste
réunit tous les documents qu’il peut trou-
ver sur l’époque dont il s’agit, les vues
du pays où l’action se passe.
Il dresse une esquisse, sorte de petit
tableau au trait, relevé à l’aquarelle ou
à la gouache; parfois il accuse sur celui-ci,
par une ligne plus forte, les divers plans du
futur décor.
C’est, en quelque sorte, la traditionnelle
vitre placée à l’ouverture de la scène. On
jugé l’effet d’ensemble et, après accepta-
tion par les intéressés, l’artiste va dresser sa
maquette.
É’architecle décorateur établit sur une feuille
de dessin le plan exact, à l'échelle bien entendu,
de l’édifice, de la place ou du port supposé,
absolument comme s’il s’agissait de les édifier
en nature : il dessine donc un géométral.
Il prend ensuite un plan de la scène du théâtre,
sur lequel se trouve placé le réseau des grandes
Épure de mise en place
Maquette de Notre-Dame de Paris.
et petites rues, les lignes de costières, les
trappes, les cheminées des contrepoids, les
contreforts des murs latéraux, etc..., enfin, tous
les obstacles dont notre architecte devra tenir
compte. Il répartit sur ce dessin, toujours res-
pectueux des indications fournies par le metteur
en scène eL aussi l’auteur si ce dernier a quelque
compétence, les divers feuillets de la décora-
tion : les uns obliques, les autres de front; ils
sont figurés sur le plan par des traits assez forts;
ce sont les traces de nos divers tableaux sur le
plan de la scène.
C’est alors qu’il va établir sa mise en perspec-
tive, après avoir déterminé par des élévations
et des coupes l’ordonnance de son architecture.
Le travail apparaît tout de suite colossal; il le
serait, en effet, si nous établissions pour chaque
tableau ou feuillet une épure aussi chargée de
lignes que certaines épreuves de concours, où
un modeste tréteau et une minuscule boite à sel
nous obligent, pour la mise en perspective, à
Maquette vue d'avant.
j des constructions, sinon difficiles, tout au moins
J laborieuses; il n’en sera pas ainsi, et comme
l’artiste doit, nous l’avons dit précédemment,
j corriger ou exagérer certaines anamorphoses,
donner plus de liberté à son acquis pictural et
moins de rigidité au tracé géométrique, il mettra
seulement en place les grandes lignes et les
grandes masses.
Ce croquis représente un fragment d’épure
pour l’établissement de la jolie maquette de
Notre-Dame de Paris, que Philippe Chaperon
exposa dans la section de l’art théâtral à l’Expo-
sition universelle de 1900.
Lorsque l’artiste a mis en perspective ces
divers petits tableaux, sur autant de feuillets de
carton qu’il est nécessaire, y compris les tableaux
inclinés représentant le plafond et le sol, il con-
struit sa maquette.
Nous donnons ici deux dessins de l’une d’elles,
celle du 6e tableau établi par lui pour la pièce
d’Emile Bergerat, Plus que Reine, représentée
au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1899.
Il nous la montre vue d’avant et vue d’arrière,
l’implantation est accidentelle, les feuillets de
carton, incisés au canif, sont fixés sur le sol
(plan du théâtre, collé sur un fort carton ou une
planchette de bois) par des clous; il relie entre
eux les éléments avec des épingles.
On a, en petit, le futur décor, et c’est sur ce
joujou que l’on réglera de façon définitive la
distribution des feuillets.
Après ces modifications, la partie créatrice
de l’œuvre est achevée; les élèves vont ensuite
agrandir les feuillets et couvrir de couleurs de
larges étendues de toiles ; ils réaliseront à peu
de frais des monuments d’un luxe et d’une com-
plication inouïs.
Le report des tracés de perspectives se fait
par craticolage, ou mise au carreau, par l’em-
ploi de vastes compas, etc.
Les ateliers du peintre décorateur sont aussi
vastes que possible; nous donnons celui de
Pli. Chaperon, mis en perspective et dessiné
par lui-même; il a réuni là toutes les phases du
travail : à gauche, sur une table élevée, le gui-
gnol contenant la maquette.
Au premier plan, la palette, grand rectangle
portant sur trois côtés les pots à peinture, à
droite le pupitre pour la consultation et le
porte-traceurs (pinceaux ou fusains).
Lorsque les lignes sont peu longues, lm,50 à
2 mètres au plus, on se sert de règles emman-
chées, et l’artiste, légèrement penché comme à
gauche, trace le long du guide.
Les grandes lignes sont fouettées au cordeau.
Si certains détails sont assez délicats à mettre
en place, on trace sur papier, on perfore les
traits et, grâce à ces poncifs, on peut, au moyen
d’un sachet tampon, reproduire sur la toile le
réseau perforé; pour multiplier un motif cou-
rant ou un motif d’angle, on aura recours au
papier découpé, ou pochoir. Dans tous les
cas, on repassera tous les traits au pinceau,
avec une encre capable de réapparaître
sous les diverses couches de peinture.
La toile est tendue, puis clouée sur le
plancher de l’atelier; on la couvre d’une
couche d’apprêt, pour faciliter la mise en
place des lignes.
Cette couche constitue en même temps
un ton local; cependant, pour le décor
d’architecture, on applique en détrempe
de préférence du blanc de Meudon, fixé
à la colle de peau bien chaude (blanc de
craye ou de plâtre des vieux auteurs,
mélangé à la colle de gant et rognures
de parchemin ; il est bon, disent-ils, d'em-
ployer une toile un peu vieille et demy-
usée, elle est plus unie).
Si l’on désire plus de lisse, on applique
deux couches au lieu d’une.
La peinture est faite à la détrempe,
c’est-à-dire que les couleurs, broyées à
l’eau, forment une masse pâteuse placée,
suivant la couleur, dans un vase spécial. Au
moment de l’application, qui se fait avec de
grosses brosses, on mêle les tons avec de la
colle de peau échauffée.
Pour les parties vaporeuses, pour les ciels,
on couche en une seule fois; aussi sont-ils de
moindre durée.
Cette peinture économique, que l’on ne vernit
jamais, offre de gros avantages pour la décora-
tion scénique; si elle est peu résistante, parce
que le grain de la toile est à peine recouvert,
elle possède une grande fraîcheur de ton. Elle
apparaît inachevée et hâtive à première vue, il
6° Tableau de « Plus que Reine »
Maquette vue d'arrière.
semble qu’il y ait là une grosse imperfection
dans le travail. Et bien, ce sont ces défauts
apparents qui vont être les grands facteurs de
l’illusion scénique. Faites plus consciencieuse-
ment votre peinture, empâtez votre toile, sup-
primez son grain, votre œuvre deviendra plate
et sans relief. C’est le grain de la toile qui fera
naître l’atmosphère; la lumière n’éclairera plus
N° 225
trop étendue pour que nous en donnions ici
la liste.
Aujourd’hui, son atelier, est tenu par son fils,
Émile Chaperon, et le cadet, Eugène Chaperon,
est le peintre militaire bien connu. Émile
Chaperon, né en 1868, est son associé de-
puis 1884.
Je citerai quelques-unes de ses œuvres plus
modernes. A l’Opéra, Othello, Don Juan, Les
Huguenots, Le Prophète, Messidor; à la Comé-
die-Française, Martyre; à l'Odéon, Les 1 ruands.
Il fit divers plafonds, entre autres, celui des
théâtres des Galeries Saint-Hubert, à Bruxelles.
Il implanta les curieuses bouliquettes
de l’exposition internationale du Théâtre
et de la Musique, au Palais de l’In-
dustrie de Paris : façades antiques et
du moyen âge, et brossa, pour cette
dernière, la majestueuse façade de Notre-
Dame formant un fond des plus curieux
à l’immense vaisseau aujourd’hui dis-
paru.
II continua toujours à dresser les ma-
quettes de son atelier et a bien voulu
dessiner les quelques vignettes qui ac-
compagnent cet article pour illustrer nos
rapides explications sur la confection
d’un décor d’architecture.
4. — Un sujet élanl donné, l’artiste
réunit tous les documents qu’il peut trou-
ver sur l’époque dont il s’agit, les vues
du pays où l’action se passe.
Il dresse une esquisse, sorte de petit
tableau au trait, relevé à l’aquarelle ou
à la gouache; parfois il accuse sur celui-ci,
par une ligne plus forte, les divers plans du
futur décor.
C’est, en quelque sorte, la traditionnelle
vitre placée à l’ouverture de la scène. On
jugé l’effet d’ensemble et, après accepta-
tion par les intéressés, l’artiste va dresser sa
maquette.
É’architecle décorateur établit sur une feuille
de dessin le plan exact, à l'échelle bien entendu,
de l’édifice, de la place ou du port supposé,
absolument comme s’il s’agissait de les édifier
en nature : il dessine donc un géométral.
Il prend ensuite un plan de la scène du théâtre,
sur lequel se trouve placé le réseau des grandes
Épure de mise en place
Maquette de Notre-Dame de Paris.
et petites rues, les lignes de costières, les
trappes, les cheminées des contrepoids, les
contreforts des murs latéraux, etc..., enfin, tous
les obstacles dont notre architecte devra tenir
compte. Il répartit sur ce dessin, toujours res-
pectueux des indications fournies par le metteur
en scène eL aussi l’auteur si ce dernier a quelque
compétence, les divers feuillets de la décora-
tion : les uns obliques, les autres de front; ils
sont figurés sur le plan par des traits assez forts;
ce sont les traces de nos divers tableaux sur le
plan de la scène.
C’est alors qu’il va établir sa mise en perspec-
tive, après avoir déterminé par des élévations
et des coupes l’ordonnance de son architecture.
Le travail apparaît tout de suite colossal; il le
serait, en effet, si nous établissions pour chaque
tableau ou feuillet une épure aussi chargée de
lignes que certaines épreuves de concours, où
un modeste tréteau et une minuscule boite à sel
nous obligent, pour la mise en perspective, à
Maquette vue d'avant.
j des constructions, sinon difficiles, tout au moins
J laborieuses; il n’en sera pas ainsi, et comme
l’artiste doit, nous l’avons dit précédemment,
j corriger ou exagérer certaines anamorphoses,
donner plus de liberté à son acquis pictural et
moins de rigidité au tracé géométrique, il mettra
seulement en place les grandes lignes et les
grandes masses.
Ce croquis représente un fragment d’épure
pour l’établissement de la jolie maquette de
Notre-Dame de Paris, que Philippe Chaperon
exposa dans la section de l’art théâtral à l’Expo-
sition universelle de 1900.
Lorsque l’artiste a mis en perspective ces
divers petits tableaux, sur autant de feuillets de
carton qu’il est nécessaire, y compris les tableaux
inclinés représentant le plafond et le sol, il con-
struit sa maquette.
Nous donnons ici deux dessins de l’une d’elles,
celle du 6e tableau établi par lui pour la pièce
d’Emile Bergerat, Plus que Reine, représentée
au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1899.
Il nous la montre vue d’avant et vue d’arrière,
l’implantation est accidentelle, les feuillets de
carton, incisés au canif, sont fixés sur le sol
(plan du théâtre, collé sur un fort carton ou une
planchette de bois) par des clous; il relie entre
eux les éléments avec des épingles.
On a, en petit, le futur décor, et c’est sur ce
joujou que l’on réglera de façon définitive la
distribution des feuillets.
Après ces modifications, la partie créatrice
de l’œuvre est achevée; les élèves vont ensuite
agrandir les feuillets et couvrir de couleurs de
larges étendues de toiles ; ils réaliseront à peu
de frais des monuments d’un luxe et d’une com-
plication inouïs.
Le report des tracés de perspectives se fait
par craticolage, ou mise au carreau, par l’em-
ploi de vastes compas, etc.
Les ateliers du peintre décorateur sont aussi
vastes que possible; nous donnons celui de
Pli. Chaperon, mis en perspective et dessiné
par lui-même; il a réuni là toutes les phases du
travail : à gauche, sur une table élevée, le gui-
gnol contenant la maquette.
Au premier plan, la palette, grand rectangle
portant sur trois côtés les pots à peinture, à
droite le pupitre pour la consultation et le
porte-traceurs (pinceaux ou fusains).
Lorsque les lignes sont peu longues, lm,50 à
2 mètres au plus, on se sert de règles emman-
chées, et l’artiste, légèrement penché comme à
gauche, trace le long du guide.
Les grandes lignes sont fouettées au cordeau.
Si certains détails sont assez délicats à mettre
en place, on trace sur papier, on perfore les
traits et, grâce à ces poncifs, on peut, au moyen
d’un sachet tampon, reproduire sur la toile le
réseau perforé; pour multiplier un motif cou-
rant ou un motif d’angle, on aura recours au
papier découpé, ou pochoir. Dans tous les
cas, on repassera tous les traits au pinceau,
avec une encre capable de réapparaître
sous les diverses couches de peinture.
La toile est tendue, puis clouée sur le
plancher de l’atelier; on la couvre d’une
couche d’apprêt, pour faciliter la mise en
place des lignes.
Cette couche constitue en même temps
un ton local; cependant, pour le décor
d’architecture, on applique en détrempe
de préférence du blanc de Meudon, fixé
à la colle de peau bien chaude (blanc de
craye ou de plâtre des vieux auteurs,
mélangé à la colle de gant et rognures
de parchemin ; il est bon, disent-ils, d'em-
ployer une toile un peu vieille et demy-
usée, elle est plus unie).
Si l’on désire plus de lisse, on applique
deux couches au lieu d’une.
La peinture est faite à la détrempe,
c’est-à-dire que les couleurs, broyées à
l’eau, forment une masse pâteuse placée,
suivant la couleur, dans un vase spécial. Au
moment de l’application, qui se fait avec de
grosses brosses, on mêle les tons avec de la
colle de peau échauffée.
Pour les parties vaporeuses, pour les ciels,
on couche en une seule fois; aussi sont-ils de
moindre durée.
Cette peinture économique, que l’on ne vernit
jamais, offre de gros avantages pour la décora-
tion scénique; si elle est peu résistante, parce
que le grain de la toile est à peine recouvert,
elle possède une grande fraîcheur de ton. Elle
apparaît inachevée et hâtive à première vue, il
6° Tableau de « Plus que Reine »
Maquette vue d'arrière.
semble qu’il y ait là une grosse imperfection
dans le travail. Et bien, ce sont ces défauts
apparents qui vont être les grands facteurs de
l’illusion scénique. Faites plus consciencieuse-
ment votre peinture, empâtez votre toile, sup-
primez son grain, votre œuvre deviendra plate
et sans relief. C’est le grain de la toile qui fera
naître l’atmosphère; la lumière n’éclairera plus