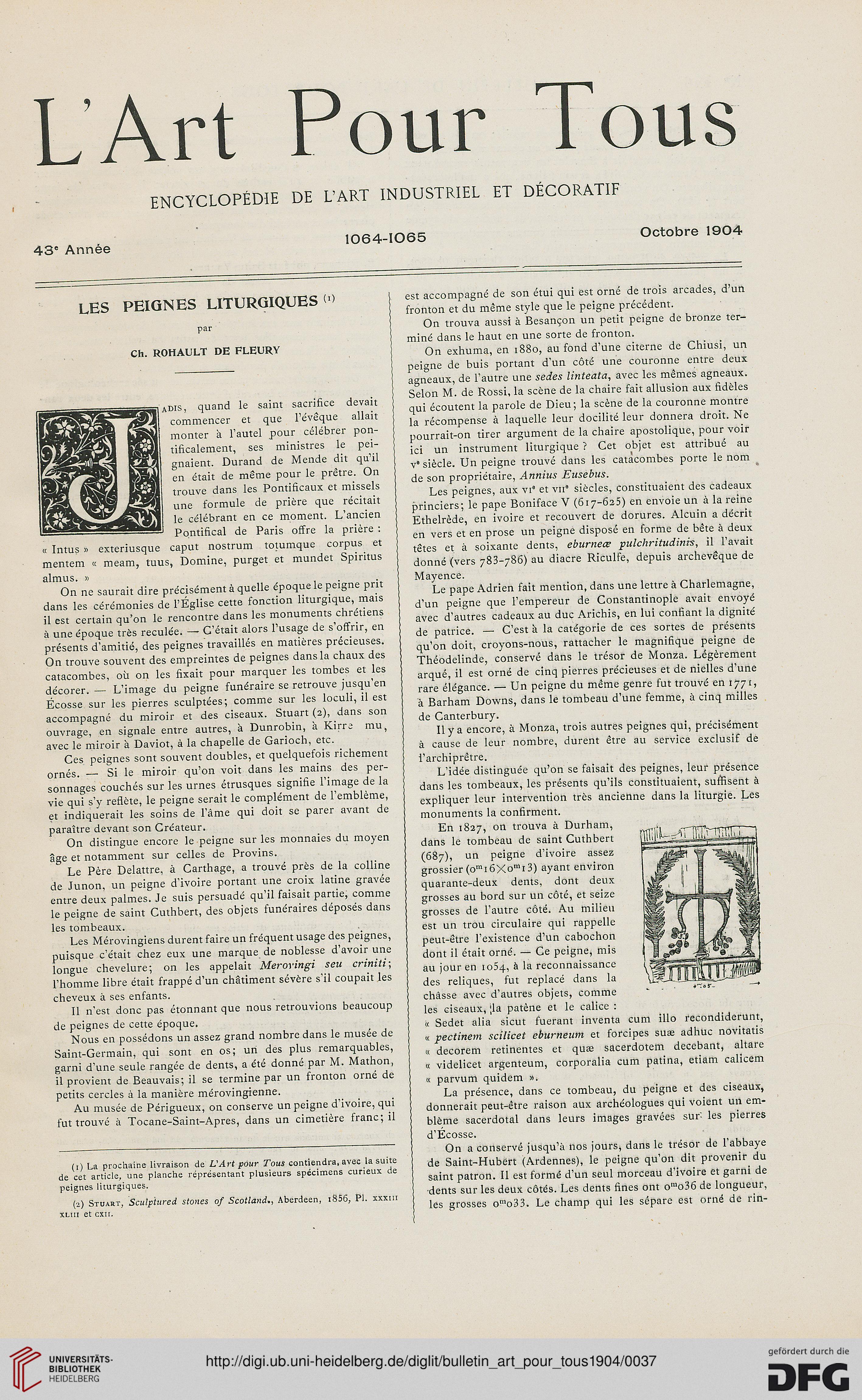L’Art Pour Tous
ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF
43e Année
1064-1065
Octobre 1904
les peignes LITURGIQUES ■>
par
Ch. ROHAULT DE FLEURY
dis, quand le saint sacrifice devait
commencer et que l’évêque allait
monter à l’autel pour célébrer pon-
tificalement, ses ministres le pei-
gnaient. Durand de Mende dit qu’il
en était de même pour le prêtre. On
trouve dans les Pontificaux et missels
une formule de prière que récitait
le célébrant en ce moment. L’ancien
Pontifical de Paris offre la prière :
« Intus » exteriusque caput nostrum totumque corpus et
mentent « meam, tuus, Domine, purget et mundet Spiritus
almus. »
On ne saurait dire précisément à quelle époque le peigne prit
dans les cérémonies de l’Église cette fonction liturgique, mais
il est certain qu’on le rencontre dans les monuments chrétiens
à une époque très reculée. — C’était alors l’usage de s’offrir, en
présents d’amitié, des peignes travaillés en matières précieuses.
On trouve souvent des empreintes de peignes dans la chaux des
catacombes, où on les fixait pour marquer les tombes et les
décorer. — L’image du peigne funéraire se retrouve jusqu’en
Écosse sur les pierres sculptées; comme sur les loculi, il est
accompagné du miroir et des ciseaux. Stuart (2), dans son
ouvrage, en signale entre autres, à Dunrobin, à Kirre mu,
avec le miroir à Daviot, à la chapelle de Garioch, etc.
Ces peignes sont souvent doubles, et quelquefois richement
ornés. — Si le miroir qu’on voit dans les mains des per-
sonnages couchés sur les urnes étrusques signifie l’image de la
vie qui s’y reflète, le peigne serait le complément de l’emblème,
et indiquerait les soins de l’âme qui doit se parer avant de
paraître devant son Créateur.
On distingue encore le peigne sur les monnaies du moyen
âge et notamment sur celles de Provins.
Le Père Delattre, à Carthage, a trouvé près de la colline
de Junon, un peigne d’ivoire portant une croix latine gravée
entre deux palmes. Je suis persuadé qu’il faisait partie, comme
le peigne de saint Cuthbert, des objets funéraires déposés dans
les tombeaux.
Les Mérovingiens durent faire un fréquent usage des peignes,
puisque c’était chez eux une marque de noblesse d’avoir une
longue chevelure; on les appelait Meroringi seu criniti;
l’homme libre était frappé d’un châtiment sévère s’il coupait les
cheveux à ses enfants.
Il n’est donc pas étonnant que nous retrouvions beaucoup
de peignes de cette époque.
Nous en possédons un assez grand nombre dans le musée de
Saint-Germain, qui sont en os; un des plus remarquables,
garni d’une seule rangée de dents, a été donné par M. Mathon,
il provient de Beauvais; il se termine par un fronton orné de
petits cercles à la manière mérovingienne.
Au musée de Périgueux, on conserve un peigne d’ivoire, qui
fut trouvé à Tocane-Saint-Apres, dans un cimetière franc; il
(1) La prochaine livraison de L'Art pour Tous contiendra, avec la suite
de cet article, une planche représentant plusieurs spécimens curieux de
peignes liturgiques.
(2) Stuart, Sculptured stones of Scotland., Aberdeen, 1856, PI. xxxm
xliii et cxn.
i est accompagné de son étui qui est orné de trois arcades, d’un
fronton et du même style que le peigne précédent.
On trouva aussi à Besançon un petit peigne de bronze ter-
miné dans le haut en une sorte de fronton.
On exhuma, en 1880, au fond d’une citerne de Chiusi, un
peigne de buis portant d’un côté une couronne entre deux
agneaux, de l’autre une sedes linteata, avec les mêmes agneaux.
Selon M. de Rossi, la scène de la chaire fait allusion aux fidèles
qui écoutent la parole de Dieu; la scène de la couronne montre
la récompense à laquelle leur docilité leur donnera droit. Ne
pourrait-on tirer argument de la chaire apostolique, pour voir
ici un instrument liturgique ? Cet objet est attribué au
v“ siècle. Un peigne trouvé dans les catacombes porte le nom
de son propriétaire, Annius Eusebus.
Les peignes, aux vie et vu" siècles, constituaient des cadeaux
princiers; le pape Boniface V (617-625) en envoie un à la reine
Ethelrède, en ivoire et recouvert de dorures. Alcuin a décrit
en vers et en prose un peigne disposé en forme de bête à deux
têtes et à soixante dents, eburneæ pulchritudinis, il l’avait
donné (vers 783-786) au diacre Riculfe, depuis archevêque de
Mayence.
Le pape Adrien fait mention, dans une lettre à Charlemagne,
d’un peigne que l’empereur de Constantinople avait envoyé
avec d’autres cadeaux au duc Arichis, en lui confiant la dignité
de patrice. — C’est à la catégorie de ces sortes de présents
qu’on doit, croyons-nous, rattacher le magnifique peigne de
Théodelinde, conservé dans le trésor de Monza. Légèrement
arqué, il est orné de cinq pierres précieuses et de nielles d’une
rare élégance. — Un peigne du même genre fut trouvé en 1771,
à Barham Downs, dans le tombeau d’une femme, à cinq milles
de Canterbury.
Il y a encore, à Monza, trois autres peignes qui, précisément
à cause de leur nombre, durent être au service exclusif de
i’archiprêtre.
L’idée distinguée qu’on se faisait des peignes, leur présence
dans les tombeaux, les présents qu’ils constituaient, suffisent à
expliquer leur intervention très ancienne dans la liturgie. Les
monuments la confirment.
En 1827, on trouva à Durham,
dans le tombeau de saint Cuthbert
(687), un peigne d’ivoire assez
grossier (omi6Xomi3) ayant environ
quarante-deux dents, dont deux
grosses au bord sur un côté, et seize
grosses de l’autre côté. Au milieu
est un trou circulaire qui rappelle
peut-être l’existence d’un cabochon
dont il était orné. — Ce peigne, mis
au jour en io5q., à la reconnaissance
des reliques, fut replacé dans la
châsse avec d’autres objets, comme
les ciseaux, ;la patène et le calice :
« Sedet alia sicut fuerant inventa cum illo recondiderunt,
« pectinem scilicet eburneum et forcipes suæ adhuc novitatis
« decorem retinentes et quæ sacerdotem decebant, altare
« videlicet argenteum, corporalia cum patina, etiam calicem
« parvum quidem ».
La présence, dans ce tombeau, du peigne et des ciseaux,
donnerait peut-être raison aux archéologues qui voient un em-
blème sacerdotal dans leurs images gravées sur les pierres
d’Écosse.
On a conservé jusqu’à nos jours, dans le trésor de l’abbaye
de Saint-Hubert (Ardennes), le peigne qu’on dit provenir du
saint patron. Il est formé d’un seul morceau d’ivoire et garni de
dents sur les deux côtés. Les dents fines ont orao36 de longueur,
les grosses omo33. Le champ qui les sépare est orné de rin-
ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF
43e Année
1064-1065
Octobre 1904
les peignes LITURGIQUES ■>
par
Ch. ROHAULT DE FLEURY
dis, quand le saint sacrifice devait
commencer et que l’évêque allait
monter à l’autel pour célébrer pon-
tificalement, ses ministres le pei-
gnaient. Durand de Mende dit qu’il
en était de même pour le prêtre. On
trouve dans les Pontificaux et missels
une formule de prière que récitait
le célébrant en ce moment. L’ancien
Pontifical de Paris offre la prière :
« Intus » exteriusque caput nostrum totumque corpus et
mentent « meam, tuus, Domine, purget et mundet Spiritus
almus. »
On ne saurait dire précisément à quelle époque le peigne prit
dans les cérémonies de l’Église cette fonction liturgique, mais
il est certain qu’on le rencontre dans les monuments chrétiens
à une époque très reculée. — C’était alors l’usage de s’offrir, en
présents d’amitié, des peignes travaillés en matières précieuses.
On trouve souvent des empreintes de peignes dans la chaux des
catacombes, où on les fixait pour marquer les tombes et les
décorer. — L’image du peigne funéraire se retrouve jusqu’en
Écosse sur les pierres sculptées; comme sur les loculi, il est
accompagné du miroir et des ciseaux. Stuart (2), dans son
ouvrage, en signale entre autres, à Dunrobin, à Kirre mu,
avec le miroir à Daviot, à la chapelle de Garioch, etc.
Ces peignes sont souvent doubles, et quelquefois richement
ornés. — Si le miroir qu’on voit dans les mains des per-
sonnages couchés sur les urnes étrusques signifie l’image de la
vie qui s’y reflète, le peigne serait le complément de l’emblème,
et indiquerait les soins de l’âme qui doit se parer avant de
paraître devant son Créateur.
On distingue encore le peigne sur les monnaies du moyen
âge et notamment sur celles de Provins.
Le Père Delattre, à Carthage, a trouvé près de la colline
de Junon, un peigne d’ivoire portant une croix latine gravée
entre deux palmes. Je suis persuadé qu’il faisait partie, comme
le peigne de saint Cuthbert, des objets funéraires déposés dans
les tombeaux.
Les Mérovingiens durent faire un fréquent usage des peignes,
puisque c’était chez eux une marque de noblesse d’avoir une
longue chevelure; on les appelait Meroringi seu criniti;
l’homme libre était frappé d’un châtiment sévère s’il coupait les
cheveux à ses enfants.
Il n’est donc pas étonnant que nous retrouvions beaucoup
de peignes de cette époque.
Nous en possédons un assez grand nombre dans le musée de
Saint-Germain, qui sont en os; un des plus remarquables,
garni d’une seule rangée de dents, a été donné par M. Mathon,
il provient de Beauvais; il se termine par un fronton orné de
petits cercles à la manière mérovingienne.
Au musée de Périgueux, on conserve un peigne d’ivoire, qui
fut trouvé à Tocane-Saint-Apres, dans un cimetière franc; il
(1) La prochaine livraison de L'Art pour Tous contiendra, avec la suite
de cet article, une planche représentant plusieurs spécimens curieux de
peignes liturgiques.
(2) Stuart, Sculptured stones of Scotland., Aberdeen, 1856, PI. xxxm
xliii et cxn.
i est accompagné de son étui qui est orné de trois arcades, d’un
fronton et du même style que le peigne précédent.
On trouva aussi à Besançon un petit peigne de bronze ter-
miné dans le haut en une sorte de fronton.
On exhuma, en 1880, au fond d’une citerne de Chiusi, un
peigne de buis portant d’un côté une couronne entre deux
agneaux, de l’autre une sedes linteata, avec les mêmes agneaux.
Selon M. de Rossi, la scène de la chaire fait allusion aux fidèles
qui écoutent la parole de Dieu; la scène de la couronne montre
la récompense à laquelle leur docilité leur donnera droit. Ne
pourrait-on tirer argument de la chaire apostolique, pour voir
ici un instrument liturgique ? Cet objet est attribué au
v“ siècle. Un peigne trouvé dans les catacombes porte le nom
de son propriétaire, Annius Eusebus.
Les peignes, aux vie et vu" siècles, constituaient des cadeaux
princiers; le pape Boniface V (617-625) en envoie un à la reine
Ethelrède, en ivoire et recouvert de dorures. Alcuin a décrit
en vers et en prose un peigne disposé en forme de bête à deux
têtes et à soixante dents, eburneæ pulchritudinis, il l’avait
donné (vers 783-786) au diacre Riculfe, depuis archevêque de
Mayence.
Le pape Adrien fait mention, dans une lettre à Charlemagne,
d’un peigne que l’empereur de Constantinople avait envoyé
avec d’autres cadeaux au duc Arichis, en lui confiant la dignité
de patrice. — C’est à la catégorie de ces sortes de présents
qu’on doit, croyons-nous, rattacher le magnifique peigne de
Théodelinde, conservé dans le trésor de Monza. Légèrement
arqué, il est orné de cinq pierres précieuses et de nielles d’une
rare élégance. — Un peigne du même genre fut trouvé en 1771,
à Barham Downs, dans le tombeau d’une femme, à cinq milles
de Canterbury.
Il y a encore, à Monza, trois autres peignes qui, précisément
à cause de leur nombre, durent être au service exclusif de
i’archiprêtre.
L’idée distinguée qu’on se faisait des peignes, leur présence
dans les tombeaux, les présents qu’ils constituaient, suffisent à
expliquer leur intervention très ancienne dans la liturgie. Les
monuments la confirment.
En 1827, on trouva à Durham,
dans le tombeau de saint Cuthbert
(687), un peigne d’ivoire assez
grossier (omi6Xomi3) ayant environ
quarante-deux dents, dont deux
grosses au bord sur un côté, et seize
grosses de l’autre côté. Au milieu
est un trou circulaire qui rappelle
peut-être l’existence d’un cabochon
dont il était orné. — Ce peigne, mis
au jour en io5q., à la reconnaissance
des reliques, fut replacé dans la
châsse avec d’autres objets, comme
les ciseaux, ;la patène et le calice :
« Sedet alia sicut fuerant inventa cum illo recondiderunt,
« pectinem scilicet eburneum et forcipes suæ adhuc novitatis
« decorem retinentes et quæ sacerdotem decebant, altare
« videlicet argenteum, corporalia cum patina, etiam calicem
« parvum quidem ».
La présence, dans ce tombeau, du peigne et des ciseaux,
donnerait peut-être raison aux archéologues qui voient un em-
blème sacerdotal dans leurs images gravées sur les pierres
d’Écosse.
On a conservé jusqu’à nos jours, dans le trésor de l’abbaye
de Saint-Hubert (Ardennes), le peigne qu’on dit provenir du
saint patron. Il est formé d’un seul morceau d’ivoire et garni de
dents sur les deux côtés. Les dents fines ont orao36 de longueur,
les grosses omo33. Le champ qui les sépare est orné de rin-