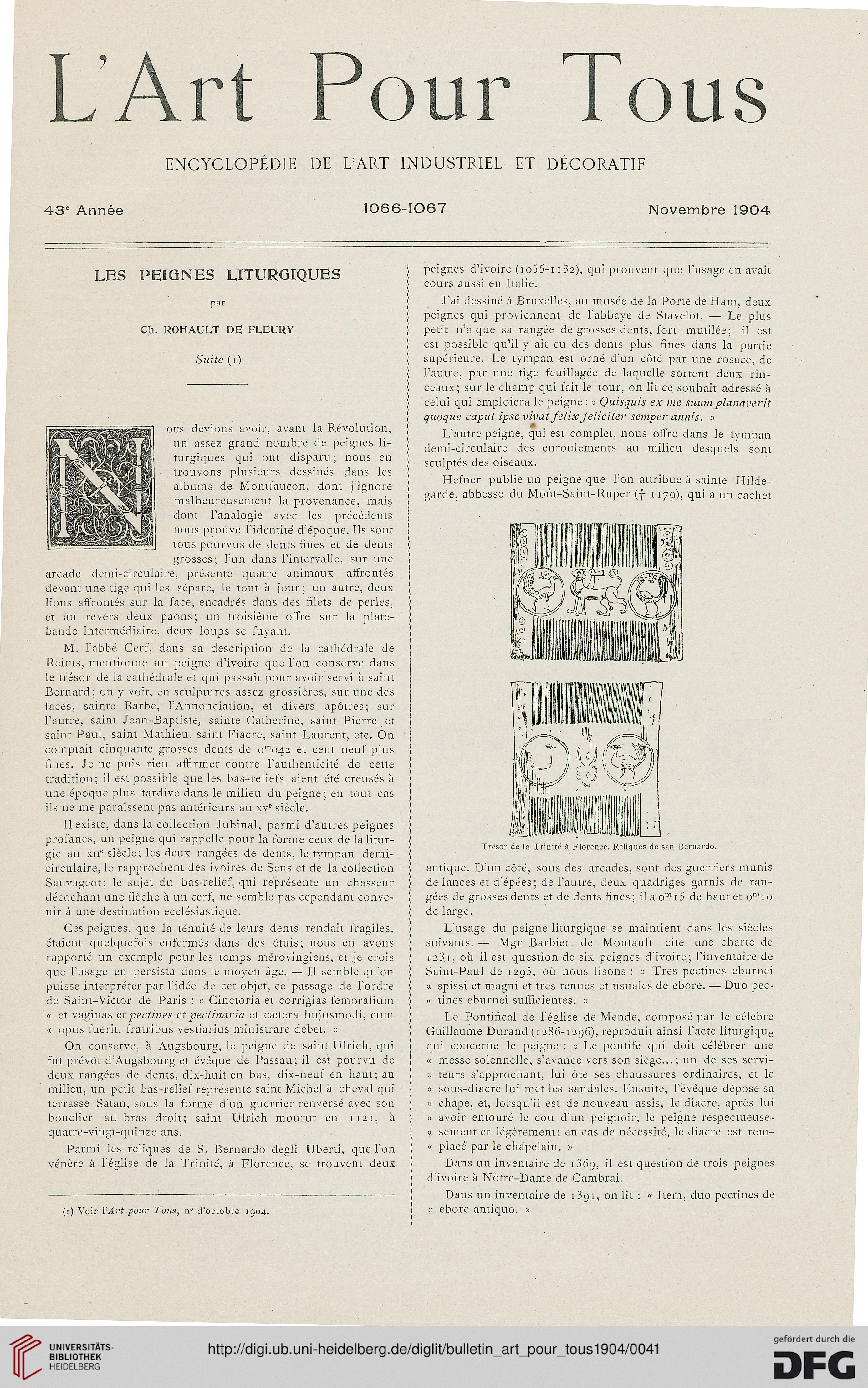L’Art Pour Tous
ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF
43e Année 1066-1067 Novembre 1904
LES PEIGNES LITURGIQUES
par
Ch. ROHAULT DE FLEURY
Suite (i)
ods devions avoir, avant la Révolution, \
un assez grand nombre de peignes li-
turgiques qui ont disparu ; nous en
trouvons plusieurs dessinés dans les
albums de Montfaucon, dont j’ignore
malheureusement la provenance, mais
dont l’analogie avec les précédents
nous prouve l’identité d’époque. Ils sont
tous pourvus de dents fines et de dents
grosses; l’un dans l’intervalle, sur une
arcade demi-circulaire, présente quatre animaux affrontés
devant une tige qui les sépare, le tout à jour; un autre, deux
lions affrontés sur la face, encadrés dans des filets de perles,
et au revers deux paons; un troisième offre sur la plate-
bande intermédiaire, deux loups se fuyant.
M. l’abbé Cerf, dans sa description de la cathédrale de
Reims, mentionne un peigne d’ivoire que l’on conserve dans
le trésor de la cathédrale et qui passait pour avoir servi à saint
Bernard; on y voit, en sculptures assez grossières, sur une des
faces, sainte Barbe, l’Annonciation, et divers apôtres; sur
l’autre, saint Jean-Baptiste, sainte Catherine, saint Pierre et
saint Paul, saint Mathieu, saint Fiacre, saint Laurent, etc. On
comptait cinquante grosses dents de omoq.2 et cent neuf plus
fines. Je ne puis rien affirmer contre l’authenticité de cette
tradition; il est possible que les bas-reliefs aient été creusés à
une époque plus tardive dans le milieu du peigne; en tout cas
ils ne me paraissent pas antérieurs au xve siècle.
Il existe, dans la collection Jubinal, parmi d’autres peignes
profanes, un peigne qui rappelle pour la forme ceux de la litur-
gie au xrie siècle; les deux rangées de dents, le tympan demi-
circulaire, le rapprochent des ivoires de Sens et de la collection
Sauvageot; le sujet du bas-relief, qui représente un chasseur
décochant une flèche à un cerf, ne semble pas cependant conve-
nir à une destination ecclésiastique.
Ces peignes, que la ténuité de leurs dents rendait fragiles,
étaient quelquefois enfermés dans des étuis; nous en avons
rapporté un exemple pour les temps mérovingiens, et je crois
que l’usage en persista dans le moyen âge. — Il semble qu'on
puisse interpréter par l’idée de cet objet, ce passage de l’ordre
de Saint-Victor de Paris : « Cinctoria et corrigias femoralium
« et vaginas et pectines et pectinaria et cætera hujusmodi, cum
« opus fuerit, fratribus vestiarius ministrare debet. »
On conserve, à Augsbourg, le peigne de saint Ulrich, qui
fut prévôt d’Augsbourg et évêque de Passau; il est pourvu de
deux rangées de dents, dix-huit en bas, dix-neuf en haut; au
milieu, un petit bas-relief représente saint Michel à cheval qui
terrasse Satan, sous la forme d’un guerrier renversé avec son
bouclier au bras droit; saint Ulrich mourut en ii2r, à
quatre-vingt-quinze ans.
Parmi les reliques de S. Bernardo degli Uberti, que l’on
vénère à l’église de la Trinité, à Florence, se trouvent deux
(i) Voir l'Art pour Tous, n° d’octobre 1904..
peignes d’ivoire (io55-ii32), qui prouvent que l'usage en avait
cours aussi en Italie.
J’ai dessiné à Bruxelles, au musée de la Porte de Ham, deux
peignes qui proviennent de l’abbaye de Stavelot. — Le plus
petit n’a que sa rangée de grosses dents, fort mutilée; il est
est possible qu’il y ait eu des dents plus fines dans la partie
supérieure. Le tympan est orné d’un côté par une rosace, de
l’autre, par une tige feuillagée de laquelle sortent deux rin-
ceaux; sur le champ qui fait le tour, on lit ce souhait adressé à
celui qui emploiera le peigne : « Quisquis ex me suumplanaverit
quoque caput ipse vivatfelixféliciter semper annis. »
L’autre peigne, qui est complet, nous offre dans le tympan
demi-circulaire des enroulements au milieu desquels sont
sculptés des oiseaux.
Hefner publie un peigne que l’on attribue à sainte Hilde-
garde, abbesse du Mont-Saint-Ruper (f 1179), qui a un cachet
Trésor de la Trinité à Florence. Reliques de san Bernardo.
antique. D’un côté, sous des arcades, sont des guerriers munis
de lances et d’épées; de l’autre, deux quadriges garnis de ran-
gées de grosses dents et de dents fines; il a omi 5 de haut et omio
de large.
L’usage du peigne liturgique se maintient dans les siècles
suivants. — Mgr Barbier de Montault cite une charte de
1251, où il est question de six peignes d’ivoire; l’inventaire de
Saint-Paul de 1295, où nous lisons : « Très pectines eburnei
« spissi et magni et très tenues et usuales de ebore. — Duo pec-
« fines eburnei sufficientes. »
Le Pontifical de l’église de Mende, composé par le célèbre
Guillaume Durand (1286-1296), reproduit ainsi l’acte liturgique
qui concerne le peigne : « Le pontife qui doit célébrer une
« messe solennelle, s’avance vers son siège...; un de ses servi-
ce teurs s’approchant, lui ôte ses chaussures ordinaires, et le
« sous-diacre lui met les sandales. Ensuite, l’évêque dépose sa
« chape, et, lorsqu'il est de nouveau assis, le diacre, après lui
« avoir entouré le cou d’un peignoir, le peigne respectueuse-
« sement et légèrement; en cas de nécessité, le diacre est rem-
« placé par le chapelain. »
Dans un inventaire de 1369, il est question de trois peignes
d’ivoire à Notre-Dame de Cambrai.
Dans un inventaire de 1391, on lit : « Item, duo pectines de
cc ebore antiquo. »
ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF
43e Année 1066-1067 Novembre 1904
LES PEIGNES LITURGIQUES
par
Ch. ROHAULT DE FLEURY
Suite (i)
ods devions avoir, avant la Révolution, \
un assez grand nombre de peignes li-
turgiques qui ont disparu ; nous en
trouvons plusieurs dessinés dans les
albums de Montfaucon, dont j’ignore
malheureusement la provenance, mais
dont l’analogie avec les précédents
nous prouve l’identité d’époque. Ils sont
tous pourvus de dents fines et de dents
grosses; l’un dans l’intervalle, sur une
arcade demi-circulaire, présente quatre animaux affrontés
devant une tige qui les sépare, le tout à jour; un autre, deux
lions affrontés sur la face, encadrés dans des filets de perles,
et au revers deux paons; un troisième offre sur la plate-
bande intermédiaire, deux loups se fuyant.
M. l’abbé Cerf, dans sa description de la cathédrale de
Reims, mentionne un peigne d’ivoire que l’on conserve dans
le trésor de la cathédrale et qui passait pour avoir servi à saint
Bernard; on y voit, en sculptures assez grossières, sur une des
faces, sainte Barbe, l’Annonciation, et divers apôtres; sur
l’autre, saint Jean-Baptiste, sainte Catherine, saint Pierre et
saint Paul, saint Mathieu, saint Fiacre, saint Laurent, etc. On
comptait cinquante grosses dents de omoq.2 et cent neuf plus
fines. Je ne puis rien affirmer contre l’authenticité de cette
tradition; il est possible que les bas-reliefs aient été creusés à
une époque plus tardive dans le milieu du peigne; en tout cas
ils ne me paraissent pas antérieurs au xve siècle.
Il existe, dans la collection Jubinal, parmi d’autres peignes
profanes, un peigne qui rappelle pour la forme ceux de la litur-
gie au xrie siècle; les deux rangées de dents, le tympan demi-
circulaire, le rapprochent des ivoires de Sens et de la collection
Sauvageot; le sujet du bas-relief, qui représente un chasseur
décochant une flèche à un cerf, ne semble pas cependant conve-
nir à une destination ecclésiastique.
Ces peignes, que la ténuité de leurs dents rendait fragiles,
étaient quelquefois enfermés dans des étuis; nous en avons
rapporté un exemple pour les temps mérovingiens, et je crois
que l’usage en persista dans le moyen âge. — Il semble qu'on
puisse interpréter par l’idée de cet objet, ce passage de l’ordre
de Saint-Victor de Paris : « Cinctoria et corrigias femoralium
« et vaginas et pectines et pectinaria et cætera hujusmodi, cum
« opus fuerit, fratribus vestiarius ministrare debet. »
On conserve, à Augsbourg, le peigne de saint Ulrich, qui
fut prévôt d’Augsbourg et évêque de Passau; il est pourvu de
deux rangées de dents, dix-huit en bas, dix-neuf en haut; au
milieu, un petit bas-relief représente saint Michel à cheval qui
terrasse Satan, sous la forme d’un guerrier renversé avec son
bouclier au bras droit; saint Ulrich mourut en ii2r, à
quatre-vingt-quinze ans.
Parmi les reliques de S. Bernardo degli Uberti, que l’on
vénère à l’église de la Trinité, à Florence, se trouvent deux
(i) Voir l'Art pour Tous, n° d’octobre 1904..
peignes d’ivoire (io55-ii32), qui prouvent que l'usage en avait
cours aussi en Italie.
J’ai dessiné à Bruxelles, au musée de la Porte de Ham, deux
peignes qui proviennent de l’abbaye de Stavelot. — Le plus
petit n’a que sa rangée de grosses dents, fort mutilée; il est
est possible qu’il y ait eu des dents plus fines dans la partie
supérieure. Le tympan est orné d’un côté par une rosace, de
l’autre, par une tige feuillagée de laquelle sortent deux rin-
ceaux; sur le champ qui fait le tour, on lit ce souhait adressé à
celui qui emploiera le peigne : « Quisquis ex me suumplanaverit
quoque caput ipse vivatfelixféliciter semper annis. »
L’autre peigne, qui est complet, nous offre dans le tympan
demi-circulaire des enroulements au milieu desquels sont
sculptés des oiseaux.
Hefner publie un peigne que l’on attribue à sainte Hilde-
garde, abbesse du Mont-Saint-Ruper (f 1179), qui a un cachet
Trésor de la Trinité à Florence. Reliques de san Bernardo.
antique. D’un côté, sous des arcades, sont des guerriers munis
de lances et d’épées; de l’autre, deux quadriges garnis de ran-
gées de grosses dents et de dents fines; il a omi 5 de haut et omio
de large.
L’usage du peigne liturgique se maintient dans les siècles
suivants. — Mgr Barbier de Montault cite une charte de
1251, où il est question de six peignes d’ivoire; l’inventaire de
Saint-Paul de 1295, où nous lisons : « Très pectines eburnei
« spissi et magni et très tenues et usuales de ebore. — Duo pec-
« fines eburnei sufficientes. »
Le Pontifical de l’église de Mende, composé par le célèbre
Guillaume Durand (1286-1296), reproduit ainsi l’acte liturgique
qui concerne le peigne : « Le pontife qui doit célébrer une
« messe solennelle, s’avance vers son siège...; un de ses servi-
ce teurs s’approchant, lui ôte ses chaussures ordinaires, et le
« sous-diacre lui met les sandales. Ensuite, l’évêque dépose sa
« chape, et, lorsqu'il est de nouveau assis, le diacre, après lui
« avoir entouré le cou d’un peignoir, le peigne respectueuse-
« sement et légèrement; en cas de nécessité, le diacre est rem-
« placé par le chapelain. »
Dans un inventaire de 1369, il est question de trois peignes
d’ivoire à Notre-Dame de Cambrai.
Dans un inventaire de 1391, on lit : « Item, duo pectines de
cc ebore antiquo. »