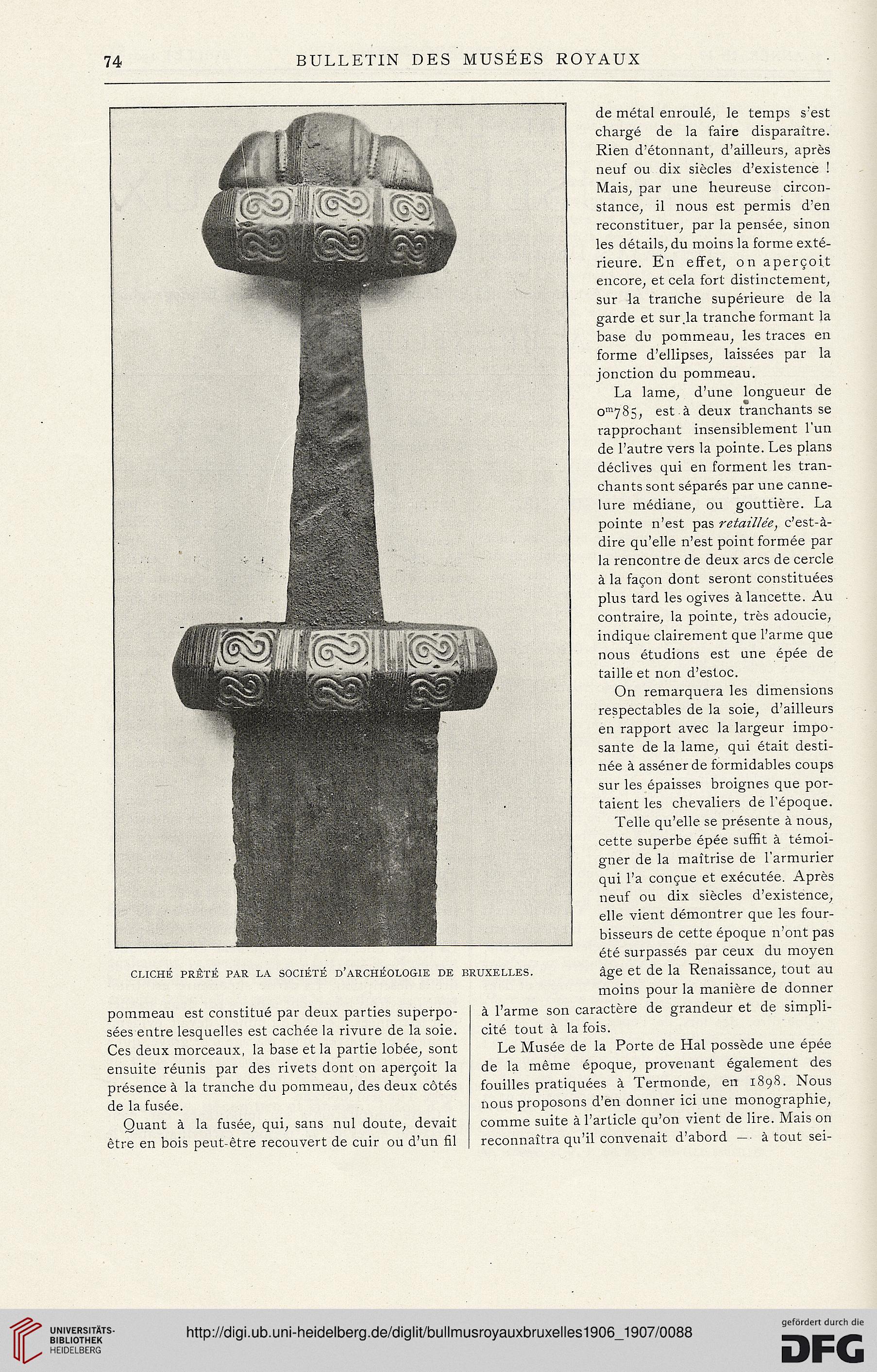74
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
CUCHÉ PRÊTÉ PAR LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES.
pommeau est constitué par deux parties superpo-
sées entre lesquelles est cachée la rivure de la soie.
Ces deux morceaux, la base et la partie lobée, sont
ensuite réunis par des rivets dont on aperçoit la
présence à la tranche du pommeau, des deux côtés
de la fusée.
Quant à la fusée, qui, sans nul doute, devait
être en bois peut-être recouvert de cuir ou d'un Al
de métal enroulé, le temps s'est
chargé de la faire disparaître.
Rien d'étonnant, d'ailleurs, après
neuf ou dix siècles d'existence !
Mais, par une heureuse circon-
stance, il nous est permis d'en
reconstituer, par la pensée, sinon
les détails, du moins la forme exté-
rieure. En effet, on aperçoit
encore, et cela fort distinctement,
sur la tranche supérieure de la
garde et sur.la tranche formant la
base du pommeau, les traces en
forme d'ellipses, laissées par la
jonction du pommeau.
La lame, d'une longueur de
0^785, est à deux tranchants se
rapprochant insensiblement l'un
de l'autre vers la pointe. Les plans
déclives qui en forment les tran-
chants sont séparés par une canne-
lure médiane, ou gouttière. La
pointe n'est pas yg7<3z7/g',<?, c'est-à-
dire qu'elle n'est point formée par
la rencontre de deux arcs de cercle
à la façon dont seront constituées
plus tard les ogives à lancette. Au
contraire, la pointe, très adoucie,
indique clairement que l'arme que
nous étudions est une épée de
taille et non d'estoc.
On remarquera les dimensions
respectables de la soie, d'ailleurs
en rapport avec la largeur impo-
sante de la lame, qui était desti-
née à asséner de formidables coups
sur les épaisses broignes que por-
taient les chevaliers de l'époque.
Telle qu'elle se présente à nous,
cette superbe épée suffit à témoi-
gner de la maîtrise de l'armurier
qui l'a conçue et exécutée. Après
neuf ou dix siècles d'existence,
elle vient démontrer que les four-
bisseurs de cette époque n'ont pas
été surpassés par ceux du moyen
âge et de la Renaissance, tout au
moins pour la manière de donner
à l'arme son caractère de grandeur et de simpli-
cité tout à la fois.
Le Musée de la Porte de Hal possède une épée
de la même époque, provenant également des
fouilles pratiquées à Termonde, en 1898. Nous
nous proposons d'en donner ici une monographie,
comme suite à l'article qu'on vient de lire. Mais on
reconnaîtra qn'il convenait d'abord — atout sei-
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
CUCHÉ PRÊTÉ PAR LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES.
pommeau est constitué par deux parties superpo-
sées entre lesquelles est cachée la rivure de la soie.
Ces deux morceaux, la base et la partie lobée, sont
ensuite réunis par des rivets dont on aperçoit la
présence à la tranche du pommeau, des deux côtés
de la fusée.
Quant à la fusée, qui, sans nul doute, devait
être en bois peut-être recouvert de cuir ou d'un Al
de métal enroulé, le temps s'est
chargé de la faire disparaître.
Rien d'étonnant, d'ailleurs, après
neuf ou dix siècles d'existence !
Mais, par une heureuse circon-
stance, il nous est permis d'en
reconstituer, par la pensée, sinon
les détails, du moins la forme exté-
rieure. En effet, on aperçoit
encore, et cela fort distinctement,
sur la tranche supérieure de la
garde et sur.la tranche formant la
base du pommeau, les traces en
forme d'ellipses, laissées par la
jonction du pommeau.
La lame, d'une longueur de
0^785, est à deux tranchants se
rapprochant insensiblement l'un
de l'autre vers la pointe. Les plans
déclives qui en forment les tran-
chants sont séparés par une canne-
lure médiane, ou gouttière. La
pointe n'est pas yg7<3z7/g',<?, c'est-à-
dire qu'elle n'est point formée par
la rencontre de deux arcs de cercle
à la façon dont seront constituées
plus tard les ogives à lancette. Au
contraire, la pointe, très adoucie,
indique clairement que l'arme que
nous étudions est une épée de
taille et non d'estoc.
On remarquera les dimensions
respectables de la soie, d'ailleurs
en rapport avec la largeur impo-
sante de la lame, qui était desti-
née à asséner de formidables coups
sur les épaisses broignes que por-
taient les chevaliers de l'époque.
Telle qu'elle se présente à nous,
cette superbe épée suffit à témoi-
gner de la maîtrise de l'armurier
qui l'a conçue et exécutée. Après
neuf ou dix siècles d'existence,
elle vient démontrer que les four-
bisseurs de cette époque n'ont pas
été surpassés par ceux du moyen
âge et de la Renaissance, tout au
moins pour la manière de donner
à l'arme son caractère de grandeur et de simpli-
cité tout à la fois.
Le Musée de la Porte de Hal possède une épée
de la même époque, provenant également des
fouilles pratiquées à Termonde, en 1898. Nous
nous proposons d'en donner ici une monographie,
comme suite à l'article qu'on vient de lire. Mais on
reconnaîtra qn'il convenait d'abord — atout sei-