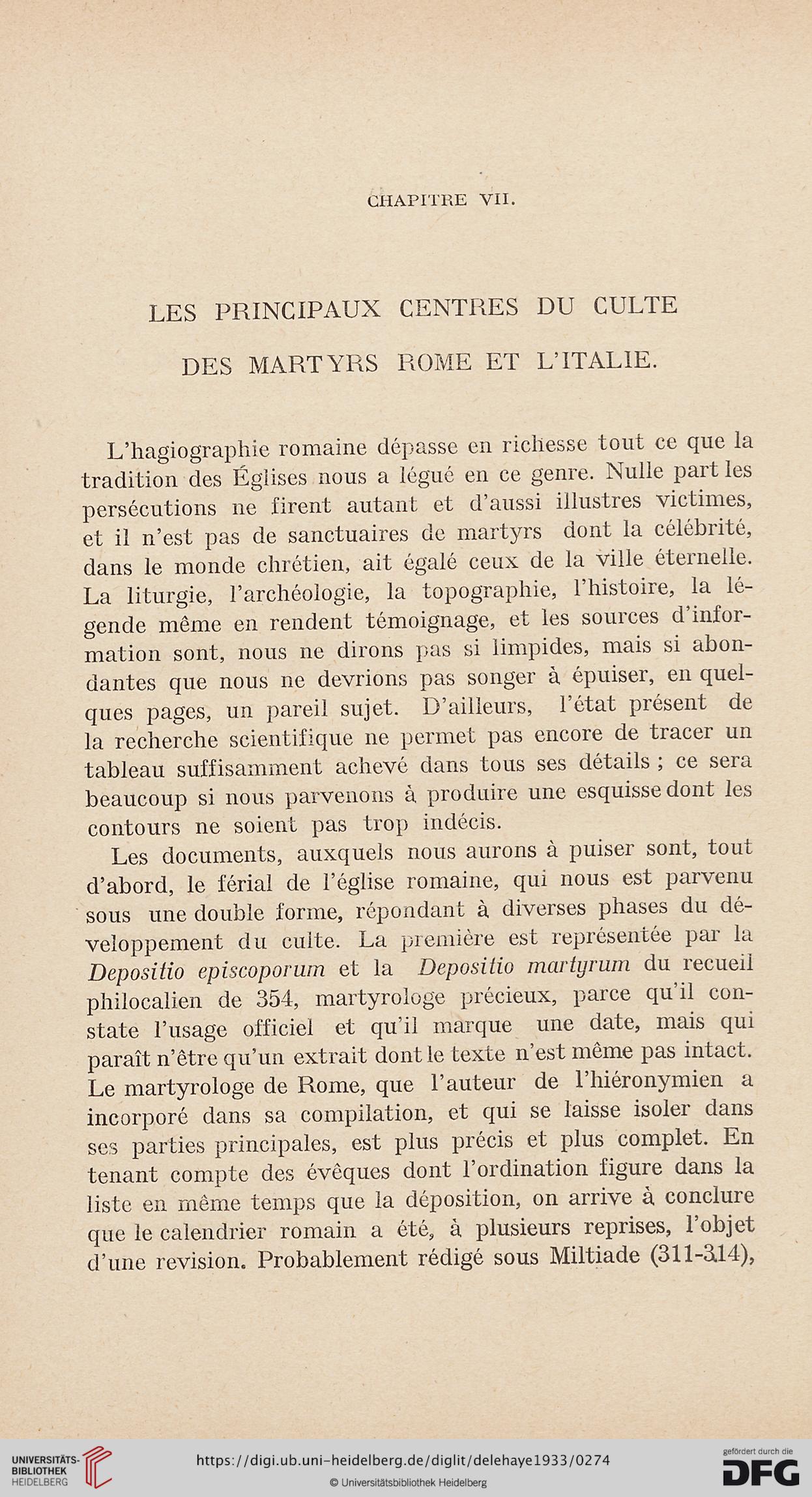CHAPITRE VII.
LES PRINCIPAUX CENTRES DU CULTE
DES MARTYRS ROME ET L’ITALIE.
L’hagiographie romaine dépasse en richesse tout ce que la
tradition des Eglises nous a légué en ce genre. Nulle part les
persécutions ne firent autant et d’aussi illustres victimes,
et il n’est pas de sanctuaires de martyrs dont la célébrité,
dans le monde chrétien, ait égalé ceux de la ville éternelle.
La liturgie, l’archéologie, la topographie, l’histoire, la lé-
gende même en rendent témoignage, et les sources d’infor-
mation sont, nous ne dirons pas si limpides, mais si abon-
dantes que nous ne devrions pas songer à épuiser, en quel-
ques pages, un pareil sujet. D’ailleurs, l’état présent de
la recherche scientifique ne permet pas encore de tracer un
tableau suffisamment achevé dans tous ses détails ; ce sera
beaucoup si nous parvenons à produire une esquisse dont les
contours ne soient pas trop indécis.
Les documents, auxquels nous aurons à puiser sont, tout
d’abord, le férial de l’église romaine, qui nous est parvenu
sous une double forme, répondant à diverses phases du dé-
veloppement du culte. La première est représentée par la
Depositio episcoporum et la Depositio martyrum du recueil
philocalien de 354, martyrologe précieux, parce qu’il con-
state l’usage officiel et qu’il marque une date, mais qui
paraît n’être qu’un extrait dont le texte n’est même pas intact.
Le martyrologe de Rome, que l’auteur de l’iiiéronymien a
incorporé dans sa compilation, et qui se laisse isoler dans
ses parties principales, est plus précis et plus complet. En
tenant compte des évêques dont l’ordination figure dans la
liste en même temps que la déposition, on arrive à conclure
que le calendrier romain a été, à plusieurs reprises, l’objet
d’une révision. Probablement rédigé sous Miltiade (311-314),
LES PRINCIPAUX CENTRES DU CULTE
DES MARTYRS ROME ET L’ITALIE.
L’hagiographie romaine dépasse en richesse tout ce que la
tradition des Eglises nous a légué en ce genre. Nulle part les
persécutions ne firent autant et d’aussi illustres victimes,
et il n’est pas de sanctuaires de martyrs dont la célébrité,
dans le monde chrétien, ait égalé ceux de la ville éternelle.
La liturgie, l’archéologie, la topographie, l’histoire, la lé-
gende même en rendent témoignage, et les sources d’infor-
mation sont, nous ne dirons pas si limpides, mais si abon-
dantes que nous ne devrions pas songer à épuiser, en quel-
ques pages, un pareil sujet. D’ailleurs, l’état présent de
la recherche scientifique ne permet pas encore de tracer un
tableau suffisamment achevé dans tous ses détails ; ce sera
beaucoup si nous parvenons à produire une esquisse dont les
contours ne soient pas trop indécis.
Les documents, auxquels nous aurons à puiser sont, tout
d’abord, le férial de l’église romaine, qui nous est parvenu
sous une double forme, répondant à diverses phases du dé-
veloppement du culte. La première est représentée par la
Depositio episcoporum et la Depositio martyrum du recueil
philocalien de 354, martyrologe précieux, parce qu’il con-
state l’usage officiel et qu’il marque une date, mais qui
paraît n’être qu’un extrait dont le texte n’est même pas intact.
Le martyrologe de Rome, que l’auteur de l’iiiéronymien a
incorporé dans sa compilation, et qui se laisse isoler dans
ses parties principales, est plus précis et plus complet. En
tenant compte des évêques dont l’ordination figure dans la
liste en même temps que la déposition, on arrive à conclure
que le calendrier romain a été, à plusieurs reprises, l’objet
d’une révision. Probablement rédigé sous Miltiade (311-314),