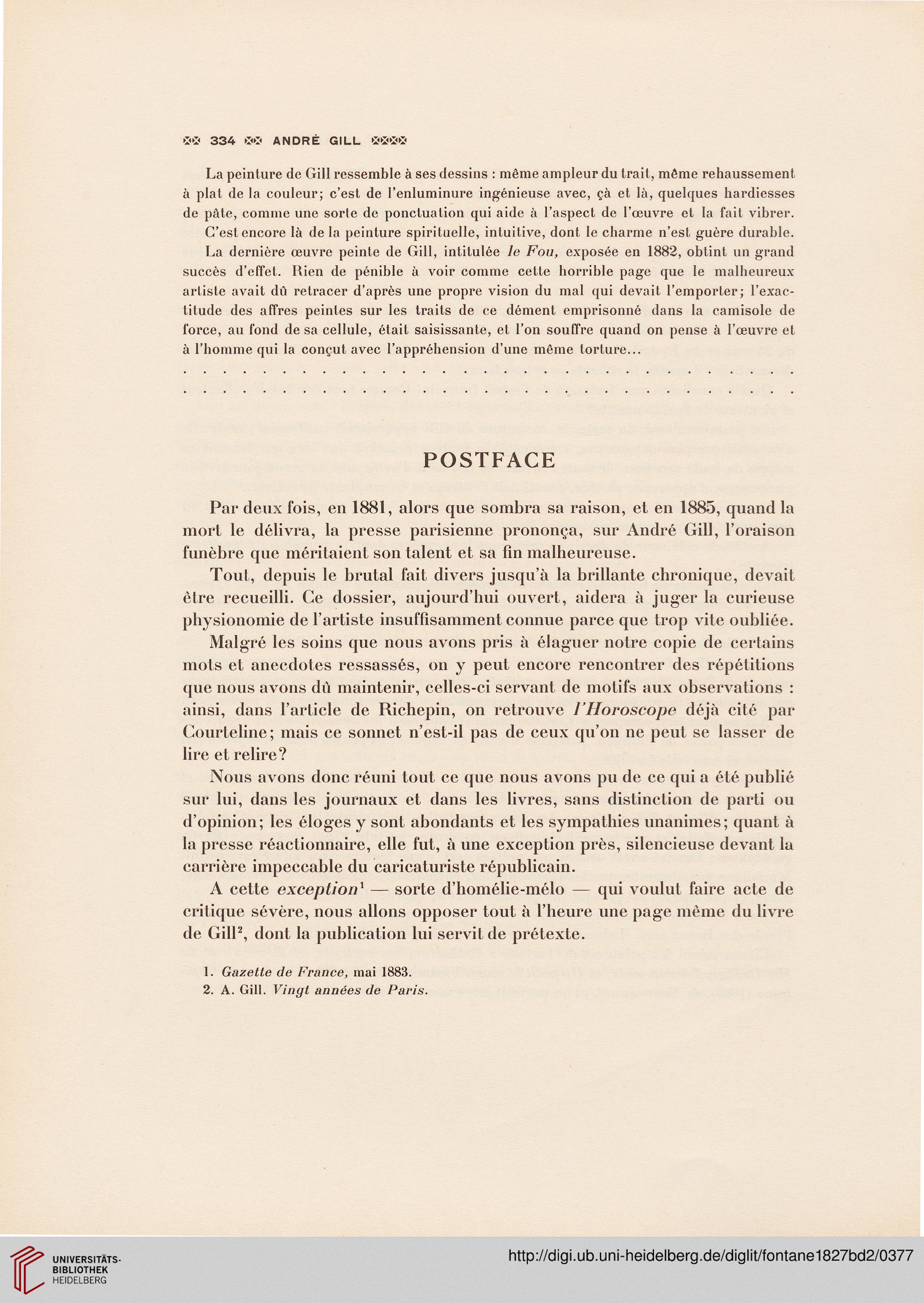** 334 ** ANDRÉ GILL ****
La peinture de Gill ressemble à ses dessins : même ampleur du trait, môme rehaussement
à plat de la couleur; c'est de l'enluminure ingénieuse avec, çà et là, quelques hardiesses
de pâte, comme une sorte de ponctuation qui aide à l'aspect de l'œuvre et la fait vibrer.
C'est encore là de la peinture spirituelle, intuitive, dont le charme n'est guère durable.
La dernière œuvre peinte de Gill, intitulée le Fou, exposée en 1882, obtint un grand
succès d'effet. Rien de pénible à voir comme cette horrible page que le malheureux
artiste avait dû retracer d'après une propre vision du mal qui devait l'emporter; l'exac-
titude des affres peintes sur les traits de ce dément emprisonné dans la camisole de
force, au fond de sa cellule, était saisissante, et l'on souffre quand on pense à l'œuvre et
à l'homme qui la conçut avec l'appréhension d'une même torture...
POSTFACE
Par deux fois, en 1881, alors que sombra sa raison, et en 1885, quand la
mort le délivra, la presse parisienne prononça, sur André Gill, l'oraison
funèbre que méritaient son talent et sa lin malheureuse.
Tout, depuis le brutal fait divers jusqu'à la brillante chronique, devait
être recueilli. Ce dossier, aujourd'hui ouvert, aidera à juger la curieuse
physionomie de l'artiste insuffisamment connue parce que trop vite oubliée.
Malgré les soins que nous avons pris à élaguer notre copie de certains
mots et anecdotes ressassés, on y peut encore rencontrer des répétitions
que nous avons dû maintenir, celles-ci servant de motifs aux observations :
ainsi, dans l'article de Richepin, on retrouve l'Horoscope déjà cité par
Courteline ; mais ce sonnet n'est-il pas de ceux qu'on ne peut se lasser de
lire et relire?
Nous avons donc réuni tout ce que nous avons pu de ce qui a été publié
sur lui, dans les journaux et dans les livres, sans distinction de parti ou
d'opinion; les éloges y sont abondants et les sympathies unanimes; quant à
la presse réactionnaire, elle fut, à une exception près, silencieuse devant la
carrière impeccable du caricaturiste républicain.
A cette exception1 — sorte d'homélie-mélo — qui voulut faire acte de
critique sévère, nous allons opposer tout à l'heure une page même du livre
de Gill2, dont la publication lui servit de prétexte.
1. Gazette de France, mai 1883.
2. A. Gill. Vingt années de Paris.
La peinture de Gill ressemble à ses dessins : même ampleur du trait, môme rehaussement
à plat de la couleur; c'est de l'enluminure ingénieuse avec, çà et là, quelques hardiesses
de pâte, comme une sorte de ponctuation qui aide à l'aspect de l'œuvre et la fait vibrer.
C'est encore là de la peinture spirituelle, intuitive, dont le charme n'est guère durable.
La dernière œuvre peinte de Gill, intitulée le Fou, exposée en 1882, obtint un grand
succès d'effet. Rien de pénible à voir comme cette horrible page que le malheureux
artiste avait dû retracer d'après une propre vision du mal qui devait l'emporter; l'exac-
titude des affres peintes sur les traits de ce dément emprisonné dans la camisole de
force, au fond de sa cellule, était saisissante, et l'on souffre quand on pense à l'œuvre et
à l'homme qui la conçut avec l'appréhension d'une même torture...
POSTFACE
Par deux fois, en 1881, alors que sombra sa raison, et en 1885, quand la
mort le délivra, la presse parisienne prononça, sur André Gill, l'oraison
funèbre que méritaient son talent et sa lin malheureuse.
Tout, depuis le brutal fait divers jusqu'à la brillante chronique, devait
être recueilli. Ce dossier, aujourd'hui ouvert, aidera à juger la curieuse
physionomie de l'artiste insuffisamment connue parce que trop vite oubliée.
Malgré les soins que nous avons pris à élaguer notre copie de certains
mots et anecdotes ressassés, on y peut encore rencontrer des répétitions
que nous avons dû maintenir, celles-ci servant de motifs aux observations :
ainsi, dans l'article de Richepin, on retrouve l'Horoscope déjà cité par
Courteline ; mais ce sonnet n'est-il pas de ceux qu'on ne peut se lasser de
lire et relire?
Nous avons donc réuni tout ce que nous avons pu de ce qui a été publié
sur lui, dans les journaux et dans les livres, sans distinction de parti ou
d'opinion; les éloges y sont abondants et les sympathies unanimes; quant à
la presse réactionnaire, elle fut, à une exception près, silencieuse devant la
carrière impeccable du caricaturiste républicain.
A cette exception1 — sorte d'homélie-mélo — qui voulut faire acte de
critique sévère, nous allons opposer tout à l'heure une page même du livre
de Gill2, dont la publication lui servit de prétexte.
1. Gazette de France, mai 1883.
2. A. Gill. Vingt années de Paris.