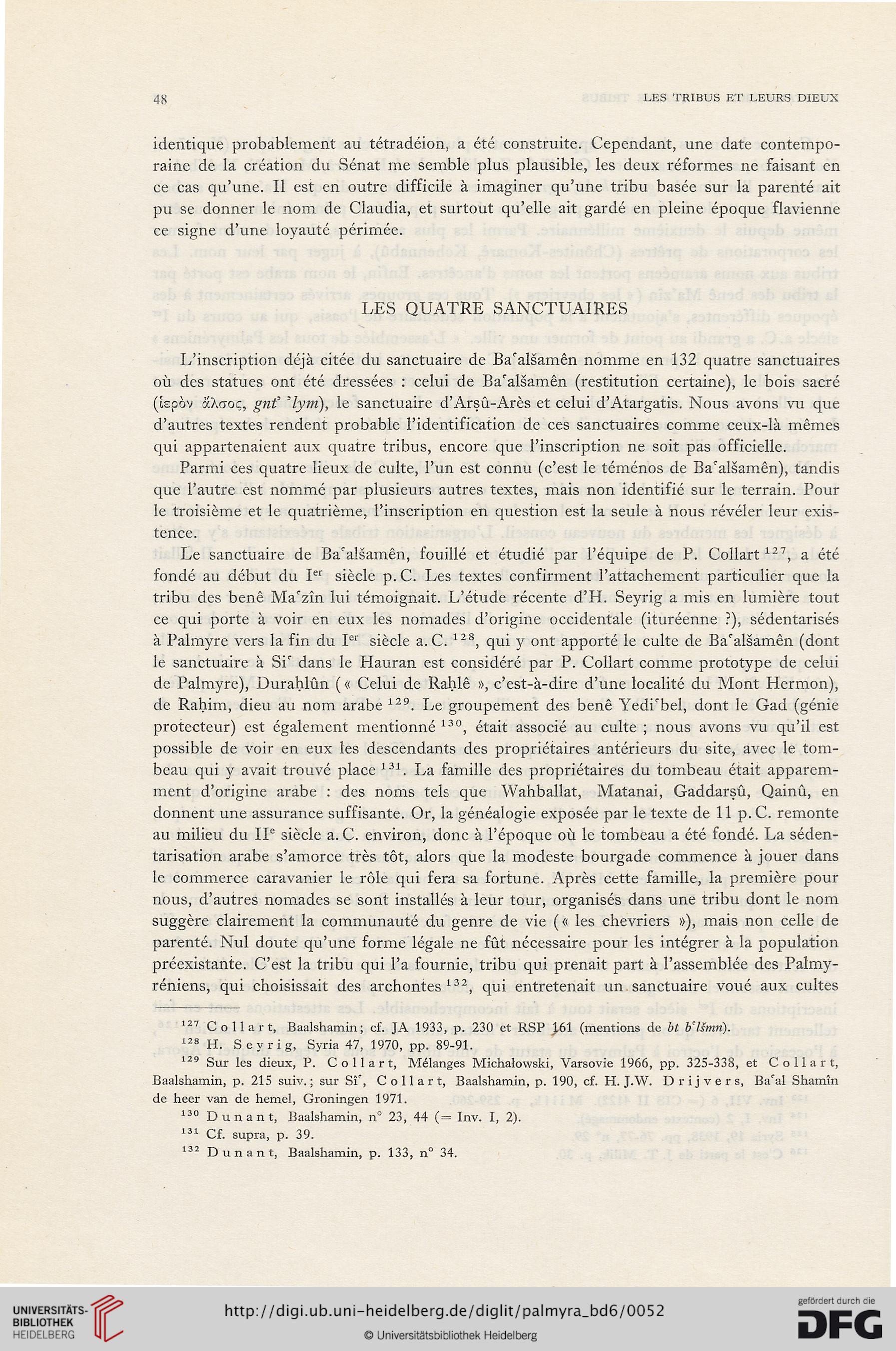48
LES TRIBUS ET LEURS DIEUX
identique probablement au tétradéion, a été construite. Cependant, une date contempo-
raine de la création du Sénat me semble plus plausible, les deux réformes ne faisant en
ce cas qu’une. Il est en outre difficile à imaginer qu’une tribu basée sur la parenté ait
pu se donner le nom de Claudia, et surtout qu’elle ait gardé en pleine époque flavienne
ce signe d’une loyauté périmée.
LES QUATRE SANCTUAIRES
L’inscription déjà citée du sanctuaire de Ba'alsamên nomme en 132 quatre sanctuaires
où des statues ont été dressées : celui de Ba'alsamên (restitution certaine), le bois sacré
(ιερόν άλσος, gnf ’lym), le sanctuaire d’Arsû-Arès et celui d’Atargatis. Nous avons vu que
d’autres textes rendent probable l’identification de ces sanctuaires comme ceux-là mêmes
qui appartenaient aux quatre tribus, encore que l’inscription ne soit pas officielle.
Parmi ces quatre lieux de culte, l’un est connu (c’est le téménos de Ba'alsamên), tandis
que l’autre est nommé par plusieurs autres textes, mais non identifié sur le terrain. Poul-
ie troisième et le quatrième, l’inscription en question est la seule à nous révéler leur exis-
tence.
Le sanctuaire de Ba'alsamên, fouillé et étudié par l’équipe de P. Collart127, a été
fondé au début du Ier siècle p. C. Les textes confirment l’attachement particulier que la
tribu des benê Ma'zîn lui témoignait. L’étude récente d’H. Seyrig a mis en lumière tout
ce qui porte à voir en eux les nomades d’origine occidentale (ituréenne ?), sédentarisés
à Palmyre vers la fin du Ier siècle a. C. 12S, qui y ont apporté le culte de Ba'alsamên (dont
le sanctuaire à SE dans le Hauran est considéré par P. Collart comme prototype de celui
de Palmyre), Durahlûn ( « Celui de Rahlê », c’est-à-dire d’une localité du Mont Hermon),
de Rahim, dieu au nom arabe 129. Le groupement des benê YedEbel, dont le Gad (génie
protecteur) est également mentionné 130, était associé au culte ; nous avons vu qu’il est
possible de voir en eux les descendants des propriétaires antérieurs du site, avec le tom-
beau qui y avait trouvé place 131. La famille des propriétaires du tombeau était apparem-
ment d’origine arabe : des noms tels que Wahballat, Matanai, Gaddarsû, Qainû, en
donnent une assurance suffisante. Or, la généalogie exposée par le texte de 11 p.C. remonte
au milieu du IIe siècle a. C. environ, donc à l’époque où le tombeau a été fondé. La séden-
tarisation arabe s’amorce très tôt, alors que la modeste bourgade commence à jouer dans
le commerce caravanier le rôle qui fera sa fortune. Après cette famille, la première pour
nous, d’autres nomades se sont installés à leur tour, organisés dans une tribu dont le nom
suggère clairement la communauté du genre de vie (« les chevriers »), mais non celle de
parenté. Nul doute qu’une forme légale ne fût nécessaire pour les intégrer à la population
préexistante. C’est la tribu qui l’a fournie, tribu qui prenait part à l’assemblée des Palmy-
réniens, qui choisissait des archontes132, qui entretenait un sanctuaire voué aux cultes
127 Collart, Baalshamin; cf. JA 1933, p. 230 et RSP J.61 (mentions de bt b’Umii).
128 H. Seyrig, Syria 47, 1970, pp. 89-91.
129 Sur les dieux, P. Collart, Mélanges Michałowski, Varsovie 1966, pp. 325-338, et Collart,
Baalshamin, p. 215 suiv. ; sur Si', Collart, Baalshamin, p. 190, cf. H. J.W. Drijvers, Ba'al Shamîn
de heer van de hemel, Groningen 1971.
130 Dunant, Baalshamin, n° 23, 44 (= Inv. I, 2).
131 Cf. supra, p. 39.
132 Dunant, Baalshamin, p. 133, n° 34.
LES TRIBUS ET LEURS DIEUX
identique probablement au tétradéion, a été construite. Cependant, une date contempo-
raine de la création du Sénat me semble plus plausible, les deux réformes ne faisant en
ce cas qu’une. Il est en outre difficile à imaginer qu’une tribu basée sur la parenté ait
pu se donner le nom de Claudia, et surtout qu’elle ait gardé en pleine époque flavienne
ce signe d’une loyauté périmée.
LES QUATRE SANCTUAIRES
L’inscription déjà citée du sanctuaire de Ba'alsamên nomme en 132 quatre sanctuaires
où des statues ont été dressées : celui de Ba'alsamên (restitution certaine), le bois sacré
(ιερόν άλσος, gnf ’lym), le sanctuaire d’Arsû-Arès et celui d’Atargatis. Nous avons vu que
d’autres textes rendent probable l’identification de ces sanctuaires comme ceux-là mêmes
qui appartenaient aux quatre tribus, encore que l’inscription ne soit pas officielle.
Parmi ces quatre lieux de culte, l’un est connu (c’est le téménos de Ba'alsamên), tandis
que l’autre est nommé par plusieurs autres textes, mais non identifié sur le terrain. Poul-
ie troisième et le quatrième, l’inscription en question est la seule à nous révéler leur exis-
tence.
Le sanctuaire de Ba'alsamên, fouillé et étudié par l’équipe de P. Collart127, a été
fondé au début du Ier siècle p. C. Les textes confirment l’attachement particulier que la
tribu des benê Ma'zîn lui témoignait. L’étude récente d’H. Seyrig a mis en lumière tout
ce qui porte à voir en eux les nomades d’origine occidentale (ituréenne ?), sédentarisés
à Palmyre vers la fin du Ier siècle a. C. 12S, qui y ont apporté le culte de Ba'alsamên (dont
le sanctuaire à SE dans le Hauran est considéré par P. Collart comme prototype de celui
de Palmyre), Durahlûn ( « Celui de Rahlê », c’est-à-dire d’une localité du Mont Hermon),
de Rahim, dieu au nom arabe 129. Le groupement des benê YedEbel, dont le Gad (génie
protecteur) est également mentionné 130, était associé au culte ; nous avons vu qu’il est
possible de voir en eux les descendants des propriétaires antérieurs du site, avec le tom-
beau qui y avait trouvé place 131. La famille des propriétaires du tombeau était apparem-
ment d’origine arabe : des noms tels que Wahballat, Matanai, Gaddarsû, Qainû, en
donnent une assurance suffisante. Or, la généalogie exposée par le texte de 11 p.C. remonte
au milieu du IIe siècle a. C. environ, donc à l’époque où le tombeau a été fondé. La séden-
tarisation arabe s’amorce très tôt, alors que la modeste bourgade commence à jouer dans
le commerce caravanier le rôle qui fera sa fortune. Après cette famille, la première pour
nous, d’autres nomades se sont installés à leur tour, organisés dans une tribu dont le nom
suggère clairement la communauté du genre de vie (« les chevriers »), mais non celle de
parenté. Nul doute qu’une forme légale ne fût nécessaire pour les intégrer à la population
préexistante. C’est la tribu qui l’a fournie, tribu qui prenait part à l’assemblée des Palmy-
réniens, qui choisissait des archontes132, qui entretenait un sanctuaire voué aux cultes
127 Collart, Baalshamin; cf. JA 1933, p. 230 et RSP J.61 (mentions de bt b’Umii).
128 H. Seyrig, Syria 47, 1970, pp. 89-91.
129 Sur les dieux, P. Collart, Mélanges Michałowski, Varsovie 1966, pp. 325-338, et Collart,
Baalshamin, p. 215 suiv. ; sur Si', Collart, Baalshamin, p. 190, cf. H. J.W. Drijvers, Ba'al Shamîn
de heer van de hemel, Groningen 1971.
130 Dunant, Baalshamin, n° 23, 44 (= Inv. I, 2).
131 Cf. supra, p. 39.
132 Dunant, Baalshamin, p. 133, n° 34.