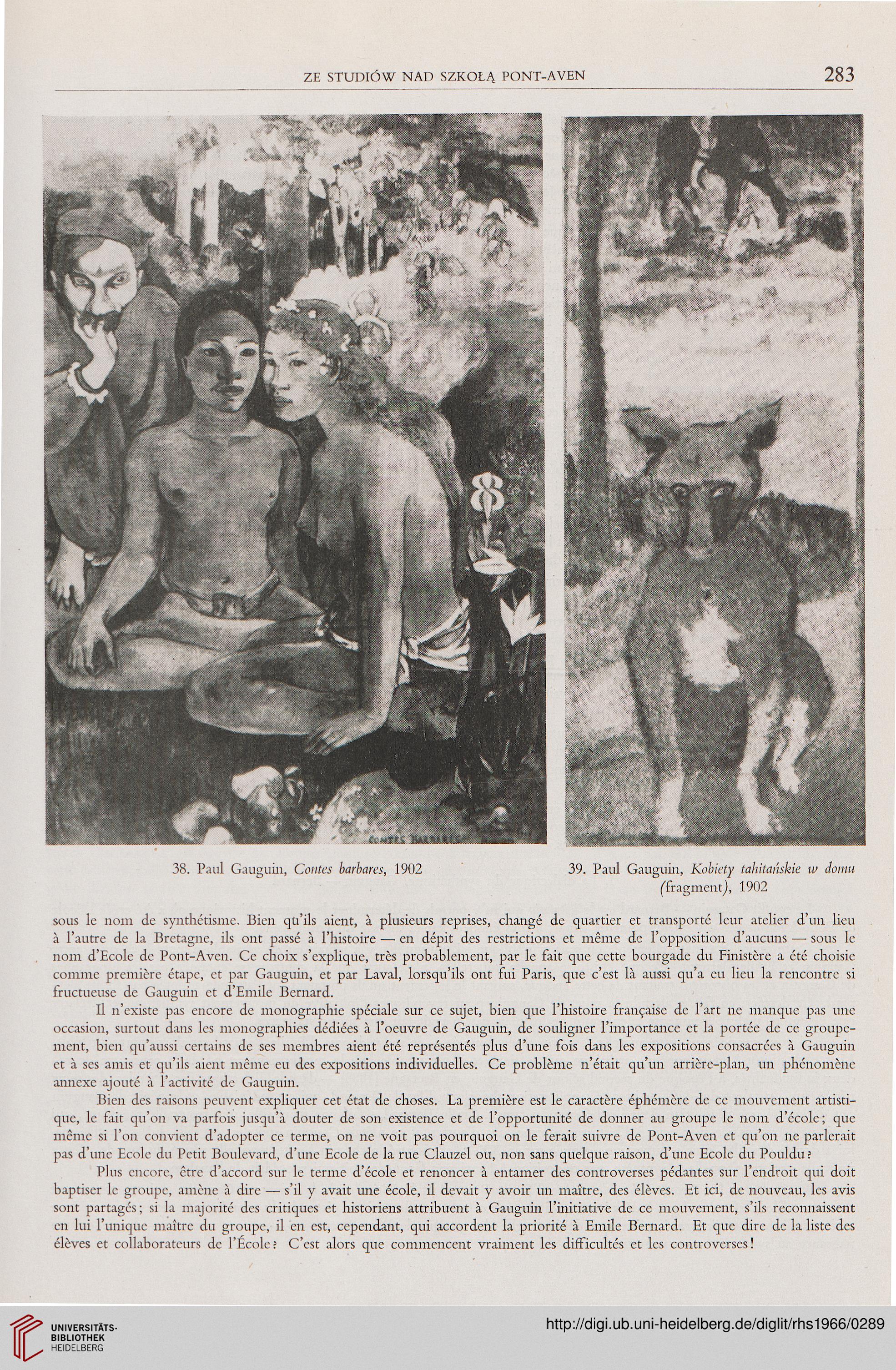ZE STUDIÓW NAD SZKOŁĄ PONT-AVEN
283
38. Paul Gauguin, Contes barbares, 1902 39. Paul Gauguin, Kobiety tahitańskie w domu
(fragment), 1902
sous le nom dc synthétdsme. Bien qu'ils aient, à plusieurs reprises, changé de quartier et transporté leur atelier d'un lieu
à l'autre de la Bretagne, ils ont passé à l'histoire —■ en dépit des restrictions et même de l'opposition d'aucuns — sous le
nom d'Ecole de Pont-Aven. Ce choix s'explique, très probablement, par le fait que cette bourgade du Finistère a été choisie
comme première étape, et par Gauguin, et par Laval, lorsqu'ils ont fui Paris, que c'est là aussi qu'a eu lieu la rencontre si
fructueuse de Gauguin et d'Emile Bernard.
Il n'existe pas encore de monographie spéciale sur ce sujet, bien que l'histoire française de l'art ne manque pas une
occasion, surtout dans les monographies dédiées à l'oeuvre de Gauguin, de souligner l'importance et la portée de ce groupe-
ment, bien qu'aussi certains de ses membres aient été représentés plus d'une fois dans les expositions consacrées à Gauguin
et à ses amis et qu'ils aient même eu des expositions individuelles. Ce problème n'était qu'un arrière-plan, un phénomène
annexe ajouté à l'activité de Gauguin.
Bien des raisons peuvent expliquer cet état de choses. La première est le caractère éphémère de ce mouvement artisti-
que, le fait qu'on va parfois jusqu'à douter de son existence et de l'opportunité de donner au groupe le nom d'école; que
même si l'on convient d'adopter ce terme, on ne voit pas pourquoi on le ferait suivre de Pont-Aven et qu'on ne parlerait
pas d'une Ecole du Petit Boulevard, d'une Ecole de la rue Clauzel ou, non sans quelque raison, d'une Ecole du Pouldu !
Plus encore, être d'accord sur le terme d'école et renoncer à entamer des controverses pédantes sur l'endroit qui doit
baptiser le groupe, amène à dire — s'il y avait une école, il devait y avoir un maître, des élèves. Et ici, de nouveau, les avis
sont partagés; si la majorité des critiques et historiens attribuent à Gauguin l'initiative de ce mouvement, s'ils reconnaissent
en lui l'unique maître du groupe, il en est, cependant, qui accordent la priorité à Emile Bernard. Et que dire de la liste des
élèves et collaborateurs de l'Ecole? C'est alors que commencent vraiment les difficultés et les controverses!
283
38. Paul Gauguin, Contes barbares, 1902 39. Paul Gauguin, Kobiety tahitańskie w domu
(fragment), 1902
sous le nom dc synthétdsme. Bien qu'ils aient, à plusieurs reprises, changé de quartier et transporté leur atelier d'un lieu
à l'autre de la Bretagne, ils ont passé à l'histoire —■ en dépit des restrictions et même de l'opposition d'aucuns — sous le
nom d'Ecole de Pont-Aven. Ce choix s'explique, très probablement, par le fait que cette bourgade du Finistère a été choisie
comme première étape, et par Gauguin, et par Laval, lorsqu'ils ont fui Paris, que c'est là aussi qu'a eu lieu la rencontre si
fructueuse de Gauguin et d'Emile Bernard.
Il n'existe pas encore de monographie spéciale sur ce sujet, bien que l'histoire française de l'art ne manque pas une
occasion, surtout dans les monographies dédiées à l'oeuvre de Gauguin, de souligner l'importance et la portée de ce groupe-
ment, bien qu'aussi certains de ses membres aient été représentés plus d'une fois dans les expositions consacrées à Gauguin
et à ses amis et qu'ils aient même eu des expositions individuelles. Ce problème n'était qu'un arrière-plan, un phénomène
annexe ajouté à l'activité de Gauguin.
Bien des raisons peuvent expliquer cet état de choses. La première est le caractère éphémère de ce mouvement artisti-
que, le fait qu'on va parfois jusqu'à douter de son existence et de l'opportunité de donner au groupe le nom d'école; que
même si l'on convient d'adopter ce terme, on ne voit pas pourquoi on le ferait suivre de Pont-Aven et qu'on ne parlerait
pas d'une Ecole du Petit Boulevard, d'une Ecole de la rue Clauzel ou, non sans quelque raison, d'une Ecole du Pouldu !
Plus encore, être d'accord sur le terme d'école et renoncer à entamer des controverses pédantes sur l'endroit qui doit
baptiser le groupe, amène à dire — s'il y avait une école, il devait y avoir un maître, des élèves. Et ici, de nouveau, les avis
sont partagés; si la majorité des critiques et historiens attribuent à Gauguin l'initiative de ce mouvement, s'ils reconnaissent
en lui l'unique maître du groupe, il en est, cependant, qui accordent la priorité à Emile Bernard. Et que dire de la liste des
élèves et collaborateurs de l'Ecole? C'est alors que commencent vraiment les difficultés et les controverses!