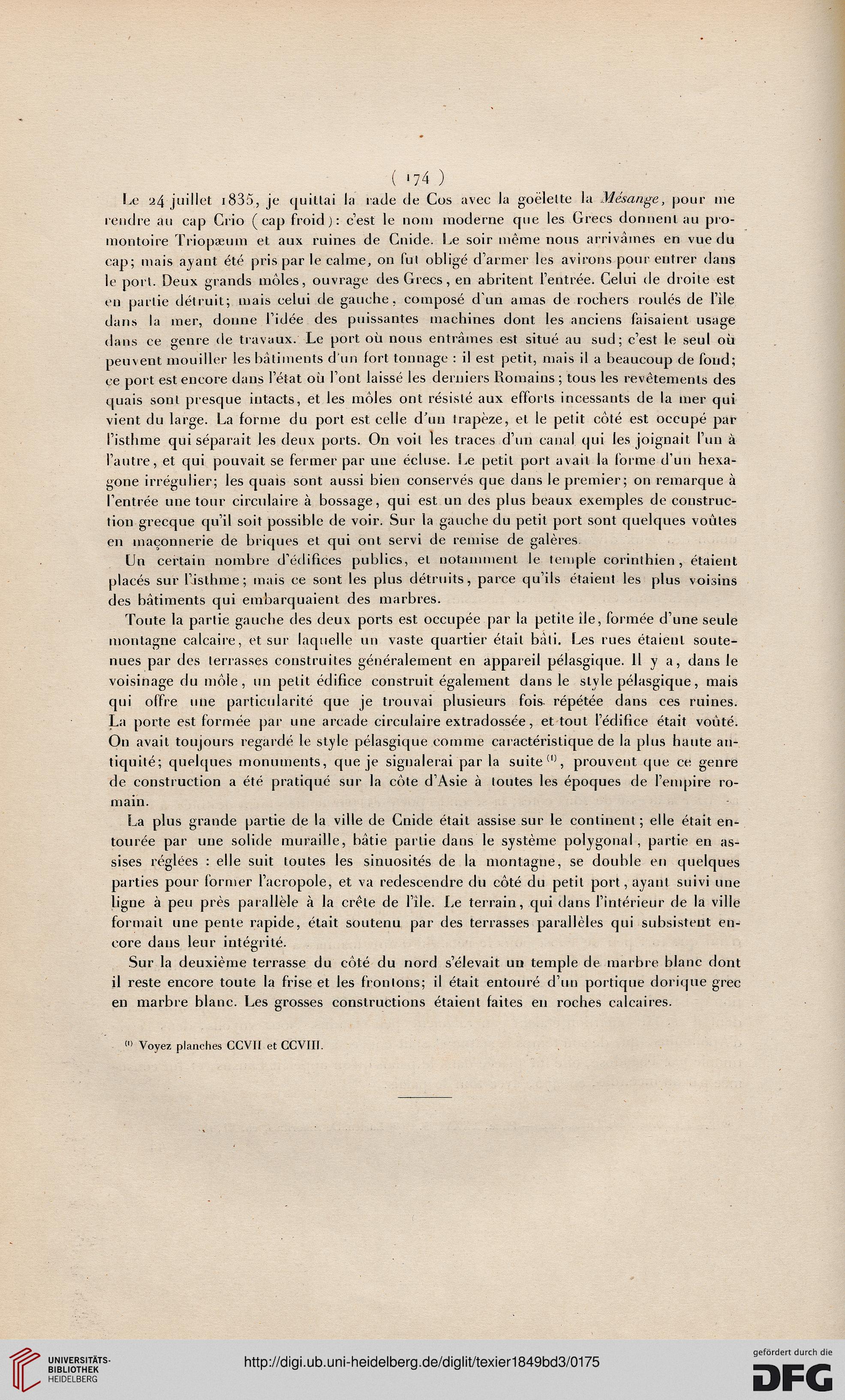'74 )
Le 24 juillet i835, je quittai la rade de Cos avec Ja goélette la Mésange, pour me
rendre au cap Grio (cap froid): c'est le nom moderne que les Grecs donnent au pro-
montoire Triopaeum et aux ruines de Guide. Le soir même nous arrivâmes en vue du
cap; mais ayant été pris par le calme, on fut obligé d'armer les avirons pour entrer dans
le port. Deux grands moles, ouvrage des Grecs, en abritent l'entrée. Celui de droite est
en partie détruit; mais celui de gauche, composé d'un amas de rochers roulés de File
dans la mer, donne l'idée des puissantes machines dont les anciens faisaient usage
dans ce genre de travaux. Le port où nous entrâmes est situé au sud; c'est le seul où
peuvent mouiller les bâtiments d'un fort tonnage : il est petit, mais il a beaucoup de fond;
ce port est encore dans l'état où Font laissé les derniers Romains ; tous les revêtements des
quais sont presque intacts, et les moles ont résisté aux efforts incessants de la mer qui
vient du large. La forme du port est celle d'un trapèze, et le petit côté est occupé par
l'isthme qui séparait les deux ports. On voit les traces d'un canal qui les joignait l'un à
l'autre, et qui pouvait se fermer par une écluse. Le petit port avait la forme d'un hexa-
gone irrégulier; les quais sont aussi bien conservés que dans le premier; on remarque à
l'entrée une tour circulaire à bossage, qui est un des plus beaux exemples de construc-
tion grecque qu'il soit possible de voir. Sur la gauche du petit port sont quelques voûtes
en maçonnerie de briques et qui ont servi de remise de galères
Un certain nombre d'édifices publics, et notamment le temple corinthien, étaient
placés sur l'isthme; mais ce sont les plus détruits, parce qu'ils étaient les plus voisins
des bâtiments qui embarquaient des marbres.
Toute la partie gauche des deux ports est occupée par la petite ile, formée d'une seule
montagne calcaire, et sur laquelle un vaste quartier était bâti. Les rues étaient soute-
nues par des terrasses construites généralement en appareil pélasgique. Il y a, dans le
voisinage du môle, un petit édifice construit également dans le style pélasgique, mais
qui offre une particularité que je trouvai plusieurs fois répétée dans ces ruines.
La porte est formée par une arcade circulaire extradossée, et tout l'édifice était voûté.
On avait toujours regardé le style pélasgique comme caractéristique de la plus haute an-
tiquité; quelques monuments, que je signalerai par la suite (1), prouvent que ce genre
de construction a été pratiqué sur la côte d'Asie à toutes les époques de l'empire ro-
main.
La plus grande partie de la ville de Gnide était assise sur le continent ; elle était en-
tourée par une solide muraille, bâtie partie dans le système polygonal , partie en as-
sises réglées : elle suit toutes les sinuosités de la montagne, se double en quelques
parties pour former l'acropole, et va redescendre du côté du petit port, ayant suivi une
ligne à peu près parallèle à la crête de l'île. Le terrain, qui dans l'intérieur de la ville
formait une pente rapide, était soutenu par des terrasses parallèles qui subsistent en-
core dans leur intégrité.
Sur la deuxième terrasse du côté du nord s'élevait un temple de marbre blanc dont
il reste encore toute la frise et les frontons; il était entouré d'un portique dorique grec
en marbre blanc. Les grosses constructions étaient faites en roches calcaires.
(t)
Voyez planches CGVIt et CCVIII.
Le 24 juillet i835, je quittai la rade de Cos avec Ja goélette la Mésange, pour me
rendre au cap Grio (cap froid): c'est le nom moderne que les Grecs donnent au pro-
montoire Triopaeum et aux ruines de Guide. Le soir même nous arrivâmes en vue du
cap; mais ayant été pris par le calme, on fut obligé d'armer les avirons pour entrer dans
le port. Deux grands moles, ouvrage des Grecs, en abritent l'entrée. Celui de droite est
en partie détruit; mais celui de gauche, composé d'un amas de rochers roulés de File
dans la mer, donne l'idée des puissantes machines dont les anciens faisaient usage
dans ce genre de travaux. Le port où nous entrâmes est situé au sud; c'est le seul où
peuvent mouiller les bâtiments d'un fort tonnage : il est petit, mais il a beaucoup de fond;
ce port est encore dans l'état où Font laissé les derniers Romains ; tous les revêtements des
quais sont presque intacts, et les moles ont résisté aux efforts incessants de la mer qui
vient du large. La forme du port est celle d'un trapèze, et le petit côté est occupé par
l'isthme qui séparait les deux ports. On voit les traces d'un canal qui les joignait l'un à
l'autre, et qui pouvait se fermer par une écluse. Le petit port avait la forme d'un hexa-
gone irrégulier; les quais sont aussi bien conservés que dans le premier; on remarque à
l'entrée une tour circulaire à bossage, qui est un des plus beaux exemples de construc-
tion grecque qu'il soit possible de voir. Sur la gauche du petit port sont quelques voûtes
en maçonnerie de briques et qui ont servi de remise de galères
Un certain nombre d'édifices publics, et notamment le temple corinthien, étaient
placés sur l'isthme; mais ce sont les plus détruits, parce qu'ils étaient les plus voisins
des bâtiments qui embarquaient des marbres.
Toute la partie gauche des deux ports est occupée par la petite ile, formée d'une seule
montagne calcaire, et sur laquelle un vaste quartier était bâti. Les rues étaient soute-
nues par des terrasses construites généralement en appareil pélasgique. Il y a, dans le
voisinage du môle, un petit édifice construit également dans le style pélasgique, mais
qui offre une particularité que je trouvai plusieurs fois répétée dans ces ruines.
La porte est formée par une arcade circulaire extradossée, et tout l'édifice était voûté.
On avait toujours regardé le style pélasgique comme caractéristique de la plus haute an-
tiquité; quelques monuments, que je signalerai par la suite (1), prouvent que ce genre
de construction a été pratiqué sur la côte d'Asie à toutes les époques de l'empire ro-
main.
La plus grande partie de la ville de Gnide était assise sur le continent ; elle était en-
tourée par une solide muraille, bâtie partie dans le système polygonal , partie en as-
sises réglées : elle suit toutes les sinuosités de la montagne, se double en quelques
parties pour former l'acropole, et va redescendre du côté du petit port, ayant suivi une
ligne à peu près parallèle à la crête de l'île. Le terrain, qui dans l'intérieur de la ville
formait une pente rapide, était soutenu par des terrasses parallèles qui subsistent en-
core dans leur intégrité.
Sur la deuxième terrasse du côté du nord s'élevait un temple de marbre blanc dont
il reste encore toute la frise et les frontons; il était entouré d'un portique dorique grec
en marbre blanc. Les grosses constructions étaient faites en roches calcaires.
(t)
Voyez planches CGVIt et CCVIII.