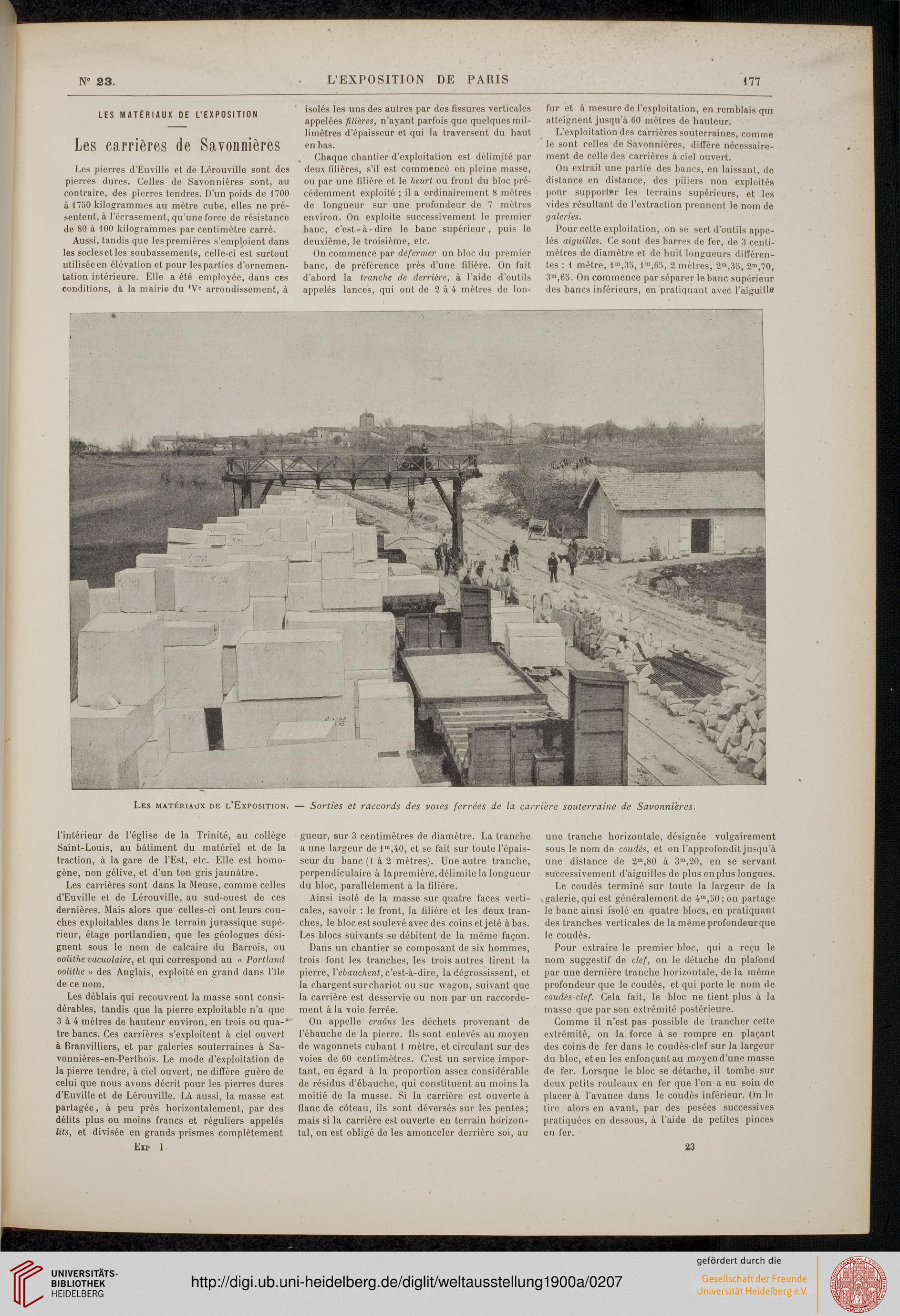N" 23.
L'EXPOSITION DE PARIS
177
LES MATÉRIAUX DE L'EXPOSITION
Les carrières de Savonnières
Les pierres d'Euville et de Lérouville sont des
pierres dures. Celles de Savonnières sont, au
contraire, des pierres tendres. D'un poids de 1700
à 1750 kilogrammes au mètre cube, elles ne pré-
sentent, à l'écrasement, qu'une force de résistance
de 80 à 100 kilogrammes par centimètre carré.
Aussi, tandis que les premières s'emploient dans
les soclesetles soubassements, celle-ci est surtout
utilisée en élévation et pour lesparties d'ornemen-
tation intérieure. Elle a été employée, dans ces
conditions, à la mairie du 'Ve arrondissement, à
isolés les uns des autres par des fissures verticales
appelées filières, n'ayant parfois que quelques mil-
limètres d'épaisseur et qui la traversent du haut
en bas.
Chaque chantier d'exploitation est délimité par
deux filières, s'il est commencé en pleine masse,
ou par une filière et le heurt ou front du bloc pré-
cédemment exploité ; il a ordinairement H mètres
de longueur sur une profondeur de 7 mètres
environ. On exploite successivement le premier
banc, c'est-à-dire le banc supérieur, puis le
deuxième, le troisième, etc.
On commence par défermer un bloc du premier
banc, de préférence près d'une filière. On fait
d'abord la tranche de derrière, à l'aide d'outils
appelés lances, qui ont de 2 à 4 mètres de lon-
fur et à mesure de l'exploitation, en remblais qui
atteignent jusqu'à 60 mètres de hauteur.
L'exploitation des carrières souterraines, comme
le sont celles de Savonnières, diffère nécessaire-
ment de celle des carrières à ciel ouvert.
On extrait une partie des bancs, en laissant, de
distance en distance, des piliers non exploités
pour supporter les terrains supérieurs, et les
vides résultant de l'extraction prennent le nom de
galeries.
Pour cette exploitation, on se sert d'outils appe-
lés aiguilles. Ce sont des barres de fer, de 3 centi-
mètres de diamètre et de huit longueurs différen-
tes : 1 mètre, lm,35, im,6S, 2 mètres, 2m,35, 2m,70,
3m,65. On commence par séparer le banc supérieur
des bancs inférieurs, en pratiquant avec l'aiguilla
Les matériaux de l'Exposition. — Sorties et raccords des voies ferrées de la carrière souterraine de Savonnières.
l'intérieur de l'église de la Trinité, au collège
Saint-Louis, au bâtiment du matériel et de la
traction, à la gare de l'Est, etc. Elle est homo-
gène, non gélive, et d'un ton gris jaunâtre.
Les carrières sont dans la Meuse, comme celles
d'Euville et de Lérouville, au sud-ouest de ces
dernières. Mais alors que celles-ci ont leurs cou-
ches exploitables dans le terrain jurassique supé-
rieur, étage portlandien, que les géologues dési-
gnent sous le nom de calcaire du Barrois, ou
oolithe vacuolaire, et qui correspond au « Portland
oolithe » des Anglais, exploité en grand dans l'Ile
de ce nom.
Les déblais qui recouvrent la masse sont consi-
dérables, tandis que la pierre exploitable n'a que
3 à 4 mètres de hauteur environ, en trois ou qua-'
tre bancs. Ces carrières s'exploitent à ciel ouvert
à Branvilliers, et par galeries souterraines à Sa-
vonnières-en-Perthois. Le mode d'exploitation de
la pierre tendre, à ciel ouvert, ne diffère guère de
celui que nous avons décrit pour les pierres dures
d'Euville et de Lérouville. Là aussi, la masse est
partagée, à peu près horizontalement, par des
délits plus ou moins francs et réguliers appelés
lits, et divisée en grands prismes complètement
Exr 1
gueur, sur 3 centimètres de diamètre. La tranche
a une largeur de lm,40, et se fait sur toute l'épais-
seur du banc (I à 2 mètres). Une autre tranche,
perpendiculaire à lapremière, délimite la longueur
du bloc, parallèlement à la filière.
Ainsi isolé de la masse sur quatre faces verti-
cales, savoir : le front, la filière et les deux tran-
ches, le bloc est soulevé avec des coins et jeté à bas.
Les blocs suivants se débitent de la même façon.
Dans un chantier se composant de six hommes,
trois font les tranches, les trois autres tirent la
pierre, Vébauchent, c'est-à-dire, la dégrossissent, et
la chargent sur chariot ou sur wagon, suivant que
la carrière est desservie ou non par un raccorde-
ment à la voie ferrée.
On appelle craôns les déchets provenant de
l'ébauche de la pierre. Ils sont enlevés au moyen
de wagonnets cubant 1 mètre, et circulant sur des
voies de 60 centimètres. C'est un service impor-
tant, eu égard à la proportion assez considérable
de résidus d'ébauche, qui constituent au moins la
moitié de la masse. Si la carrière est ouverte à
flanc de coteau, ils sont déversés sur les pentes;
mais si la carrière est ouverte en terrain horizon-
tal, on est obligé de les amonceler derrière soi, au
une tranche horizontale, désignée vulgairement
sous le nom de coudés, et on l'approfondit jusqu'à
une distance de 2m,80 à 3m,20, en se servant
successivement d'aiguilles de plus en plus longues.
Le coudés terminé sur toute la largeur de la
.galerie, qui est généralement de 4m,S0;on partage
le banc ainsi isolé en quatre blocs, en pratiquant
des tranches verticales de lamêmeprofondeurque
le coudés.
Pour extraire le premier bloc, qui a reçu le
nom suggestif de clef, on le détache du plafond
par une dernière tranche horizontale, de la même
profondeur que le coudés, et qui porte le nom de
coudés-clef. Cela fait, le bloc ne tient plus à la
masse que par son extrémité postérieure.
Comme il n'est pas possible de trancher cette
extrémité, on la force à se rompre en plaçant
des coins de fer dans le coudès-clef sur la largeur
du bloc, et en les enfonçant au moyend'une masse
de fer. Lorsque le bloc se détache, il tombe sur
deux petits rouleaux en fer que l'on a eu soin de
placer à l'avance dans le coudés inférieur. On le
tire alors en avant, par des pesées successives
pratiquées en dessous, à l'aide de petites pinces
en fer.
23
L'EXPOSITION DE PARIS
177
LES MATÉRIAUX DE L'EXPOSITION
Les carrières de Savonnières
Les pierres d'Euville et de Lérouville sont des
pierres dures. Celles de Savonnières sont, au
contraire, des pierres tendres. D'un poids de 1700
à 1750 kilogrammes au mètre cube, elles ne pré-
sentent, à l'écrasement, qu'une force de résistance
de 80 à 100 kilogrammes par centimètre carré.
Aussi, tandis que les premières s'emploient dans
les soclesetles soubassements, celle-ci est surtout
utilisée en élévation et pour lesparties d'ornemen-
tation intérieure. Elle a été employée, dans ces
conditions, à la mairie du 'Ve arrondissement, à
isolés les uns des autres par des fissures verticales
appelées filières, n'ayant parfois que quelques mil-
limètres d'épaisseur et qui la traversent du haut
en bas.
Chaque chantier d'exploitation est délimité par
deux filières, s'il est commencé en pleine masse,
ou par une filière et le heurt ou front du bloc pré-
cédemment exploité ; il a ordinairement H mètres
de longueur sur une profondeur de 7 mètres
environ. On exploite successivement le premier
banc, c'est-à-dire le banc supérieur, puis le
deuxième, le troisième, etc.
On commence par défermer un bloc du premier
banc, de préférence près d'une filière. On fait
d'abord la tranche de derrière, à l'aide d'outils
appelés lances, qui ont de 2 à 4 mètres de lon-
fur et à mesure de l'exploitation, en remblais qui
atteignent jusqu'à 60 mètres de hauteur.
L'exploitation des carrières souterraines, comme
le sont celles de Savonnières, diffère nécessaire-
ment de celle des carrières à ciel ouvert.
On extrait une partie des bancs, en laissant, de
distance en distance, des piliers non exploités
pour supporter les terrains supérieurs, et les
vides résultant de l'extraction prennent le nom de
galeries.
Pour cette exploitation, on se sert d'outils appe-
lés aiguilles. Ce sont des barres de fer, de 3 centi-
mètres de diamètre et de huit longueurs différen-
tes : 1 mètre, lm,35, im,6S, 2 mètres, 2m,35, 2m,70,
3m,65. On commence par séparer le banc supérieur
des bancs inférieurs, en pratiquant avec l'aiguilla
Les matériaux de l'Exposition. — Sorties et raccords des voies ferrées de la carrière souterraine de Savonnières.
l'intérieur de l'église de la Trinité, au collège
Saint-Louis, au bâtiment du matériel et de la
traction, à la gare de l'Est, etc. Elle est homo-
gène, non gélive, et d'un ton gris jaunâtre.
Les carrières sont dans la Meuse, comme celles
d'Euville et de Lérouville, au sud-ouest de ces
dernières. Mais alors que celles-ci ont leurs cou-
ches exploitables dans le terrain jurassique supé-
rieur, étage portlandien, que les géologues dési-
gnent sous le nom de calcaire du Barrois, ou
oolithe vacuolaire, et qui correspond au « Portland
oolithe » des Anglais, exploité en grand dans l'Ile
de ce nom.
Les déblais qui recouvrent la masse sont consi-
dérables, tandis que la pierre exploitable n'a que
3 à 4 mètres de hauteur environ, en trois ou qua-'
tre bancs. Ces carrières s'exploitent à ciel ouvert
à Branvilliers, et par galeries souterraines à Sa-
vonnières-en-Perthois. Le mode d'exploitation de
la pierre tendre, à ciel ouvert, ne diffère guère de
celui que nous avons décrit pour les pierres dures
d'Euville et de Lérouville. Là aussi, la masse est
partagée, à peu près horizontalement, par des
délits plus ou moins francs et réguliers appelés
lits, et divisée en grands prismes complètement
Exr 1
gueur, sur 3 centimètres de diamètre. La tranche
a une largeur de lm,40, et se fait sur toute l'épais-
seur du banc (I à 2 mètres). Une autre tranche,
perpendiculaire à lapremière, délimite la longueur
du bloc, parallèlement à la filière.
Ainsi isolé de la masse sur quatre faces verti-
cales, savoir : le front, la filière et les deux tran-
ches, le bloc est soulevé avec des coins et jeté à bas.
Les blocs suivants se débitent de la même façon.
Dans un chantier se composant de six hommes,
trois font les tranches, les trois autres tirent la
pierre, Vébauchent, c'est-à-dire, la dégrossissent, et
la chargent sur chariot ou sur wagon, suivant que
la carrière est desservie ou non par un raccorde-
ment à la voie ferrée.
On appelle craôns les déchets provenant de
l'ébauche de la pierre. Ils sont enlevés au moyen
de wagonnets cubant 1 mètre, et circulant sur des
voies de 60 centimètres. C'est un service impor-
tant, eu égard à la proportion assez considérable
de résidus d'ébauche, qui constituent au moins la
moitié de la masse. Si la carrière est ouverte à
flanc de coteau, ils sont déversés sur les pentes;
mais si la carrière est ouverte en terrain horizon-
tal, on est obligé de les amonceler derrière soi, au
une tranche horizontale, désignée vulgairement
sous le nom de coudés, et on l'approfondit jusqu'à
une distance de 2m,80 à 3m,20, en se servant
successivement d'aiguilles de plus en plus longues.
Le coudés terminé sur toute la largeur de la
.galerie, qui est généralement de 4m,S0;on partage
le banc ainsi isolé en quatre blocs, en pratiquant
des tranches verticales de lamêmeprofondeurque
le coudés.
Pour extraire le premier bloc, qui a reçu le
nom suggestif de clef, on le détache du plafond
par une dernière tranche horizontale, de la même
profondeur que le coudés, et qui porte le nom de
coudés-clef. Cela fait, le bloc ne tient plus à la
masse que par son extrémité postérieure.
Comme il n'est pas possible de trancher cette
extrémité, on la force à se rompre en plaçant
des coins de fer dans le coudès-clef sur la largeur
du bloc, et en les enfonçant au moyend'une masse
de fer. Lorsque le bloc se détache, il tombe sur
deux petits rouleaux en fer que l'on a eu soin de
placer à l'avance dans le coudés inférieur. On le
tire alors en avant, par des pesées successives
pratiquées en dessous, à l'aide de petites pinces
en fer.
23