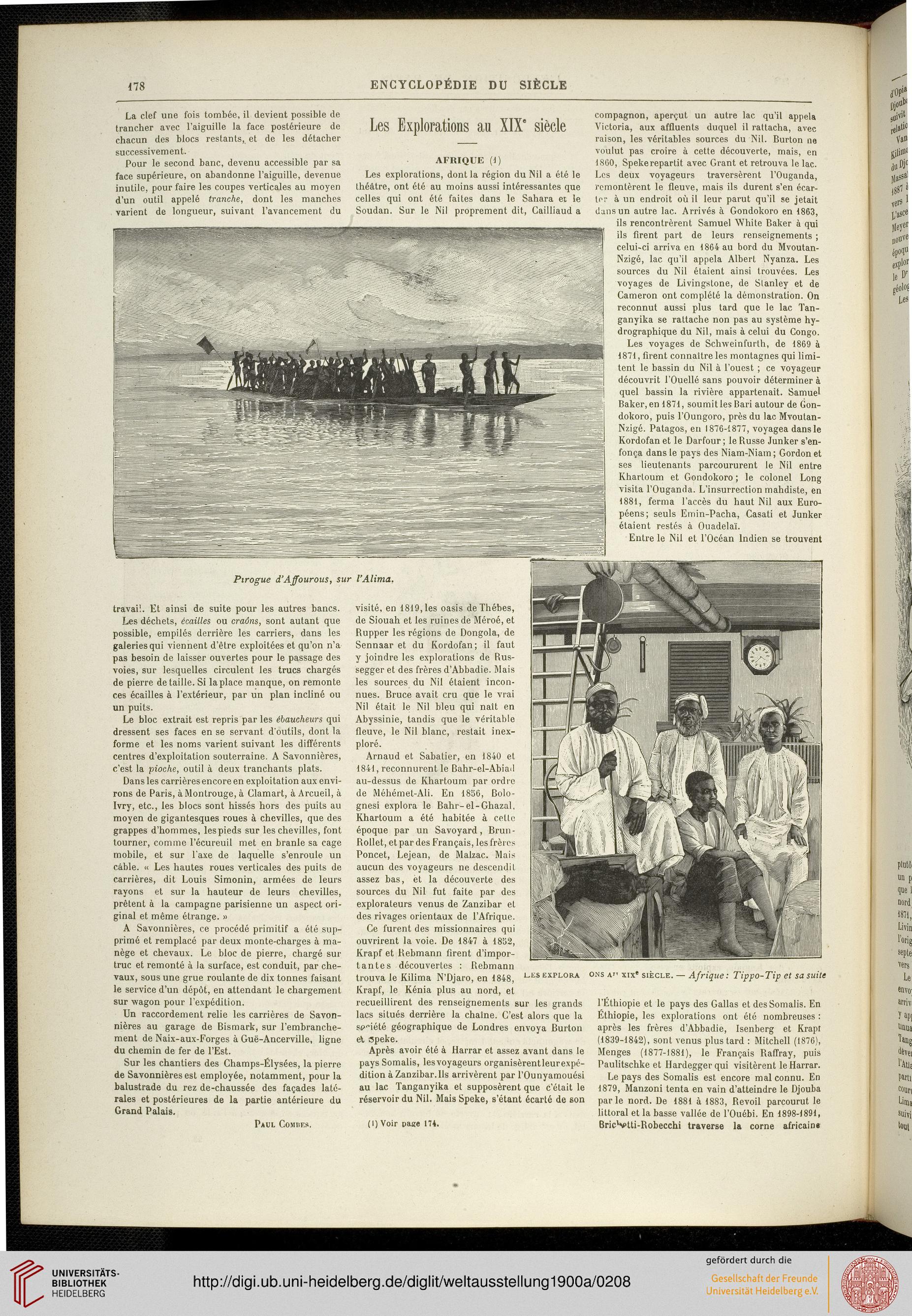178
ENCYCLOPÉDIE DU SIÈCLE
La clef une fois tombée, il devient possible de
trancher avec l'aiguille la face postérieure de
chacun des blocs restants, et de les détacher
successivement.
Pour le second banc, devenu accessible par sa
face supérieure, on abandonne l'aiguille, devenue
inutile, pour faire les coupes verticales au moyen
d'un outil appelé tranche, dont les manches
varient de longueur, suivant l'avancement du
Les Explorations au XIXe siècle
AFRIQUE (d)
Les explorations, dont la région du Nil a été le
théâtre, ont été au moins aussi intéressantes que
celles qui ont été faites dans le Sahara et le
Soudan. Sur le Nil proprement dit, Cailliaud a
compagnon, aperçut un autre lac qu'il appela
Victoria, aux affluents duquel il rattacha, avec
raison, les véritables sources du Nil. Burton ne
voulut pas croire à cette découverte, mais, en
1860, Spekerepartit avec Grant et retrouva le lac.
Les deux voyageurs traversèrent l'Ouganda,
remontèrent le fleuve, mais ils durent s'en écar-
ter à un endroit où il leur parut qu'il se jetait
dans un autre lac. Arrivés à Gondokoro en 1863,
ils rencontrèrent Samuel White Baker à qui
ils firent part de leurs renseignements ;
celui-ci arriva en 1864 au bord du Mvoutan-
Nzigé, lac qu'il appela Albert Nyanza. Les
sources du Nil étaient ainsi trouvées. Les
voyages de Livingstone, de Stanley et de
Cameron ont complété la démonstration. On
reconnut aussi plus tard que le lac Tan-
ganyika se rattache non pas au système hy-
drographique du Nil, mais à celui du Congo.
Les voyages de Schweinfurth, de 1869 à
1871, firent connaître les montagnes qui limi-
tent le bassin du Nil à l'ouest ; ce voyageur
découvrit l'Ouellé sans pouvoir déterminer à
quel bassin la rivière appartenait. Samuel
Baker, en 1871, soumit les Bari autour de Gon-
dokoro, puis l'Oungoro, près du lac Mvoutan-
Nzigé. Patagos, en 1876-1877, voyagea dans le
Kordofan et le Darfour ; le Russe Junker s'en-
fonça dans le pays des Niam-Niam ; Gordon et
ses lieutenants parcoururent le Nil entre
Kharloum et Gondokoro ; le colonel Long
visita l'Ouganda. L'insurrection mahdiste, en
1881, ferma l'accès du haut Nil aux Euro-
péens; seuls Emin-Pacha, Casati et Junker
étaient restés à Ouadelaï.
Entre le Nil et l'Océan Indien se trouvent
Pirogue d'Affourous, sur l'Alima.
travail. Et ainsi de suite pour les autres bancs.
Les déchets, écailles ou craôns, sont autant que
possible, empilés derrière les carriers, dans les
galeries qui viennent d'être exploitées et qu'on n'a
pas besoin de laisser ouvertes pour le passage des
voies, sur lesquelles circulent les trucs chargés
de pierre de taille. Si la place manque, on remonte
ces écailles à l'extérieur, par un plan incliné ou
un puits.
Le bloc extrait est repris par les ébaucheurs qui
dressent ses faces en se servant d'outils, dont la
forme et les noms varient suivant les différents
centres d'exploitation souterraine. A Savonnières,
c'est la pioche, outil à deux tranchants plats.
Dans les carrières encore en exploitation aux envi-
rons de Paris, à Montrouge, à Clamart, à Arcueil, à
Ivry, etc., les blocs sont hissés hors des puits au
moyen de gigantesques roues à chevilles, que des
grappes d'hommes, lespieds sur les chevilles, font
tourner, comme l'écureuil met en branle sa cage
mobile, et sur l'axe de laquelle s'enroule un
câble. « Les hautes roues verticales des puits de
carrières, dit Louis Simonin, armées de leurs
rayons et sur la hauteur de leurs chevilles,
prêtent à la campagne parisienne un aspect ori-
ginal et même étrange. »
A Savonnières, ce procédé primitif a été sup-
primé et remplacé par deux monte-charges à ma-
nège et chevaux. Le bloc de pierre, chargé sur
truc et remonté à la surface, est conduit, par che-
vaux, sous une grue roulante de dix tonnes faisant
le service d'un dépôt, en attendant le chargement
sur wagon pour l'expédition.
Un raccordement relie les carrières de Savon-
nières au garage de Bismark, sur l'embranche-
ment de Naix-aux-Forges à Guë-Ancerville, ligne
du chemin de fer de l'Est.
Sur les chantiers des Champs-Elysées, la pierre
de Savonnières est employée, notamment, pour la
balustrade du rez de-chaussée des façades laté-
rales et postérieures de la partie antérieure du
Grand Palais.
Paul Comw.s.
visité, en 1819, les oasis deThébes,
de Siouah et les ruines de Méroé, et
Rupper les régions de Dongola, de
Sennaar et du Kordofan; il faut
y joindre les explorations de Rus-
segger et des frères d'Abbadie. Mais
les sources du Nil étaient incon-
nues. Bruce avait cru que le vrai
Nil était le Nil bleu qui naît en
Abyssinie, tandis que le véritable
fleuve, le Nil blanc, restait inex-
ploré.
Arnaud et Sabatier, en 1840 et
1841, reconnurent le Bahr-el-Abiad
au-dessus de Khartoum par ordre
de Méhémet-Ali. En 1856, Bolo-
gnesi explora le Bahr-el-Ghazal,
Khartoum a été habitée à celte
époque par un Savoyard, Brun -
Rollet, et par des Français, les frères
Poncet, Lejean, de Malzac. Mais
aucun des voyageurs ne descendit
assez bas, et la découverte des
sources du Nil fut faite par des
explorateurs venus de Zanzibar et
des rivages orientaux de l'Afrique.
Ce furent des missionnaires qui
ouvrirent la voie. De 1847 à 1882,
Krapf et Rebmann firent d'impor-
tante s découvertes : Rebmann
trouva le Kilima N'Djaro, en 1848,
Krapf, le Kénia plus au nord, et
recueillirent des renseignements sur les grands
lacs situés derrière la chaîne. C'est alors que la
s<?"iété géographique de Londres envoya Burton
et speke.
Après avoir été à Harrar et assez avant dans le
paysSomalis, lesvoyageurs organisèrentleurexpé-
dition à Zanzibar. Ils arrivèrent par l'Ounyamouési
au lac Tanganyika et supposèrent que c'était le
réservoir du Nil. Mais Speke, s'étant écarté de son
(I) Voir page 174.
les explora ons a" xix* siècle. — Afrique : Tippo-Tip et sa suite
l'Ethiopie et le pays des Gallas et desSomalis. En
Ethiopie, les explorations ont été nombreuses :
après les frères d'Abbadie, Isenberg et Krapt
(1839-1842), sont venus plus tard : Mitchell (1876),
Menges (1877-1881), le Français Raffray, puis
Paulitschke et Hardeggerqui visitèrent le Harrar.
Le pays des Somalis est encore mal connu. En
1879, Manzoni tenta en vain d'atteindre le Djouba
parle nord. De 1881 à 1883, Revoil parcourut le
littoral et la basse vallée de l'Ouébi. En 1898-1891,
BricVtti-Robecchi traverse la corne africains
ENCYCLOPÉDIE DU SIÈCLE
La clef une fois tombée, il devient possible de
trancher avec l'aiguille la face postérieure de
chacun des blocs restants, et de les détacher
successivement.
Pour le second banc, devenu accessible par sa
face supérieure, on abandonne l'aiguille, devenue
inutile, pour faire les coupes verticales au moyen
d'un outil appelé tranche, dont les manches
varient de longueur, suivant l'avancement du
Les Explorations au XIXe siècle
AFRIQUE (d)
Les explorations, dont la région du Nil a été le
théâtre, ont été au moins aussi intéressantes que
celles qui ont été faites dans le Sahara et le
Soudan. Sur le Nil proprement dit, Cailliaud a
compagnon, aperçut un autre lac qu'il appela
Victoria, aux affluents duquel il rattacha, avec
raison, les véritables sources du Nil. Burton ne
voulut pas croire à cette découverte, mais, en
1860, Spekerepartit avec Grant et retrouva le lac.
Les deux voyageurs traversèrent l'Ouganda,
remontèrent le fleuve, mais ils durent s'en écar-
ter à un endroit où il leur parut qu'il se jetait
dans un autre lac. Arrivés à Gondokoro en 1863,
ils rencontrèrent Samuel White Baker à qui
ils firent part de leurs renseignements ;
celui-ci arriva en 1864 au bord du Mvoutan-
Nzigé, lac qu'il appela Albert Nyanza. Les
sources du Nil étaient ainsi trouvées. Les
voyages de Livingstone, de Stanley et de
Cameron ont complété la démonstration. On
reconnut aussi plus tard que le lac Tan-
ganyika se rattache non pas au système hy-
drographique du Nil, mais à celui du Congo.
Les voyages de Schweinfurth, de 1869 à
1871, firent connaître les montagnes qui limi-
tent le bassin du Nil à l'ouest ; ce voyageur
découvrit l'Ouellé sans pouvoir déterminer à
quel bassin la rivière appartenait. Samuel
Baker, en 1871, soumit les Bari autour de Gon-
dokoro, puis l'Oungoro, près du lac Mvoutan-
Nzigé. Patagos, en 1876-1877, voyagea dans le
Kordofan et le Darfour ; le Russe Junker s'en-
fonça dans le pays des Niam-Niam ; Gordon et
ses lieutenants parcoururent le Nil entre
Kharloum et Gondokoro ; le colonel Long
visita l'Ouganda. L'insurrection mahdiste, en
1881, ferma l'accès du haut Nil aux Euro-
péens; seuls Emin-Pacha, Casati et Junker
étaient restés à Ouadelaï.
Entre le Nil et l'Océan Indien se trouvent
Pirogue d'Affourous, sur l'Alima.
travail. Et ainsi de suite pour les autres bancs.
Les déchets, écailles ou craôns, sont autant que
possible, empilés derrière les carriers, dans les
galeries qui viennent d'être exploitées et qu'on n'a
pas besoin de laisser ouvertes pour le passage des
voies, sur lesquelles circulent les trucs chargés
de pierre de taille. Si la place manque, on remonte
ces écailles à l'extérieur, par un plan incliné ou
un puits.
Le bloc extrait est repris par les ébaucheurs qui
dressent ses faces en se servant d'outils, dont la
forme et les noms varient suivant les différents
centres d'exploitation souterraine. A Savonnières,
c'est la pioche, outil à deux tranchants plats.
Dans les carrières encore en exploitation aux envi-
rons de Paris, à Montrouge, à Clamart, à Arcueil, à
Ivry, etc., les blocs sont hissés hors des puits au
moyen de gigantesques roues à chevilles, que des
grappes d'hommes, lespieds sur les chevilles, font
tourner, comme l'écureuil met en branle sa cage
mobile, et sur l'axe de laquelle s'enroule un
câble. « Les hautes roues verticales des puits de
carrières, dit Louis Simonin, armées de leurs
rayons et sur la hauteur de leurs chevilles,
prêtent à la campagne parisienne un aspect ori-
ginal et même étrange. »
A Savonnières, ce procédé primitif a été sup-
primé et remplacé par deux monte-charges à ma-
nège et chevaux. Le bloc de pierre, chargé sur
truc et remonté à la surface, est conduit, par che-
vaux, sous une grue roulante de dix tonnes faisant
le service d'un dépôt, en attendant le chargement
sur wagon pour l'expédition.
Un raccordement relie les carrières de Savon-
nières au garage de Bismark, sur l'embranche-
ment de Naix-aux-Forges à Guë-Ancerville, ligne
du chemin de fer de l'Est.
Sur les chantiers des Champs-Elysées, la pierre
de Savonnières est employée, notamment, pour la
balustrade du rez de-chaussée des façades laté-
rales et postérieures de la partie antérieure du
Grand Palais.
Paul Comw.s.
visité, en 1819, les oasis deThébes,
de Siouah et les ruines de Méroé, et
Rupper les régions de Dongola, de
Sennaar et du Kordofan; il faut
y joindre les explorations de Rus-
segger et des frères d'Abbadie. Mais
les sources du Nil étaient incon-
nues. Bruce avait cru que le vrai
Nil était le Nil bleu qui naît en
Abyssinie, tandis que le véritable
fleuve, le Nil blanc, restait inex-
ploré.
Arnaud et Sabatier, en 1840 et
1841, reconnurent le Bahr-el-Abiad
au-dessus de Khartoum par ordre
de Méhémet-Ali. En 1856, Bolo-
gnesi explora le Bahr-el-Ghazal,
Khartoum a été habitée à celte
époque par un Savoyard, Brun -
Rollet, et par des Français, les frères
Poncet, Lejean, de Malzac. Mais
aucun des voyageurs ne descendit
assez bas, et la découverte des
sources du Nil fut faite par des
explorateurs venus de Zanzibar et
des rivages orientaux de l'Afrique.
Ce furent des missionnaires qui
ouvrirent la voie. De 1847 à 1882,
Krapf et Rebmann firent d'impor-
tante s découvertes : Rebmann
trouva le Kilima N'Djaro, en 1848,
Krapf, le Kénia plus au nord, et
recueillirent des renseignements sur les grands
lacs situés derrière la chaîne. C'est alors que la
s<?"iété géographique de Londres envoya Burton
et speke.
Après avoir été à Harrar et assez avant dans le
paysSomalis, lesvoyageurs organisèrentleurexpé-
dition à Zanzibar. Ils arrivèrent par l'Ounyamouési
au lac Tanganyika et supposèrent que c'était le
réservoir du Nil. Mais Speke, s'étant écarté de son
(I) Voir page 174.
les explora ons a" xix* siècle. — Afrique : Tippo-Tip et sa suite
l'Ethiopie et le pays des Gallas et desSomalis. En
Ethiopie, les explorations ont été nombreuses :
après les frères d'Abbadie, Isenberg et Krapt
(1839-1842), sont venus plus tard : Mitchell (1876),
Menges (1877-1881), le Français Raffray, puis
Paulitschke et Hardeggerqui visitèrent le Harrar.
Le pays des Somalis est encore mal connu. En
1879, Manzoni tenta en vain d'atteindre le Djouba
parle nord. De 1881 à 1883, Revoil parcourut le
littoral et la basse vallée de l'Ouébi. En 1898-1891,
BricVtti-Robecchi traverse la corne africains