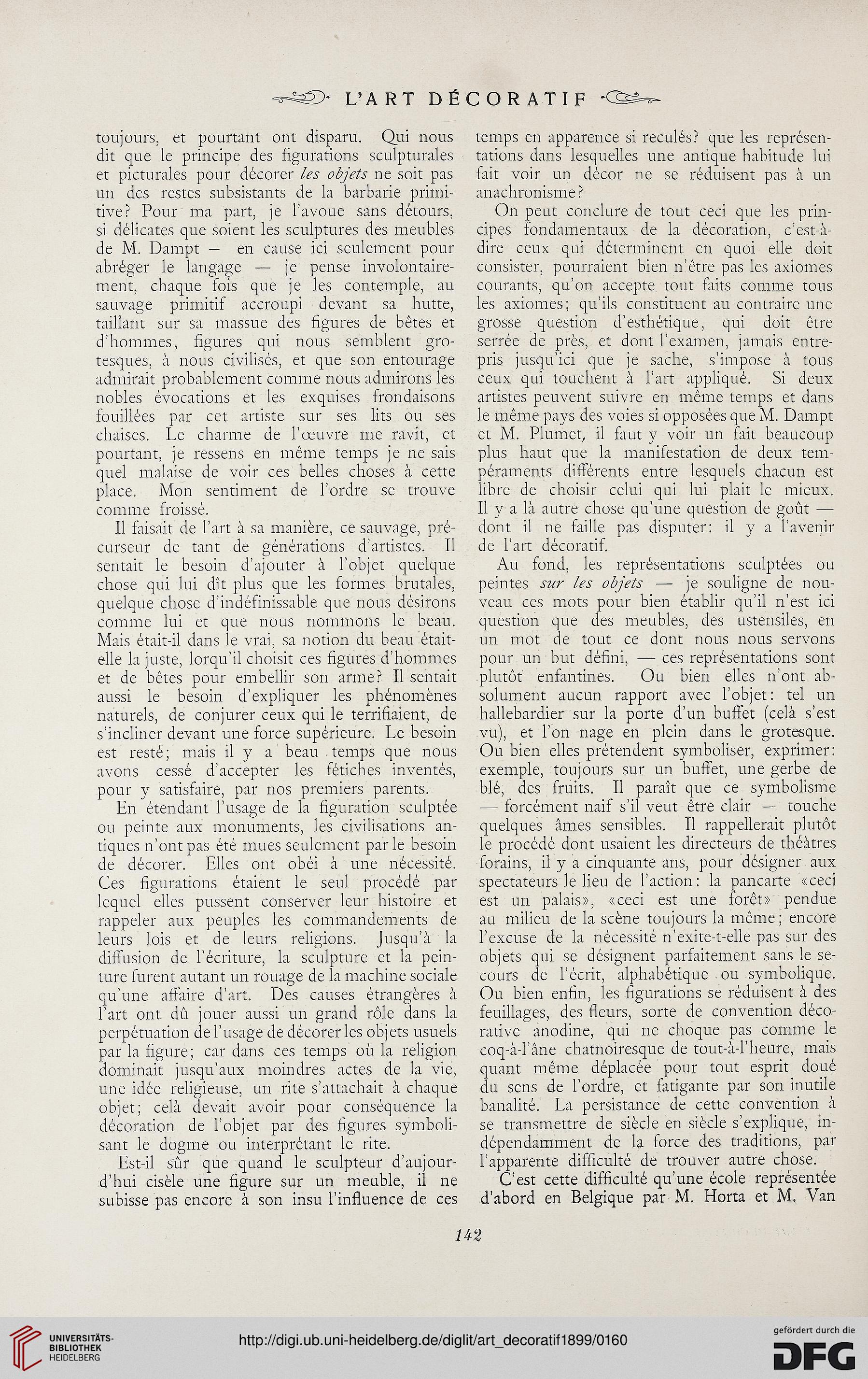L'ART DÉCORATIF
toujours, et pourtant ont disparu. Qui nous
dit que le principe des iigurations sculpturales
et picturales pour décorer Ax ne soit pas
un des restes subsistants de ia barbarie primi-
tive? Pour ma part, je l'avoue sans détours,
si délicates que soient les scuiptures des meubles
de M. Dampt — en cause ici seulement pour
abrëger le langage — je pense involontaire-
ment, chaque fois que je les contemple, au
sauvage primitif accroupi devant sa hutte,
taiilant sur sa massue des hgures de bêtes et
d'hommes, hgures qui nous sembient gro-
tesques, à nous civiiisés, et que son entourage
admirait probabiement comme nous admirons ies
nobies évocations et les exquises frondaisons
fouiüées par cet artiste sur ses lits ou ses
chaises. Le charrne de l'œuvre me ravit, et
pourtant, je ressens en même temps je ne sais
quel malaise de voir ces beiies choses à cette
place. Mon sentiment de i'ordre se trouve
comme froissé.
Ii faisait de l'art à sa manière, ce sauvage, pré-
curseur de tant de générations d'artistes. Ii
sentait ie besoin d'ajouter à l'objet queique
chose qui lui dît plus que ies formes brutales,
queique chose d'indéfinissabie que nous désirons
comme lui et que nous nommons le beau.
Mais était-ii dans !e vrai, sa notion du beau était-
elie la juste, lorqu'il choisit ces hgures d'hommes
et de bêtes pour embeliir son arme? Ii sentait
aussi ie besoin d'expiiquer ies phènomènes
naturels, de conjurer ceux qui ie terrihaient, de
s'incliner devant une force supèrieure. Le besoin
est restë; mais ii y a beau temps que nous
avons cessè d'accepter ies fètiches inventés,
pour y satisfaire, par nos premiers parents,
En étendant l'usage de la hguration sculptèe
ou peinte aux monuments, les civiiisations an-
tiques n'ontpas étè mues seulement parle besoin
de dècorer. Eiies ont obèi à une nècessitè.
Ces hgurations ètaient ie seul procèdé par
iequel elies pussent conserver ieur histoire et
rappeier aux peupies les commandements de
leurs lois et de leurs religions. Jusqu'à la
diifusion de l'ëcriture, ia scuipture et la pein-
ture furent autant un rouage de la machine sociale
qu'une ahaire d'art. Des causes ëtrangères à
l'art ont du jouer aussi un grand rôle dans la
perpètuation del'usage de dècorerles objets usueis
par ia hgure; car dans ces temps où ia reiigion
dominait jusqu'aux moindres actes de ia vie,
une idëe religieuse, un rite s'attachait à chaque
objet; celà devait avoir pour consèquence la
décoration de l'objet par des hgures symboii-
sant ie dogme ou interprètant ie rite.
Est-ii sùr que quand ie scuipteur d'aujour-
d'hui cisèle une hgure sur un meuble, ii ne
subisse pas encore à son insu i'inhuence de ces
temps en apparence si reculès? que les reprèsen-
tations dans lesquelles une antique habitude lui
fait voir un décor ne se rèduisent pas à un
anachronisme?
On peut conciure de tout ceci que les prin-
cipes iondamentaux de la décoration, c'est-à-
dire ceux qui dëterminent en quoi elle doit
consister, pourraient bien n'être pas ies axiomes
courants, qu'on accepte tout faits comme tous
les axiomes; qu'iis constituent au contraire une
grosse question d'esthètique, qui doit être
serrèe de près, et dont i'examen, jamais entre-
pris jusqu'ici que je sache, s'impose à tous
ceux qui touchent à l'art appiiquè. Si deux
artistes peuvent suivre en même ternps et dans
ie mëme pays des voies si opposèes que M. Dampt
et M. Plumet, il faut y voir un fait beaucoup
pius haut que la manifestation de deux tem-
péraments diiférents entre lesquels chacun est
hbre de choisir ceiui qui lui plait le mieux.
Ii y a ià autre chose qu'une question de goût —
dont il ne faille pas disputer: ii y a l'avenir
de l'art dècoratif.
Au fond, ies représentations sculptèes ou
peintes Ax — je souligne de nou-
veau ces mots pour bien établir qu'ii n'est ici
question que des meubles, des ustensiles, en
un mot de tout ce dont nous nous servons
pour un but déhni, — ces reprèsentations sont
plutôt enfantines. Ou bien elles n'ont ab-
solument aucun rapport avec l'objet : tei un
haliebardier sur 1a porte d'un buffet (celà s'est
vu), et i'on nage en plein dans 1e grotesque.
Ou bien elles prètendent symboliser, exprimer:
exemple, toujours sur un buifet, une gerbe de
bié, des fruits. II paraît que ce symboiisme
— forcèment naif s'il veut être clair — touche
quelques âmes sensibles. Ii rappellerait plutôt
le procèdè dont usaient ies directeurs de théàtres
forains, Ü y a cinquante ans, pour désigner aux
spectateursleiieu de i'action: la pancarte «ceci
est un palais^, «ceci est une forët^ pendue
au miiieu de 1a scène toujours la même; encore
i'excuse de la nécessitë n'exite-t-elle pas sur des
objets qui se désignent parfaitement sans le se-
cours de l'ècrit, aiphabètique ou symbolique.
Ou bien enhn, les hgurations se rèduisent à des
feuillages, des heurs, sorte de convention déco-
rative anodine, qui ne choque pas comme le
coq-à-l'âne chatnoiresque de tout-à-l'heure, rnais
quant mêrne dèpiacèe pour tout esprit doué
du sens de i'ordre, et fatigante par son inutile
banalitè. La persistance de cette convention à
se transmettre de siècle en siècle s'explique, in-
dépendamment de la force des traditions, par
i'apparente difhculté de trouver autre chose.
C'est cette difhcultè qu'une ècoie reprèsentèe
d'abord en Belgique par M. Horta et M. Van
toujours, et pourtant ont disparu. Qui nous
dit que le principe des iigurations sculpturales
et picturales pour décorer Ax ne soit pas
un des restes subsistants de ia barbarie primi-
tive? Pour ma part, je l'avoue sans détours,
si délicates que soient les scuiptures des meubles
de M. Dampt — en cause ici seulement pour
abrëger le langage — je pense involontaire-
ment, chaque fois que je les contemple, au
sauvage primitif accroupi devant sa hutte,
taiilant sur sa massue des hgures de bêtes et
d'hommes, hgures qui nous sembient gro-
tesques, à nous civiiisés, et que son entourage
admirait probabiement comme nous admirons ies
nobies évocations et les exquises frondaisons
fouiüées par cet artiste sur ses lits ou ses
chaises. Le charrne de l'œuvre me ravit, et
pourtant, je ressens en même temps je ne sais
quel malaise de voir ces beiies choses à cette
place. Mon sentiment de i'ordre se trouve
comme froissé.
Ii faisait de l'art à sa manière, ce sauvage, pré-
curseur de tant de générations d'artistes. Ii
sentait ie besoin d'ajouter à l'objet queique
chose qui lui dît plus que ies formes brutales,
queique chose d'indéfinissabie que nous désirons
comme lui et que nous nommons le beau.
Mais était-ii dans !e vrai, sa notion du beau était-
elie la juste, lorqu'il choisit ces hgures d'hommes
et de bêtes pour embeliir son arme? Ii sentait
aussi ie besoin d'expiiquer ies phènomènes
naturels, de conjurer ceux qui ie terrihaient, de
s'incliner devant une force supèrieure. Le besoin
est restë; mais ii y a beau temps que nous
avons cessè d'accepter ies fètiches inventés,
pour y satisfaire, par nos premiers parents,
En étendant l'usage de la hguration sculptèe
ou peinte aux monuments, les civiiisations an-
tiques n'ontpas étè mues seulement parle besoin
de dècorer. Eiies ont obèi à une nècessitè.
Ces hgurations ètaient ie seul procèdé par
iequel elies pussent conserver ieur histoire et
rappeier aux peupies les commandements de
leurs lois et de leurs religions. Jusqu'à la
diifusion de l'ëcriture, ia scuipture et la pein-
ture furent autant un rouage de la machine sociale
qu'une ahaire d'art. Des causes ëtrangères à
l'art ont du jouer aussi un grand rôle dans la
perpètuation del'usage de dècorerles objets usueis
par ia hgure; car dans ces temps où ia reiigion
dominait jusqu'aux moindres actes de ia vie,
une idëe religieuse, un rite s'attachait à chaque
objet; celà devait avoir pour consèquence la
décoration de l'objet par des hgures symboii-
sant ie dogme ou interprètant ie rite.
Est-ii sùr que quand ie scuipteur d'aujour-
d'hui cisèle une hgure sur un meuble, ii ne
subisse pas encore à son insu i'inhuence de ces
temps en apparence si reculès? que les reprèsen-
tations dans lesquelles une antique habitude lui
fait voir un décor ne se rèduisent pas à un
anachronisme?
On peut conciure de tout ceci que les prin-
cipes iondamentaux de la décoration, c'est-à-
dire ceux qui dëterminent en quoi elle doit
consister, pourraient bien n'être pas ies axiomes
courants, qu'on accepte tout faits comme tous
les axiomes; qu'iis constituent au contraire une
grosse question d'esthètique, qui doit être
serrèe de près, et dont i'examen, jamais entre-
pris jusqu'ici que je sache, s'impose à tous
ceux qui touchent à l'art appiiquè. Si deux
artistes peuvent suivre en même ternps et dans
ie mëme pays des voies si opposèes que M. Dampt
et M. Plumet, il faut y voir un fait beaucoup
pius haut que la manifestation de deux tem-
péraments diiférents entre lesquels chacun est
hbre de choisir ceiui qui lui plait le mieux.
Ii y a ià autre chose qu'une question de goût —
dont il ne faille pas disputer: ii y a l'avenir
de l'art dècoratif.
Au fond, ies représentations sculptèes ou
peintes Ax — je souligne de nou-
veau ces mots pour bien établir qu'ii n'est ici
question que des meubles, des ustensiles, en
un mot de tout ce dont nous nous servons
pour un but déhni, — ces reprèsentations sont
plutôt enfantines. Ou bien elles n'ont ab-
solument aucun rapport avec l'objet : tei un
haliebardier sur 1a porte d'un buffet (celà s'est
vu), et i'on nage en plein dans 1e grotesque.
Ou bien elles prètendent symboliser, exprimer:
exemple, toujours sur un buifet, une gerbe de
bié, des fruits. II paraît que ce symboiisme
— forcèment naif s'il veut être clair — touche
quelques âmes sensibles. Ii rappellerait plutôt
le procèdè dont usaient ies directeurs de théàtres
forains, Ü y a cinquante ans, pour désigner aux
spectateursleiieu de i'action: la pancarte «ceci
est un palais^, «ceci est une forët^ pendue
au miiieu de 1a scène toujours la même; encore
i'excuse de la nécessitë n'exite-t-elle pas sur des
objets qui se désignent parfaitement sans le se-
cours de l'ècrit, aiphabètique ou symbolique.
Ou bien enhn, les hgurations se rèduisent à des
feuillages, des heurs, sorte de convention déco-
rative anodine, qui ne choque pas comme le
coq-à-l'âne chatnoiresque de tout-à-l'heure, rnais
quant mêrne dèpiacèe pour tout esprit doué
du sens de i'ordre, et fatigante par son inutile
banalitè. La persistance de cette convention à
se transmettre de siècle en siècle s'explique, in-
dépendamment de la force des traditions, par
i'apparente difhculté de trouver autre chose.
C'est cette difhcultè qu'une ècoie reprèsentèe
d'abord en Belgique par M. Horta et M. Van