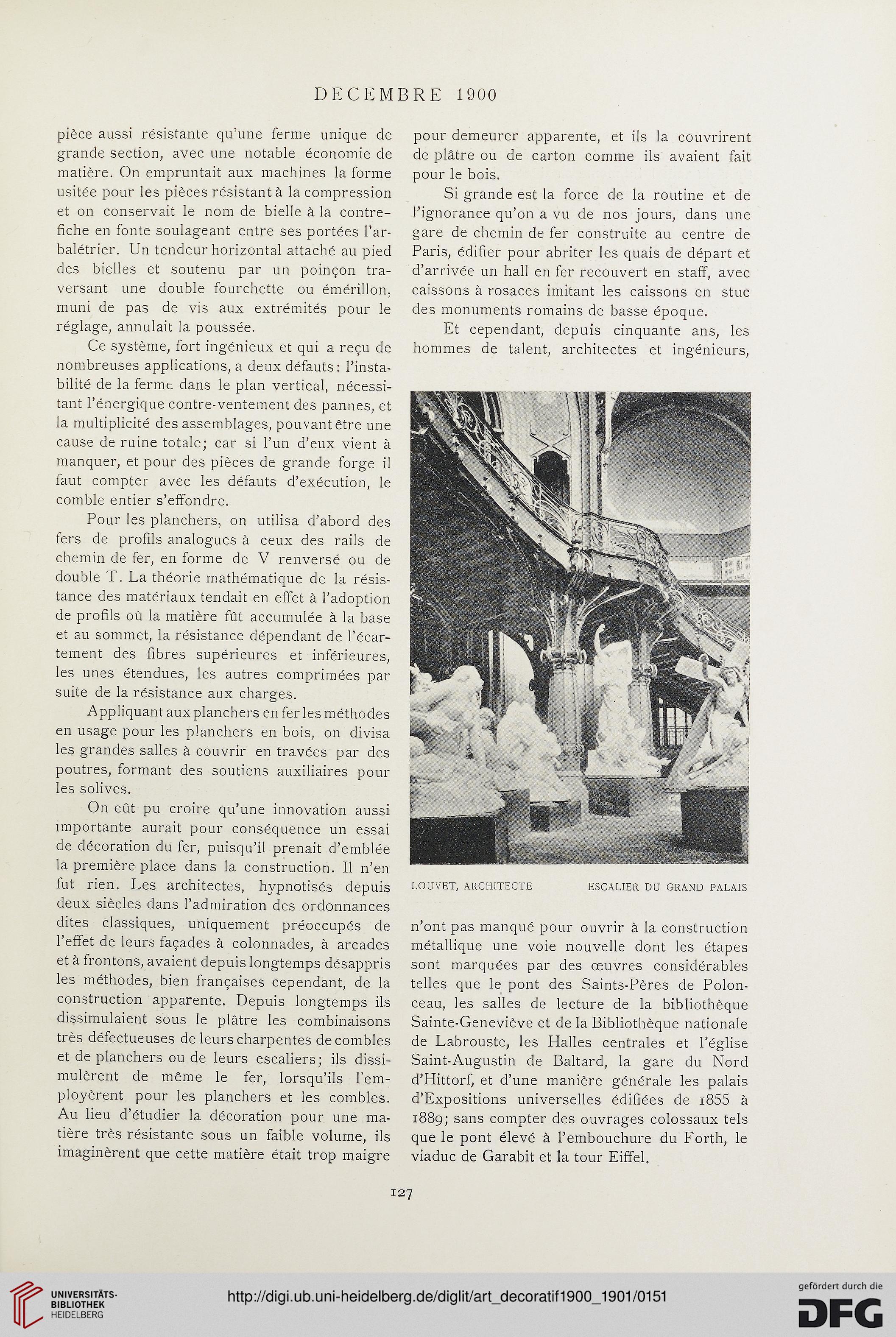DECEMBRE 1900
pièce aussi résistante qu'une ferme unique de
grande section, avec une notable économie de
matière. On empruntait aux machines ia forme
usitée pour les pièces résistant à la compression
et on conservait le nom de bielle à la contre-
fiche en fonte soulageant entre ses portées l'ar-
balétrier. Un tendeur horizontal attaché au pied
des bielles et soutenu par un poinçon tra-
versant une double fourchette ou émérillon,
muni de pas de vis aux extrémités pour le
réglage, annulait la poussée.
Ce système, fort ingénieux et qui a reçu de
nombreuses applications, a deux défauts: l'insta-
bilité de la ferme dans le plan vertical, nécessi-
tant l'énergique contre-ventement des pannes, et
la multiplicité des assemblages, pouvant être une
cause de ruine totale; car si l'un d'eux vient à
manquer, et pour des pièces de grande forge il
faut compter avec les défauts d'exécution, le
comble entier s'effondre.
Pour les planchers, on utilisa d'abord des
fers de profils analogues à ceux des rails de
chemin de fer, en forme de V renversé ou de
double T. La théorie mathématique de la résis-
tance des matériaux tendait en effet à l'adoption
de profils où la matière fût accumulée à la base
et au sommet, la résistance dépendant de l'écar-
tement des fibres supérieures et inferieures,
les unes étendues, les autres comprimées par
suite de la résistance aux charges.
Appliquant aux planchers en fer les méthodes
en usage pour les planchers en bois, on divisa
les grandes salles à couvrir en travées par des
poutres, formant des soutiens auxiliaires pour
les solives.
On eût pu croire qu'une innovation aussi
importante aurait pour conséquence un essai
de décoration du fer, puisqu'il prenait d'emblée
la première place dans la construction. 11 n'en
fut rien. Les architectes, hypnotisés depuis
deux siècles dans l'admiration des ordonnances
dites classiques, uniquement préoccupés de
l'effet de leurs façades à colonnades, à arcades
et à frontons, avaient depuis longtemps désappris
les méthodes, bien françaises cependant, de la
construction apparente. Depuis longtemps ils
dissimulaient sous le plâtre les combinaisons
très défectueuses de leurs charpentes de combles
et de planchers ou de leurs escaliers; ils dissi-
mulèrent de même le fer, lorsqu'ils l'em-
ployèrent pour les planchers et les combles.
Au lieu d'étudier la décoration pour une ma-
tière très résistante sous un faible volume, ils
imaginèrent que cette matière était trop maigre
pour demeurer apparente, et iis la couvrirent
de plâtre ou de carton comme ils avaient fait
pour le bois.
Si grande est la force de la routine et de
l'ignorance qu'on a vu de nos jours, dans une
gare de chemin de fer construite au centre de
Paris, édifier pour abriter les quais de départ et
d'arrivée un hall en fer recouvert en staff, avec
caissons à rosaces imitant les caissons en stuc
des monuments romains de basse époque.
Et cependant, depuis cinquante ans, les
hommes de talent, architectes et ingénieurs,
LOUVET, ARCHITECTE ESCALIER DU GRAND PALAIS
n'ont pas manqué pour ouvrir à la construction
métallique une voie nouvelle dont les étapes
sont marquées par des œuvres considérables
telles que le pont des Saints-Pères de Polon-
ceau, les salles de lecture de la bibliothèque
Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale
de Labrouste, les Halles centrales et l'église
Saint-Augustin de Baltard, la gare du Nord
d'Hittorfj et d'une manière générale les palais
d'Expositions universelles édifiées de i855 à
1889; sans compter des ouvrages colossaux tels
que le pont élevé à l'embouchure du Forth, le
viaduc de Garabit et la tour Eiffel.
127
pièce aussi résistante qu'une ferme unique de
grande section, avec une notable économie de
matière. On empruntait aux machines ia forme
usitée pour les pièces résistant à la compression
et on conservait le nom de bielle à la contre-
fiche en fonte soulageant entre ses portées l'ar-
balétrier. Un tendeur horizontal attaché au pied
des bielles et soutenu par un poinçon tra-
versant une double fourchette ou émérillon,
muni de pas de vis aux extrémités pour le
réglage, annulait la poussée.
Ce système, fort ingénieux et qui a reçu de
nombreuses applications, a deux défauts: l'insta-
bilité de la ferme dans le plan vertical, nécessi-
tant l'énergique contre-ventement des pannes, et
la multiplicité des assemblages, pouvant être une
cause de ruine totale; car si l'un d'eux vient à
manquer, et pour des pièces de grande forge il
faut compter avec les défauts d'exécution, le
comble entier s'effondre.
Pour les planchers, on utilisa d'abord des
fers de profils analogues à ceux des rails de
chemin de fer, en forme de V renversé ou de
double T. La théorie mathématique de la résis-
tance des matériaux tendait en effet à l'adoption
de profils où la matière fût accumulée à la base
et au sommet, la résistance dépendant de l'écar-
tement des fibres supérieures et inferieures,
les unes étendues, les autres comprimées par
suite de la résistance aux charges.
Appliquant aux planchers en fer les méthodes
en usage pour les planchers en bois, on divisa
les grandes salles à couvrir en travées par des
poutres, formant des soutiens auxiliaires pour
les solives.
On eût pu croire qu'une innovation aussi
importante aurait pour conséquence un essai
de décoration du fer, puisqu'il prenait d'emblée
la première place dans la construction. 11 n'en
fut rien. Les architectes, hypnotisés depuis
deux siècles dans l'admiration des ordonnances
dites classiques, uniquement préoccupés de
l'effet de leurs façades à colonnades, à arcades
et à frontons, avaient depuis longtemps désappris
les méthodes, bien françaises cependant, de la
construction apparente. Depuis longtemps ils
dissimulaient sous le plâtre les combinaisons
très défectueuses de leurs charpentes de combles
et de planchers ou de leurs escaliers; ils dissi-
mulèrent de même le fer, lorsqu'ils l'em-
ployèrent pour les planchers et les combles.
Au lieu d'étudier la décoration pour une ma-
tière très résistante sous un faible volume, ils
imaginèrent que cette matière était trop maigre
pour demeurer apparente, et iis la couvrirent
de plâtre ou de carton comme ils avaient fait
pour le bois.
Si grande est la force de la routine et de
l'ignorance qu'on a vu de nos jours, dans une
gare de chemin de fer construite au centre de
Paris, édifier pour abriter les quais de départ et
d'arrivée un hall en fer recouvert en staff, avec
caissons à rosaces imitant les caissons en stuc
des monuments romains de basse époque.
Et cependant, depuis cinquante ans, les
hommes de talent, architectes et ingénieurs,
LOUVET, ARCHITECTE ESCALIER DU GRAND PALAIS
n'ont pas manqué pour ouvrir à la construction
métallique une voie nouvelle dont les étapes
sont marquées par des œuvres considérables
telles que le pont des Saints-Pères de Polon-
ceau, les salles de lecture de la bibliothèque
Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale
de Labrouste, les Halles centrales et l'église
Saint-Augustin de Baltard, la gare du Nord
d'Hittorfj et d'une manière générale les palais
d'Expositions universelles édifiées de i855 à
1889; sans compter des ouvrages colossaux tels
que le pont élevé à l'embouchure du Forth, le
viaduc de Garabit et la tour Eiffel.
127