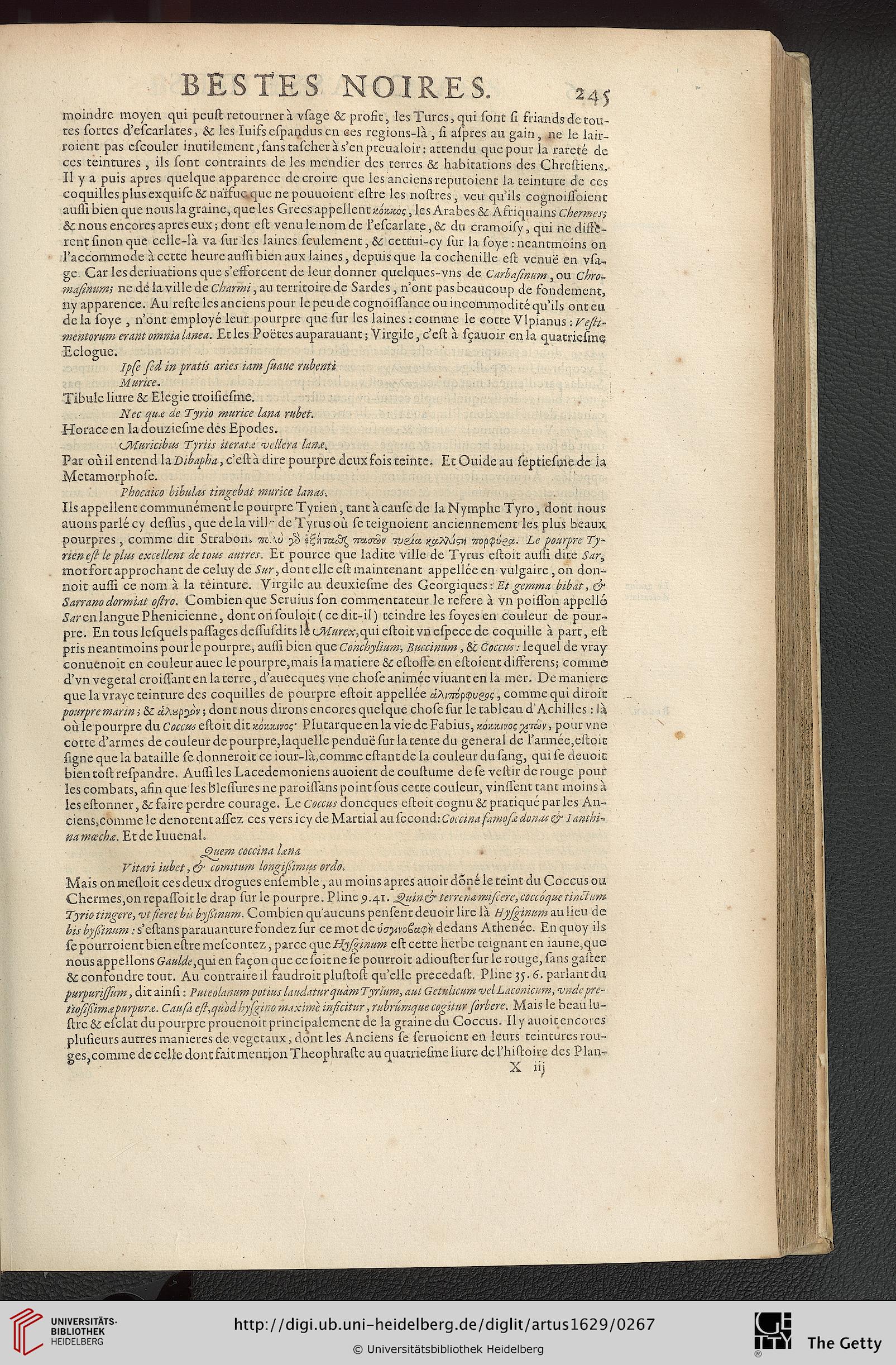BESTES NOIRES.
moindre moyen qui peust retournerà vsage & profit, lesTurcs,qui sont si friandsdetou-
tes sortes d’escarlates, & les Iuifsespandus en ces regions4à , si aspres au gain, ne le lair~
roient pas cscouler inutilement,sans tascheràs enprenaloir: attendu quepour la rareté de
ces teintures , ils sont contraints de les mendier des tcrres & habitations des Chrestiens.
II y a puis apres quelque apparence decroire que les anciens reputoient la teinture de ces
coquilles plus exquise &c naïfue^que ne pouuoient estre les nostres, veu qu’ils cognoilsoient
aussi bien que nous lagraine, que les Grecs appeilent^Wç, lcs Arabes & Afriquams Chermes;
6c nous encores aprcs eux ; dont est venu le nom de l’escarlate, & du cramoisy, qui nc diftis
rcnt stnonque celle-là va sur les îaines seulcment, cettui-cy sur la soye : neantmoins on
raccommode àcette heureaussibienauxlaines, depuisque la cochenille est venuë en vsa-
ge. Car lesderiuations que s’eftorcent de leurdonner quelques-vns de Cdrbasmum ou chro~
wafinumi ne de la ville de charmi, au territoire de Sardes, n’ont pas beaucoup de fondement,
ny apparence. Au reftelesancienspour lepcudecognoissanceouincommoditéqu’ils onteu
dela soye , n’ont employé leur pourpre que sur les laines : comme le cotte Vlpianus. Vesh-
mentorum erantomnialanea. Etles Poëtesauparauant j Virgile, c’est à sçauoir enla quatriesmç
Ecîogue.
jpse fed in pratù aries iam fiuaue rubçnti
Murice.
Tibule liure &c Elegie troisiesme.
Nec qua de Tyrio murice lana rubet.
Horace en la douziesme des Epodes.
CAJuricibm Tyriis itcrat.e vellera lanœ.
Par oii il entend la Dibapha, c’est à dire pourpre deux fois teinte. Et Ouide au septiesine de h
Metamorphose.
Phocaico bibulats tingebat murice lanas-.
lisappellentcommunémentlepourpreTyrien,tantàcausede laNymphe Tyro, donc nous
auons parlé cy dessus, que dela vilst- de Tyrus où se teignoient anciennement les plus beaux
pourpres, comme dit Strabon. 7n.\u yè é^lnstcd^ 7moüv ipeaa ■7rop<pôes i' Le pourpre Ty~
rienesi leplus excellent detous autres. Et pource que ladite ville de Tyrus estoic aussi dite Sar^
motfortapprochantdeceluy de .S7/r,dontelleestmaintenant appelléeen vulgaire,on don-
noit aussi ce nom à la téinture. Virgile au deuxiesme des Georgiques : Et gemma bibat, &
Sarranodormiat oslro. Combienque Seruius son commentateur le refere à vn poisson appcllo
^renlanguePhenicienne, dontonsouloit(cedit-il) teindre les soyesen couleur de pour«
pre. EiitouslesquelspassagesdesssusditslêcJls//mY,quiestoitvnespecede coquille à part,est
pris neantmoins pour le pourpre, aussi bien que Conchylium, Buccinum, Sc Coccm : lequel de vray
conuenoit en couleur auec le pourpre,mais lamatiere Sc estofle en estoient difterens; comme
d’vnvegetalcroissàntenlaterre,d’auecquesvnechoseaniméeviuantenla mer. Demaniere
que la vrayeteinture des coquilles de pourpre estoit appellée dAinvpipu&ç, commequi diroit
pourpremarin> &c dXapfiv ; dont nous dirons encores quelque chose sur le tablcau d Achilles : là
où le pourpre du Cocctts estoit dit zozzivoç’ Plutarqueenla vie de Fabius, fcàzxivoçytT&v, pour vne
cotted’armes decouleurdepourpre,laquellependuësuriatentedu general de rarmée,elloiG
signe que la bataille se donneroit ce iour-là^comme estant de la couleur du sang, qui se deuoic
bientostrespandre. AussilesLacedemoniensauoientdecoustume dese vestir derouge pour
les combats, afin que les blesilires ne paroisians pointsous cette couleur, vinssent tant moins à
les estonner, &c faire perdre courage. Le Coccus doncques estoit cognu 6c pratiqué par les An-
ciens,comnie le denotentassfez ces vers icy de Martial au second: Coccinasamosie donas & lanthh
namœcha. Etde Iuuenah
siuem coccina Una
Vitari iubet, & cpmitum longifiimits ordo»
Mais on messoit ces deux drogues ensemble, au moins aprés auoir doné le teint du Coccus oiî
Chermes,on repassoitle drap sur le pourpre. Pline5».41. Jsitin& terrenamiscerc,coccoquetinctum
Tyrio tingere, <vtsieretbù byfiinum. Combien qu aucuns pensent deuoir lire là Hysginum au lieu de
bisbyfinum : s’estans parauanture fondezsur cemot deueyivo&ctp)1 dedans Athenée. En quoy ils
sepourroientbienestremescontez, oyizHysgmum estcette herbe teignanten iaune,que
nous appellons Gaulde^ qui en façon que ce soit ne se pourroit adiouster sur le rouge, sans gaster
ôc confondre tout. Au contraireil faudroitplustost qu’clle precedast. Piine^y.G parlantdu
purpurijfum, dit ainss : Puteolanumpotius iaudatur qnam Tyrium, aut Getuhcum velLaconicum, vndepre-
tïosisiimapurpura. Causa e/hquodhysgino maxime ïnsicitur, rubrumque cogitur forbere. Mais le beau lu-
stre&csclatdupourpreprouenoitprincipalementde la grainedu Coccus. 11y auoitencores
plusteursautresmanieresde vegetaux, dont les Anciens se seruoient en leurs teinturesrou-
ges?comme decelle dontfaitmention Theophraste au quatriesme liure del’histoirc des Plan-
moindre moyen qui peust retournerà vsage & profit, lesTurcs,qui sont si friandsdetou-
tes sortes d’escarlates, & les Iuifsespandus en ces regions4à , si aspres au gain, ne le lair~
roient pas cscouler inutilement,sans tascheràs enprenaloir: attendu quepour la rareté de
ces teintures , ils sont contraints de les mendier des tcrres & habitations des Chrestiens.
II y a puis apres quelque apparence decroire que les anciens reputoient la teinture de ces
coquilles plus exquise &c naïfue^que ne pouuoient estre les nostres, veu qu’ils cognoilsoient
aussi bien que nous lagraine, que les Grecs appeilent^Wç, lcs Arabes & Afriquams Chermes;
6c nous encores aprcs eux ; dont est venu le nom de l’escarlate, & du cramoisy, qui nc diftis
rcnt stnonque celle-là va sur les îaines seulcment, cettui-cy sur la soye : neantmoins on
raccommode àcette heureaussibienauxlaines, depuisque la cochenille est venuë en vsa-
ge. Car lesderiuations que s’eftorcent de leurdonner quelques-vns de Cdrbasmum ou chro~
wafinumi ne de la ville de charmi, au territoire de Sardes, n’ont pas beaucoup de fondement,
ny apparence. Au reftelesancienspour lepcudecognoissanceouincommoditéqu’ils onteu
dela soye , n’ont employé leur pourpre que sur les laines : comme le cotte Vlpianus. Vesh-
mentorum erantomnialanea. Etles Poëtesauparauant j Virgile, c’est à sçauoir enla quatriesmç
Ecîogue.
jpse fed in pratù aries iam fiuaue rubçnti
Murice.
Tibule liure &c Elegie troisiesme.
Nec qua de Tyrio murice lana rubet.
Horace en la douziesme des Epodes.
CAJuricibm Tyriis itcrat.e vellera lanœ.
Par oii il entend la Dibapha, c’est à dire pourpre deux fois teinte. Et Ouide au septiesine de h
Metamorphose.
Phocaico bibulats tingebat murice lanas-.
lisappellentcommunémentlepourpreTyrien,tantàcausede laNymphe Tyro, donc nous
auons parlé cy dessus, que dela vilst- de Tyrus où se teignoient anciennement les plus beaux
pourpres, comme dit Strabon. 7n.\u yè é^lnstcd^ 7moüv ipeaa ■7rop<pôes i' Le pourpre Ty~
rienesi leplus excellent detous autres. Et pource que ladite ville de Tyrus estoic aussi dite Sar^
motfortapprochantdeceluy de .S7/r,dontelleestmaintenant appelléeen vulgaire,on don-
noit aussi ce nom à la téinture. Virgile au deuxiesme des Georgiques : Et gemma bibat, &
Sarranodormiat oslro. Combienque Seruius son commentateur le refere à vn poisson appcllo
^renlanguePhenicienne, dontonsouloit(cedit-il) teindre les soyesen couleur de pour«
pre. EiitouslesquelspassagesdesssusditslêcJls//mY,quiestoitvnespecede coquille à part,est
pris neantmoins pour le pourpre, aussi bien que Conchylium, Buccinum, Sc Coccm : lequel de vray
conuenoit en couleur auec le pourpre,mais lamatiere Sc estofle en estoient difterens; comme
d’vnvegetalcroissàntenlaterre,d’auecquesvnechoseaniméeviuantenla mer. Demaniere
que la vrayeteinture des coquilles de pourpre estoit appellée dAinvpipu&ç, commequi diroit
pourpremarin> &c dXapfiv ; dont nous dirons encores quelque chose sur le tablcau d Achilles : là
où le pourpre du Cocctts estoit dit zozzivoç’ Plutarqueenla vie de Fabius, fcàzxivoçytT&v, pour vne
cotted’armes decouleurdepourpre,laquellependuësuriatentedu general de rarmée,elloiG
signe que la bataille se donneroit ce iour-là^comme estant de la couleur du sang, qui se deuoic
bientostrespandre. AussilesLacedemoniensauoientdecoustume dese vestir derouge pour
les combats, afin que les blesilires ne paroisians pointsous cette couleur, vinssent tant moins à
les estonner, &c faire perdre courage. Le Coccus doncques estoit cognu 6c pratiqué par les An-
ciens,comnie le denotentassfez ces vers icy de Martial au second: Coccinasamosie donas & lanthh
namœcha. Etde Iuuenah
siuem coccina Una
Vitari iubet, & cpmitum longifiimits ordo»
Mais on messoit ces deux drogues ensemble, au moins aprés auoir doné le teint du Coccus oiî
Chermes,on repassoitle drap sur le pourpre. Pline5».41. Jsitin& terrenamiscerc,coccoquetinctum
Tyrio tingere, <vtsieretbù byfiinum. Combien qu aucuns pensent deuoir lire là Hysginum au lieu de
bisbyfinum : s’estans parauanture fondezsur cemot deueyivo&ctp)1 dedans Athenée. En quoy ils
sepourroientbienestremescontez, oyizHysgmum estcette herbe teignanten iaune,que
nous appellons Gaulde^ qui en façon que ce soit ne se pourroit adiouster sur le rouge, sans gaster
ôc confondre tout. Au contraireil faudroitplustost qu’clle precedast. Piine^y.G parlantdu
purpurijfum, dit ainss : Puteolanumpotius iaudatur qnam Tyrium, aut Getuhcum velLaconicum, vndepre-
tïosisiimapurpura. Causa e/hquodhysgino maxime ïnsicitur, rubrumque cogitur forbere. Mais le beau lu-
stre&csclatdupourpreprouenoitprincipalementde la grainedu Coccus. 11y auoitencores
plusteursautresmanieresde vegetaux, dont les Anciens se seruoient en leurs teinturesrou-
ges?comme decelle dontfaitmention Theophraste au quatriesme liure del’histoirc des Plan-