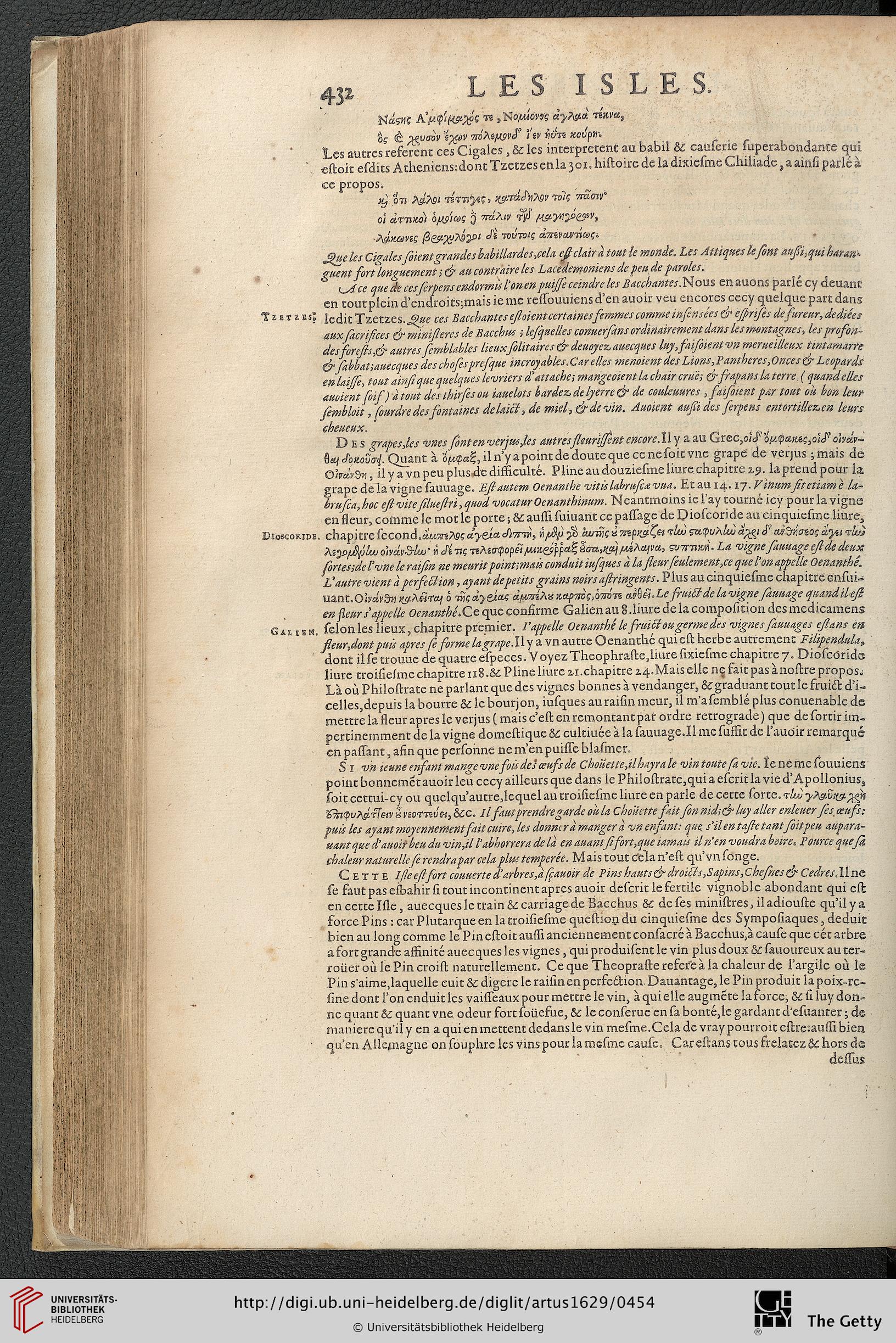Tzjetzbs;
432 L £ S I S L E S.
KaçTsî ATè, ’KofMOVQç ây?&ci. Ttxm,
oç psiycvv %%t>v uüXîsjyv^ t'ev mvt zovpv.
tes autres referent ces Cigales, &: les intcrpretent au babil ÔC causerie superabondante qui
estoit esdits Atheniens:dont Tzetzes enla 301. histoire de la dixiesme Chiiiade, aainsi parlé à
ce propos.
jy 071 ?d?9i TSTTJytç, J&T&<hl?9V Tülç 7rasslV h
01 drTVto) b/w'iœç 3 7rctÂiv *$)
?d>tct>vèç fie$t%>?9¥>i di rouTOiç d,7nvcu/'na>çi
JPueles Cigales feientgrandesbabillardesjela eâclaira toutle monâe. Les Attiqueslefônt aup.quiharan-
guent sort longuement ; & au contraire les Lacedemoniens depeu de paroles.
t^Ace queâecesfèrpensendormïslonenpuijfeceindrelesBacchantes,Nous enauons parlé cy deuanc
en toutplein d’endroits;mais ie me restouuiensd’en auoir veu encores cecy quelque part dans
ledit T zetzes.j^ ces Bacchantes estoientcertainesfemmes comme inftnsées & efprises desureur, dediées
aux sacristces & ministeres de Bacchus ; lefquelies conuersans ordinairement dans lesrrwntagnes, les proson-
desforeftsftr autres femhlahles lieuxftolitaires & deuoyez,auecques luy.saisoientvnmerueilleux timamarre
& sabhatiauecques deschofespresque incroyahles.Carelles menoient des Lîons> Pantheres,Onces & Leopards
enlaijfe, tout ainstque quelques levriers d'attachei mangeoientla chair crue> &frapansla terre ( quandelles
auoient ftois ) a tout desthirfesou iauelots bardez,delyerre& de couleuures ,saifôient par tout ou bon leur
sembloit, sourdredesfontaincs delaics, de micl, &dcvïn. Auoient austi des ferpens entortiÜez,en leurs
cheueux.
D es grapesjes vnesfontenverjusjes autressseurijfentcncore.lly aau Grec,o/LopipetxÆçftnPohdv~
6 a/ dostova{. Quant à bVpa^Un’yapointdedoutequecenesoitvne grape de verjus ;mais d©
Q/vdvdv, ilya vnpeuplusstedifïiculté. Plineaudouziesmeliurechapitre zy. laprendpour la
grape de la vigne sauuage. Bstautem Oenanthe vitislabrusicœ vua. Et au 14.17. Vinumsitetiame la-
brufca,hoc estvitefilueftYi,quod vocaturOenanthinurn. Neantmoins iel’ay tourné icy pourla vignc
en sseur, comme le mot le porte j &: austi suiuant ce passage de Dioscoride au cinquiesme liure,
Bîoscoride. chapitre second.dum?9ç ctyexct v\ ftft yè cwtHç b 7npK9-K& szzcpoAIw ctygi cdZrJiazoç ayti rla)
Xiy>ju^jLuu q'ivclvSIw' y\ csi vç TthèŒ(popcisMzçftppas ètTu,Kft)/AÂAcqva, çv7mm. La vigne sauuage estde deux
JortessdeLvne le raiftn ne menritpointsmais conduit iusques à la sseurfeulement,ce que l’on appelle Oenanthê.
Üautre vientàpersection, ayantdepetitsgrainsnoirsastringents. Plus au cinquiesme chapitre ensui-
uant.Ohdvïtm /^Asiraj 0 tJç dyexctç ct/umÀis jiap7wç,07WTè avQéi.Le fruiff de lavigne sauuage qnandileft
ensseurs'appelle Oenanthé*Ccqueconfîrme Galienau 8.1iuredelacomposttiondesmedicamens
Guisn, selon les lieux, chapitre premier. Vappelle Oenanthé le srmciougerme des vignessauuages eftans en
sseurftontpuis apres fe forme lagrape.il y a vn autre Oenanthé quiest herbe autrement FiLipendula,
dont ilsctrouue dequatreespeces.VoyezTheophraste,liure stxiesme chapitrcy. Dioscôride
liure troistesmechapitre 118.&: Plineliure zi.chapitre z^.Maisellenj faitpasànostre propos»
Là où Philostrate ne parlant que des vignes bonnes à vendanger, ôc graduant tout le fruid d’i-
celles,depuis la bourre &: le bourjon, iusques auraisin meur, il m’asemblé plus conuenable dc
mettre la sseur apres le verjus ( mais c’est en remontant par ordre retrograde ) que de sortir im-
pertinemment de la vigne domestique &: cultiuée à la sauuage.il me sufHt de i’auoir remarquc
en pastant, afin que personne ne m’en puisse blasmer.
S r vn ieuneensantmangevnesoisdesœussde chonettejlhayrale vïntoutesavic. îenemesouuiens
point bonnemétauoir leu cecy ailleurs que dans le Philostrate,quia escritla vied’Apollonius,
soit cettui-cy ou quelqu’autre,lequel au troistesme iiure cn parle de cette sorte. t!w yP&w'&pftn
iFhspv/ftTÎejv 8 vèQTTtua, &CC. llsantprendregarde ou la Chouette fait fon nidsér Luy allcr enleuer Jès œuss:
puis lcs ayant moyennementsait cmre, les donncrà mangerà vnensant: que s'Üentastetant Joitpeu aupara-
uantque d’auoir heu du vm,il L’abhorrera de là en auantfifort,que iamais iL nen voudra boire, Pource quefà
chaleurnaturelleferendraparcelaplmtcmperée. Maistoutc'elan’est qu’vnsonge.
C e t t E ifLeeftfort couuerte d’arbres,à fcauoir de Pins hauts & droi£ïs,Sapins, Chefnes & Cedres.ll ne
se fautpasesbahirfîtoutincontinentapresauoir descrit ie fertiie vignoble abondant qui est
encettelsse, auecquesletrain&rcarriagedc Bacchus &: deses ministres, iladiouste qu’ilya
forcePins : carPlutarqueen latroisiesme questioçLdu cinquiesme des Sympostaques, deduit
bien au iong comme le Pin estoit aussi anciennement consacré à Bacchus,à cause que cét arbre
a fort grande affinité auecques les vignes, qui produisent le vin plus doux ôc sauoureux au ter-
roüeroùlePincroist naturellement. CequeTheoprasterefeseàlachaleurde l’argile où le
Pin s’aimedaquelle cuit ôc digere le raisinenperfedion. Dauantage, le Pin produit lapoix-re-
stne dont l’on enduit les vaisseaux pour mettre le vin, àquielle augméte laforce, ôc st luy don»
ne quant ôc quant vne odeur fort soüefue, &: le conserue en sa bonté,le gardant d’esuanter ; de
maniere qu’ily en aquienmettentdedansle vin mesme.Celadevraypourroitestre:aussibien
qu’en Allemagne on souphre les vinspour la mesme cause. Carestans tous frelatezôchors dc
dessas
432 L £ S I S L E S.
KaçTsî ATè, ’KofMOVQç ây?&ci. Ttxm,
oç psiycvv %%t>v uüXîsjyv^ t'ev mvt zovpv.
tes autres referent ces Cigales, &: les intcrpretent au babil ÔC causerie superabondante qui
estoit esdits Atheniens:dont Tzetzes enla 301. histoire de la dixiesme Chiiiade, aainsi parlé à
ce propos.
jy 071 ?d?9i TSTTJytç, J&T&<hl?9V Tülç 7rasslV h
01 drTVto) b/w'iœç 3 7rctÂiv *$)
?d>tct>vèç fie$t%>?9¥>i di rouTOiç d,7nvcu/'na>çi
JPueles Cigales feientgrandesbabillardesjela eâclaira toutle monâe. Les Attiqueslefônt aup.quiharan-
guent sort longuement ; & au contraire les Lacedemoniens depeu de paroles.
t^Ace queâecesfèrpensendormïslonenpuijfeceindrelesBacchantes,Nous enauons parlé cy deuanc
en toutplein d’endroits;mais ie me restouuiensd’en auoir veu encores cecy quelque part dans
ledit T zetzes.j^ ces Bacchantes estoientcertainesfemmes comme inftnsées & efprises desureur, dediées
aux sacristces & ministeres de Bacchus ; lefquelies conuersans ordinairement dans lesrrwntagnes, les proson-
desforeftsftr autres femhlahles lieuxftolitaires & deuoyez,auecques luy.saisoientvnmerueilleux timamarre
& sabhatiauecques deschofespresque incroyahles.Carelles menoient des Lîons> Pantheres,Onces & Leopards
enlaijfe, tout ainstque quelques levriers d'attachei mangeoientla chair crue> &frapansla terre ( quandelles
auoient ftois ) a tout desthirfesou iauelots bardez,delyerre& de couleuures ,saifôient par tout ou bon leur
sembloit, sourdredesfontaincs delaics, de micl, &dcvïn. Auoient austi des ferpens entortiÜez,en leurs
cheueux.
D es grapesjes vnesfontenverjusjes autressseurijfentcncore.lly aau Grec,o/LopipetxÆçftnPohdv~
6 a/ dostova{. Quant à bVpa^Un’yapointdedoutequecenesoitvne grape de verjus ;mais d©
Q/vdvdv, ilya vnpeuplusstedifïiculté. Plineaudouziesmeliurechapitre zy. laprendpour la
grape de la vigne sauuage. Bstautem Oenanthe vitislabrusicœ vua. Et au 14.17. Vinumsitetiame la-
brufca,hoc estvitefilueftYi,quod vocaturOenanthinurn. Neantmoins iel’ay tourné icy pourla vignc
en sseur, comme le mot le porte j &: austi suiuant ce passage de Dioscoride au cinquiesme liure,
Bîoscoride. chapitre second.dum?9ç ctyexct v\ ftft yè cwtHç b 7npK9-K& szzcpoAIw ctygi cdZrJiazoç ayti rla)
Xiy>ju^jLuu q'ivclvSIw' y\ csi vç TthèŒ(popcisMzçftppas ètTu,Kft)/AÂAcqva, çv7mm. La vigne sauuage estde deux
JortessdeLvne le raiftn ne menritpointsmais conduit iusques à la sseurfeulement,ce que l’on appelle Oenanthê.
Üautre vientàpersection, ayantdepetitsgrainsnoirsastringents. Plus au cinquiesme chapitre ensui-
uant.Ohdvïtm /^Asiraj 0 tJç dyexctç ct/umÀis jiap7wç,07WTè avQéi.Le fruiff de lavigne sauuage qnandileft
ensseurs'appelle Oenanthé*Ccqueconfîrme Galienau 8.1iuredelacomposttiondesmedicamens
Guisn, selon les lieux, chapitre premier. Vappelle Oenanthé le srmciougerme des vignessauuages eftans en
sseurftontpuis apres fe forme lagrape.il y a vn autre Oenanthé quiest herbe autrement FiLipendula,
dont ilsctrouue dequatreespeces.VoyezTheophraste,liure stxiesme chapitrcy. Dioscôride
liure troistesmechapitre 118.&: Plineliure zi.chapitre z^.Maisellenj faitpasànostre propos»
Là où Philostrate ne parlant que des vignes bonnes à vendanger, ôc graduant tout le fruid d’i-
celles,depuis la bourre &: le bourjon, iusques auraisin meur, il m’asemblé plus conuenable dc
mettre la sseur apres le verjus ( mais c’est en remontant par ordre retrograde ) que de sortir im-
pertinemment de la vigne domestique &: cultiuée à la sauuage.il me sufHt de i’auoir remarquc
en pastant, afin que personne ne m’en puisse blasmer.
S r vn ieuneensantmangevnesoisdesœussde chonettejlhayrale vïntoutesavic. îenemesouuiens
point bonnemétauoir leu cecy ailleurs que dans le Philostrate,quia escritla vied’Apollonius,
soit cettui-cy ou quelqu’autre,lequel au troistesme iiure cn parle de cette sorte. t!w yP&w'&pftn
iFhspv/ftTÎejv 8 vèQTTtua, &CC. llsantprendregarde ou la Chouette fait fon nidsér Luy allcr enleuer Jès œuss:
puis lcs ayant moyennementsait cmre, les donncrà mangerà vnensant: que s'Üentastetant Joitpeu aupara-
uantque d’auoir heu du vm,il L’abhorrera de là en auantfifort,que iamais iL nen voudra boire, Pource quefà
chaleurnaturelleferendraparcelaplmtcmperée. Maistoutc'elan’est qu’vnsonge.
C e t t E ifLeeftfort couuerte d’arbres,à fcauoir de Pins hauts & droi£ïs,Sapins, Chefnes & Cedres.ll ne
se fautpasesbahirfîtoutincontinentapresauoir descrit ie fertiie vignoble abondant qui est
encettelsse, auecquesletrain&rcarriagedc Bacchus &: deses ministres, iladiouste qu’ilya
forcePins : carPlutarqueen latroisiesme questioçLdu cinquiesme des Sympostaques, deduit
bien au iong comme le Pin estoit aussi anciennement consacré à Bacchus,à cause que cét arbre
a fort grande affinité auecques les vignes, qui produisent le vin plus doux ôc sauoureux au ter-
roüeroùlePincroist naturellement. CequeTheoprasterefeseàlachaleurde l’argile où le
Pin s’aimedaquelle cuit ôc digere le raisinenperfedion. Dauantage, le Pin produit lapoix-re-
stne dont l’on enduit les vaisseaux pour mettre le vin, àquielle augméte laforce, ôc st luy don»
ne quant ôc quant vne odeur fort soüefue, &: le conserue en sa bonté,le gardant d’esuanter ; de
maniere qu’ily en aquienmettentdedansle vin mesme.Celadevraypourroitestre:aussibien
qu’en Allemagne on souphre les vinspour la mesme cause. Carestans tous frelatezôchors dc
dessas