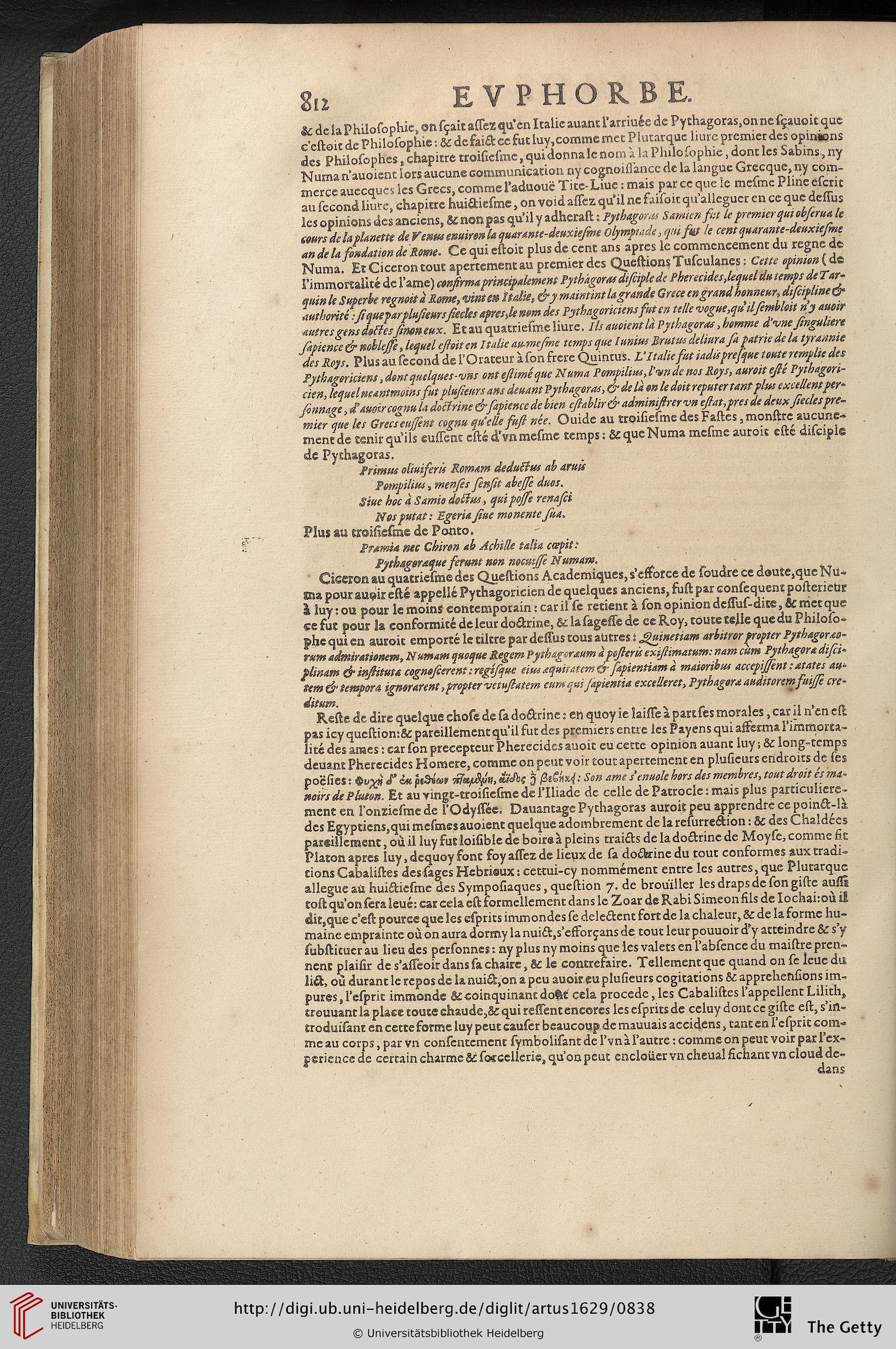êc dc iaPhilosophic, on sçait asscz qu’cn Italic auant i’arriuce de Py thagoras,on nc sçauoit quc
c’estoit de Philosophic : Ôc dc fai& cc fut iuy,commc met P lutarquc liure premier des opimçns
dcs Philosophes, chapitrc troisicsmc, qui donna lc nom 'a la Plulosophie, dont lcs Sabins, ny
Numa n auoient Iors aucunc Gommunication ny cognoissancc dc ia langue Grccque, ny com-
mcrcc auecqucs îcs Grccs, comme Paduouc Titc- Liuc : mais par cc que îe mcsmc Plinc escric
au second liurc, chapitrc huiaicsmc, on void asscz quhl nc faisoit quallegucr cn cc quc dessus
iesopinionsdcsancicns, 6cnonpasquilyadhcrast :Fythagoras Samien stt UpremierquiobseruaU
iours ddaplanette de Venm enmren la quarante-deuxiesme olymptade yqtù stt U cent quarantc-deuxiesmt
an de lafmdation de Rome. Ce qui cstoit plus dc ccnt ans aprcs le commencemcnt du regne dc
Numa. Et Ciccron tout apertcment au prcmier des Questions Tusculanes ; Cette opimon ( dc
i’immortaiité dc i’amc) confrmaprincipaUment Fythagoras dtsciplede PherecidesJequel du temps deTar-
quin le Superhe regnoità. Rome, vintcn ïtdie, &y maintintlagrande Grece engrand honntur, dtscipline&
authoriü :siqueparpluseursfiecles apresje nom des Fythagorictensstten telle vogue,qùilsemhloit nj auoir
antresgtnsdoslessiwneux. Et au quatriesmeliure. Ilsauoientla Pythagoras,homme d’vne singulicrt
sapknce & nobUJse, lequel esioiten Italie au.mcfmt temps que /unius Brutus dtliura fa patrit de la tyrannie
des Roys. Plus au second de i’Orateur à son frcre Quintus. LTtaliestt iadtsprefque toute remplte des
Fythagorkiens, dontquelques-vns ontesiimêque Numa Fompilms, L’vn dc nos Roys, auroit esié Pytbagori-
cien, Uquelnsantmoins sut plustnrs ans deuant Pythagoras, &delà onledoitreputertant plus excellentper*
Jonnage, d’auoircognu la docîrint &sapience de hien esiahlir& adminifirervn estat,presde deuxfteclespre-
mier qtte les Grecseujsent cognu quelle stst née. Ouide au troissesme des Fastes, monstrc aucune-
mentdc tenirqu ils eussent estc d’vnmesme temps : &:queNuma mcsme auroit esté disciple
dc Pychagoras.
Frtmus oliuiseris Romam deduBus ah aruis
Fompilius, menfes fenstt ahejse duos.
Siue hoc a Samio dossus, quipojse renasci
Nosputat: Egeria siue monente fua.
Plus au croissesmc de Ponto,
Framia nec Chiron ah Achïlle talia cœpit:
Fythagoraque serunt non nocmjse Numam.
Cieeron au quatricsmedes Questions Academiques, s’cfsorce de soudre ce doute,que Nii-
mz pourauoir esté appelié Pythagoricien de quelques anciens, fust par consequent posterietir
à luy : ou pour le moins contemporain : car il sc retient a son opinion dessiis-dite, 6c mctque
ce fut pour la conformité deleur dodrine, 6c lasagesse de ce Roy, toute te]le quedu Philoso»
phe qui en auroit emporté le tiltrc par dessus tous aütres : Jjuwettam arbitrorpropter Fythagorao-
rum admirationem, Numam quoque Regem Pytbagsraum â posteris exiftimatum: nam cum Fythagora dtsci*
plinam &instituta cognescerent : regsque eius œquiratcm & sapientiama maiorihus accepistent : atates au-
tem & tempora ignorarent ,proptervetustatern cum smjapientia exceileret, Fythagorx auditorem sttjse cre~
ditum.
Reste dc dirc quelque ehosc de sa do&rine : en qiîoy ie îaisse à part ses moraîes, car il n* en cst
pas icy qucstion:& parcillemcnt qu’il fut dcs premiers entre lcs Paycns qui aiserma Fimmorta-
îitc des anacs : car son preceptcur Pherecidcs auoit eu cette opinibn auant luy ; & long=temps
deuant Pherccides Homere, commeonpeutvoir toutapertementen plusseursendroitsde ses
pocsies : <s* ou ptdiap nsetftpti, ètidbç 3 Son ame stnuole hors des memhres, toutdroit és ma~
noïrs de Pluton. Et au vingt-troisiesmederiliade dc celle de Patrocle : mais plus particulicre-
ment en ronziesmede rOdyssce. Dauantage Pythagoras auroitpeu apprendre cepoinâ:-là
dcs Egyptiens,quimesmesauoient queîqueadombrement delaresurredion : 6c des Chaldées
pareillcment, où il luy fut loisible de boire à pleins trai&s de la dodrinc de Moyse, comme fit
Platon aprcs luy, dequoy font foy assez dc lieux de sa dodkrine du tout conformes aux tradi«
tions Cabaiistes des sages Hcbrioux : cetrui-cy nommément entre les autres, que Plutarque
allegueaü huidicsme des Symposiaques, question 7. de brouïller lesdrapsdesongistc aussi
tost qu’on (cra Ieuc: car cela est formellement dans le Zoar de Rabi Simeon fils de Iochairoù il
dit,que c’est pource que îes esprits immondes se dele&ent fort de la chalcur, & de la forme hu-
maine emprainte où on aura dormy la nui&,s’efForçans de tout leur pouuoir d’y atteindre & s*y
substicuer au licu des personncs : ny plus ny moins que ies valets en l’absence du maistre pren-
ncnc plaisir des’asseoirdanssachaire, 6c le contrefaire. Tellementquc quand on se leuedu
li£I, ou durant le repos de la nui&,on a peu auoir çu plusieurs cogitations 6c apprehensions im-
pures,sesprit immondc ôccoinquinantdostt cela procede, lcs Cabalistesl’appellentLilith,
trouuantlaplaee toutechaude,&:quiressentenccres lcsespritsde ccluy dontccgiste est, s’iil-
troduisant en cette forme luy peut causer beaucoup dc mauuais accidens, tant en scsprit com~
mcau corps,parvn conscntemcnt symboiisantdervnàrautre:commconpeutvoirparrex-
pericncc dc cerrain charme 6c socccllerie, qu’onpcut encloiicr vncheual fîchantvn cloud dc-
dans
c’estoit de Philosophic : Ôc dc fai& cc fut iuy,commc met P lutarquc liure premier des opimçns
dcs Philosophes, chapitrc troisicsmc, qui donna lc nom 'a la Plulosophie, dont lcs Sabins, ny
Numa n auoient Iors aucunc Gommunication ny cognoissancc dc ia langue Grccque, ny com-
mcrcc auecqucs îcs Grccs, comme Paduouc Titc- Liuc : mais par cc que îe mcsmc Plinc escric
au second liurc, chapitrc huiaicsmc, on void asscz quhl nc faisoit quallegucr cn cc quc dessus
iesopinionsdcsancicns, 6cnonpasquilyadhcrast :Fythagoras Samien stt UpremierquiobseruaU
iours ddaplanette de Venm enmren la quarante-deuxiesme olymptade yqtù stt U cent quarantc-deuxiesmt
an de lafmdation de Rome. Ce qui cstoit plus dc ccnt ans aprcs le commencemcnt du regne dc
Numa. Et Ciccron tout apertcment au prcmier des Questions Tusculanes ; Cette opimon ( dc
i’immortaiité dc i’amc) confrmaprincipaUment Fythagoras dtsciplede PherecidesJequel du temps deTar-
quin le Superhe regnoità. Rome, vintcn ïtdie, &y maintintlagrande Grece engrand honntur, dtscipline&
authoriü :siqueparpluseursfiecles apresje nom des Fythagorictensstten telle vogue,qùilsemhloit nj auoir
antresgtnsdoslessiwneux. Et au quatriesmeliure. Ilsauoientla Pythagoras,homme d’vne singulicrt
sapknce & nobUJse, lequel esioiten Italie au.mcfmt temps que /unius Brutus dtliura fa patrit de la tyrannie
des Roys. Plus au second de i’Orateur à son frcre Quintus. LTtaliestt iadtsprefque toute remplte des
Fythagorkiens, dontquelques-vns ontesiimêque Numa Fompilms, L’vn dc nos Roys, auroit esié Pytbagori-
cien, Uquelnsantmoins sut plustnrs ans deuant Pythagoras, &delà onledoitreputertant plus excellentper*
Jonnage, d’auoircognu la docîrint &sapience de hien esiahlir& adminifirervn estat,presde deuxfteclespre-
mier qtte les Grecseujsent cognu quelle stst née. Ouide au troissesme des Fastes, monstrc aucune-
mentdc tenirqu ils eussent estc d’vnmesme temps : &:queNuma mcsme auroit esté disciple
dc Pychagoras.
Frtmus oliuiseris Romam deduBus ah aruis
Fompilius, menfes fenstt ahejse duos.
Siue hoc a Samio dossus, quipojse renasci
Nosputat: Egeria siue monente fua.
Plus au croissesmc de Ponto,
Framia nec Chiron ah Achïlle talia cœpit:
Fythagoraque serunt non nocmjse Numam.
Cieeron au quatricsmedes Questions Academiques, s’cfsorce de soudre ce doute,que Nii-
mz pourauoir esté appelié Pythagoricien de quelques anciens, fust par consequent posterietir
à luy : ou pour le moins contemporain : car il sc retient a son opinion dessiis-dite, 6c mctque
ce fut pour la conformité deleur dodrine, 6c lasagesse de ce Roy, toute te]le quedu Philoso»
phe qui en auroit emporté le tiltrc par dessus tous aütres : Jjuwettam arbitrorpropter Fythagorao-
rum admirationem, Numam quoque Regem Pytbagsraum â posteris exiftimatum: nam cum Fythagora dtsci*
plinam &instituta cognescerent : regsque eius œquiratcm & sapientiama maiorihus accepistent : atates au-
tem & tempora ignorarent ,proptervetustatern cum smjapientia exceileret, Fythagorx auditorem sttjse cre~
ditum.
Reste dc dirc quelque ehosc de sa do&rine : en qiîoy ie îaisse à part ses moraîes, car il n* en cst
pas icy qucstion:& parcillemcnt qu’il fut dcs premiers entre lcs Paycns qui aiserma Fimmorta-
îitc des anacs : car son preceptcur Pherecidcs auoit eu cette opinibn auant luy ; & long=temps
deuant Pherccides Homere, commeonpeutvoir toutapertementen plusseursendroitsde ses
pocsies : <s* ou ptdiap nsetftpti, ètidbç 3 Son ame stnuole hors des memhres, toutdroit és ma~
noïrs de Pluton. Et au vingt-troisiesmederiliade dc celle de Patrocle : mais plus particulicre-
ment en ronziesmede rOdyssce. Dauantage Pythagoras auroitpeu apprendre cepoinâ:-là
dcs Egyptiens,quimesmesauoient queîqueadombrement delaresurredion : 6c des Chaldées
pareillcment, où il luy fut loisible de boire à pleins trai&s de la dodrinc de Moyse, comme fit
Platon aprcs luy, dequoy font foy assez dc lieux de sa dodkrine du tout conformes aux tradi«
tions Cabaiistes des sages Hcbrioux : cetrui-cy nommément entre les autres, que Plutarque
allegueaü huidicsme des Symposiaques, question 7. de brouïller lesdrapsdesongistc aussi
tost qu’on (cra Ieuc: car cela est formellement dans le Zoar de Rabi Simeon fils de Iochairoù il
dit,que c’est pource que îes esprits immondes se dele&ent fort de la chalcur, & de la forme hu-
maine emprainte où on aura dormy la nui&,s’efForçans de tout leur pouuoir d’y atteindre & s*y
substicuer au licu des personncs : ny plus ny moins que ies valets en l’absence du maistre pren-
ncnc plaisir des’asseoirdanssachaire, 6c le contrefaire. Tellementquc quand on se leuedu
li£I, ou durant le repos de la nui&,on a peu auoir çu plusieurs cogitations 6c apprehensions im-
pures,sesprit immondc ôccoinquinantdostt cela procede, lcs Cabalistesl’appellentLilith,
trouuantlaplaee toutechaude,&:quiressentenccres lcsespritsde ccluy dontccgiste est, s’iil-
troduisant en cette forme luy peut causer beaucoup dc mauuais accidens, tant en scsprit com~
mcau corps,parvn conscntemcnt symboiisantdervnàrautre:commconpeutvoirparrex-
pericncc dc cerrain charme 6c socccllerie, qu’onpcut encloiicr vncheual fîchantvn cloud dc-
dans