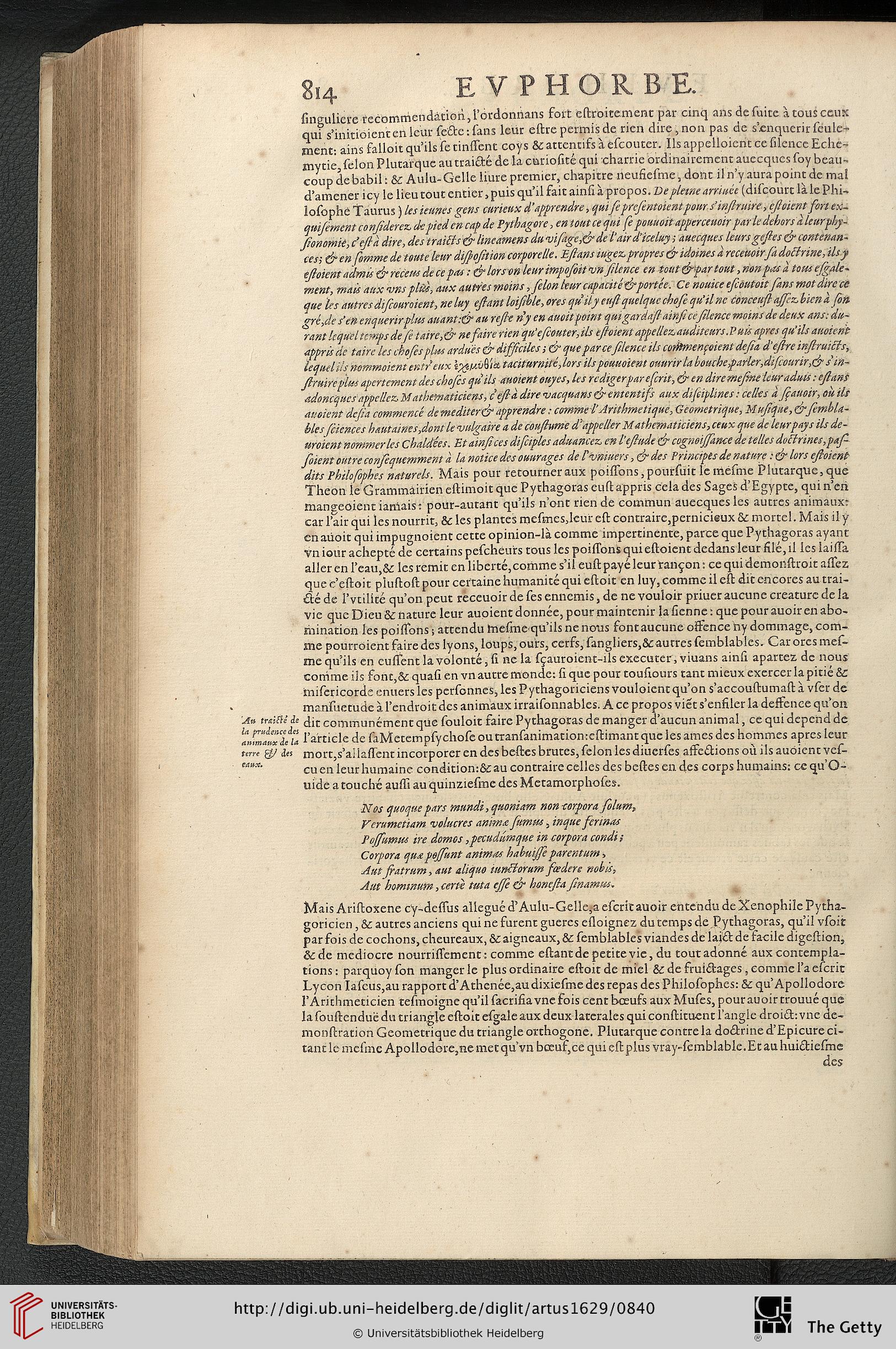814
EVPHORBE.
singulicre recommendàcion5i’ordonnans fort 'estroiccment par cinq ans desuicc atousceuK
qui s’initioiencen leur se<5te : sans leur estre perinisde rien dire5non pas de s’enquerir seule+
ment: ains falloit qu’ils se tinsîent coys &c attentifs à escouter. Us appelloient ce silence Eche-
mytie3 selon Plutarquc autraifté de la curiosité qui charrie ordinairement auecques soy beau-
coup debabil : &: Aulu-Gelle liure premier, chapitre neufiesme, dont il n’yaura point dc mal
d’amener icy le lieu tout entier,puis qu’il sait ainsi à propos. Depletnearrmée (discourt làle Phi-
losophè Tàurus ) les ieunes gens curieux d’œpprendre, quifeesrefeentoientpour sinftrmre, estoient fort ex-
cesÿ & en fomme de toute leur difeofttion corporelle. Bftans tugez,propres & idoines a receuoirfk dottrine, ilsy
estoient admis & recem de ce pus : & lors on leur imposoit vn filence en tout &par tout, nonpas a tous ejgale-
ment, mais aux vnsplùs, aux autres moins ,feelon teur capacité&portce. Ce nouice efeoutoitftirns motdire ce
que les autres difecouroient, ne luy eftant loistble, ores quily eustquelque chofte qu’il nc conceust aststz., bien à fon
gréfte s’en enqucrirplm auant:& au refte ny en auoitpowt qutgardass ainficesilcnce moins de deux ans: du~
iequelils nommoient entreux ïytjuvô/tz taciturnité, lors ilspouuoient ouurirla bouche>parler,distourir,& s in-
ftruireplm apertement deschoftcs quils auoient ouyes, les redigerparefcrit, & en dtremeftne leuraduü : estans
adoncqucs appcllez, Mathematiciens, ceftà dire vacquans & ententiss aux difeiplïnes : cclks àfeauoir, où ils
auoient dcfta commencé de mediter'& apprendre : comme lArithmetique, Geometrique, Mufeqae, &fembla-
bles fcicnces hautainesftontle vulgaire a de couftume d’appeller Mathematiciens, ceux que de Leurpays ils de-
uroient nommerles chaldées. Et ainfeces difciples aduancez, en l’eftude & cQgwiststwce de telles docLrtnes,past
foient outre confequemment à la notice des ouurages de Evmuers, & des Princtpes de mttirc : & lors estoient
dits Philofophes naturels. Mais pour retourneraux poissons, poursuit le mesme Plutarqiie, que
Theon ie Grammâirien estimoit que Pythagoras eust appris cela des Sages d’Egypte, qui n’en
mangeoient ianlais: pour-autant qu’ils n’ont riende commun auecquesies autres animaux:
car i’air qui les nourrit, &c les plantes mesmes,Ieur est contraire,pernicieux &: mortel. Mais ü y
enauoit qui impugnoient cette opinion-ià comme impertinente, parce que Pythagoras ayant
Vn iour achepté de certains pescheurs tous lcs poisTons quiestoient dedans leur fîié,îi ies iaisTa
aller en i’eau,&: lcs remit en liberté,comme s’il eustpayéleur rançon : ce qui demonstroit astez
que c’estoit pîustost pour certaine humanité qui estoit en luy, commc il est dit encores au trai-
de s vtilicé qu’on peut receuoir de ses ennemis, de ne vouioir priuer aucune creature de la
vie que Dieu &: nature leur auoient donnée, pour maintenir la sîenne : que pour auoir en abo-
mination ies poistons ; attendu tnesme qu’ils ne nous fontaucune osfence ny dommage,com-
me pourroientfairedes lyons, loups,ours, cerfs, sangliers,&:âurres semblables. Carorcsmes-
mequ’ils en eusîentlavolonté, si ne la sçauroient-ilsexecuter, viuans ainsi apartez dc nous
comme iîs font,& quasi en vnautremonde: si quc pour cousiours rant mieux exercer lapicié
misericorde enuers les personnes, les P ythagoriciens vouloient qu’on s’accoustumast à vser de
mansuetude à l’endroit dcs ammaux irraisonnables. A ce propos viêt s’enfiler ia deffence qu’on
Au traiëi ie jjj. communément qüe souioit faire Pythagoras de manger d’aucun animal, ce qui depend de
a»ima»xLu sarticle de siMetempsychoseoutransanimationrestimantquciesamesdcs hommes apresleur
terre des rnorr,s’ailastent incorporer en des bestes brutes, selon les diuerses asfedions où ils auoient ves-
cu en leur humaine condition:&au contraire celles des bcstes en des corps humains: cc qu’Q-
uide atouché austi auquinziesme des Metamorphoses.
Nos quoquepars mundi,quoniam non corpora folum,
Verumctiam volucres ammx fimm, inque scrmas
Postsumm ire domos ,pecudumque in corpora condi ;
Corpora quapestfunt animas habuijfe parentum,
Aut fratrum, aut aliquo iuncîorum sœdere nobls,
Aut hominum, cerû tuta cftfe & honefla Jmamm.
Mais Aristoxene cy-dessus alleguéd’Aulu-Gelle,aescritauoir entcndu deXenophiîe Pytha-
goricien, &: autrcs anciens qui nefurenc gueres esloignez dutempsde Pythagoras, qu’il vsoit
par fois de cochons, cheureaux, &: aigneaux, &: semblables viandes de laid de facile digestion,
&:de mediocre nourrisTement : comme estantdepetitevie, du toutadonné auxcontempia-
tions : parquoy son manger ic plus ordinaire estoir de miel &: de fruidages, comme l’a escrit
Lycon Iascus,au rapport d’Athenée,audixiesmedes repas des Philosophes: &: qu’Apollodorc
rÀrithmeticien tesmoignequ’ilsacrifiavnefois centbœufs auxMuses,pourauoirtrouuéque
la soustenduc du triangie estoit esgale aux deux laterales qui constituent sangie droid: vne de-
monstration Geometriquedu triangieorthogone. Piutarque contreia do<ftrined’Epicureci-
tant le mesîne Apollodore,ne met qu’vn bœuf,ce qui est pius vray-scmblable. Et au huidiesme
des
EVPHORBE.
singulicre recommendàcion5i’ordonnans fort 'estroiccment par cinq ans desuicc atousceuK
qui s’initioiencen leur se<5te : sans leur estre perinisde rien dire5non pas de s’enquerir seule+
ment: ains falloit qu’ils se tinsîent coys &c attentifs à escouter. Us appelloient ce silence Eche-
mytie3 selon Plutarquc autraifté de la curiosité qui charrie ordinairement auecques soy beau-
coup debabil : &: Aulu-Gelle liure premier, chapitre neufiesme, dont il n’yaura point dc mal
d’amener icy le lieu tout entier,puis qu’il sait ainsi à propos. Depletnearrmée (discourt làle Phi-
losophè Tàurus ) les ieunes gens curieux d’œpprendre, quifeesrefeentoientpour sinftrmre, estoient fort ex-
cesÿ & en fomme de toute leur difeofttion corporelle. Bftans tugez,propres & idoines a receuoirfk dottrine, ilsy
estoient admis & recem de ce pus : & lors on leur imposoit vn filence en tout &par tout, nonpas a tous ejgale-
ment, mais aux vnsplùs, aux autres moins ,feelon teur capacité&portce. Ce nouice efeoutoitftirns motdire ce
que les autres difecouroient, ne luy eftant loistble, ores quily eustquelque chofte qu’il nc conceust aststz., bien à fon
gréfte s’en enqucrirplm auant:& au refte ny en auoitpowt qutgardass ainficesilcnce moins de deux ans: du~
iequelils nommoient entreux ïytjuvô/tz taciturnité, lors ilspouuoient ouurirla bouche>parler,distourir,& s in-
ftruireplm apertement deschoftcs quils auoient ouyes, les redigerparefcrit, & en dtremeftne leuraduü : estans
adoncqucs appcllez, Mathematiciens, ceftà dire vacquans & ententiss aux difeiplïnes : cclks àfeauoir, où ils
auoient dcfta commencé de mediter'& apprendre : comme lArithmetique, Geometrique, Mufeqae, &fembla-
bles fcicnces hautainesftontle vulgaire a de couftume d’appeller Mathematiciens, ceux que de Leurpays ils de-
uroient nommerles chaldées. Et ainfeces difciples aduancez, en l’eftude & cQgwiststwce de telles docLrtnes,past
foient outre confequemment à la notice des ouurages de Evmuers, & des Princtpes de mttirc : & lors estoient
dits Philofophes naturels. Mais pour retourneraux poissons, poursuit le mesme Plutarqiie, que
Theon ie Grammâirien estimoit que Pythagoras eust appris cela des Sages d’Egypte, qui n’en
mangeoient ianlais: pour-autant qu’ils n’ont riende commun auecquesies autres animaux:
car i’air qui les nourrit, &c les plantes mesmes,Ieur est contraire,pernicieux &: mortel. Mais ü y
enauoit qui impugnoient cette opinion-ià comme impertinente, parce que Pythagoras ayant
Vn iour achepté de certains pescheurs tous lcs poisTons quiestoient dedans leur fîié,îi ies iaisTa
aller en i’eau,&: lcs remit en liberté,comme s’il eustpayéleur rançon : ce qui demonstroit astez
que c’estoit pîustost pour certaine humanité qui estoit en luy, commc il est dit encores au trai-
de s vtilicé qu’on peut receuoir de ses ennemis, de ne vouioir priuer aucune creature de la
vie que Dieu &: nature leur auoient donnée, pour maintenir la sîenne : que pour auoir en abo-
mination ies poistons ; attendu tnesme qu’ils ne nous fontaucune osfence ny dommage,com-
me pourroientfairedes lyons, loups,ours, cerfs, sangliers,&:âurres semblables. Carorcsmes-
mequ’ils en eusîentlavolonté, si ne la sçauroient-ilsexecuter, viuans ainsi apartez dc nous
comme iîs font,& quasi en vnautremonde: si quc pour cousiours rant mieux exercer lapicié
misericorde enuers les personnes, les P ythagoriciens vouloient qu’on s’accoustumast à vser de
mansuetude à l’endroit dcs ammaux irraisonnables. A ce propos viêt s’enfiler ia deffence qu’on
Au traiëi ie jjj. communément qüe souioit faire Pythagoras de manger d’aucun animal, ce qui depend de
a»ima»xLu sarticle de siMetempsychoseoutransanimationrestimantquciesamesdcs hommes apresleur
terre des rnorr,s’ailastent incorporer en des bestes brutes, selon les diuerses asfedions où ils auoient ves-
cu en leur humaine condition:&au contraire celles des bcstes en des corps humains: cc qu’Q-
uide atouché austi auquinziesme des Metamorphoses.
Nos quoquepars mundi,quoniam non corpora folum,
Verumctiam volucres ammx fimm, inque scrmas
Postsumm ire domos ,pecudumque in corpora condi ;
Corpora quapestfunt animas habuijfe parentum,
Aut fratrum, aut aliquo iuncîorum sœdere nobls,
Aut hominum, cerû tuta cftfe & honefla Jmamm.
Mais Aristoxene cy-dessus alleguéd’Aulu-Gelle,aescritauoir entcndu deXenophiîe Pytha-
goricien, &: autrcs anciens qui nefurenc gueres esloignez dutempsde Pythagoras, qu’il vsoit
par fois de cochons, cheureaux, &: aigneaux, &: semblables viandes de laid de facile digestion,
&:de mediocre nourrisTement : comme estantdepetitevie, du toutadonné auxcontempia-
tions : parquoy son manger ic plus ordinaire estoir de miel &: de fruidages, comme l’a escrit
Lycon Iascus,au rapport d’Athenée,audixiesmedes repas des Philosophes: &: qu’Apollodorc
rÀrithmeticien tesmoignequ’ilsacrifiavnefois centbœufs auxMuses,pourauoirtrouuéque
la soustenduc du triangie estoit esgale aux deux laterales qui constituent sangie droid: vne de-
monstration Geometriquedu triangieorthogone. Piutarque contreia do<ftrined’Epicureci-
tant le mesîne Apollodore,ne met qu’vn bœuf,ce qui est pius vray-scmblable. Et au huidiesme
des