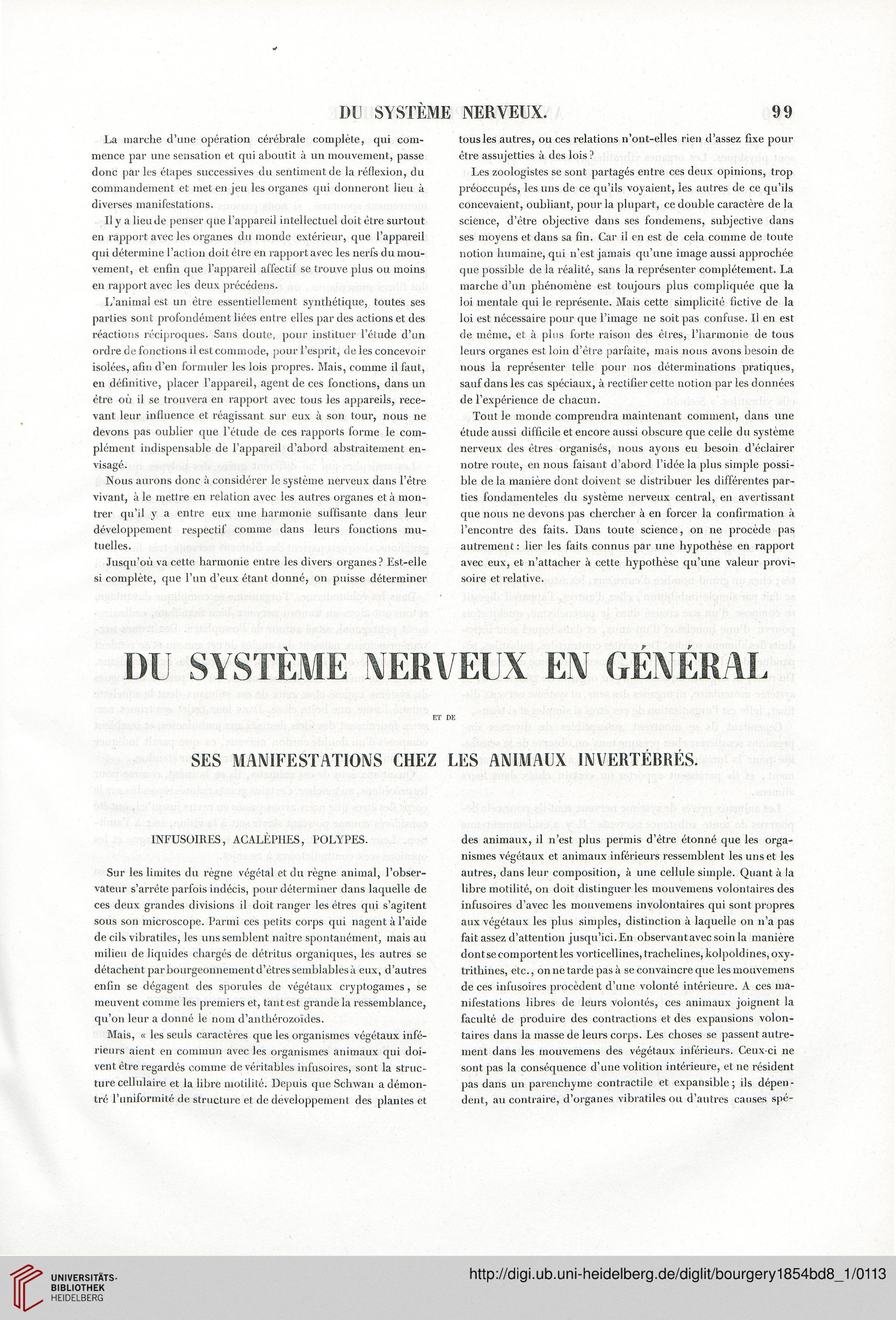JH SYSTÈME NERVEUX.
99
La inarche d'une opération cérébrale complète, qui com-
mence par une sensation et qui aboutit à un mouvement, passe
donc par les étapes successives du sentiment de la réflexion, du
commandement et met en jeu les organes qui donneront lieu à
diverses manifestations.
Il y a lieu de penser que l'appareil intellectuel doit être surtout
en rapport avec les organes du monde extérieur, que l'appareil
qui détermine l'action doit être en rapport avec les nerfs du mou-
vement, et enfin que l'appareil affectif se trouve plus ou moins
en rapport avec les deux précédens.
L'animal est un être essentiellement synthétique, toutes ses
parties sont profondément liées entre elles par des actions et des
réactions réciproques. Sans doute, pour instituer l'étude d'un
ordre de fonctions il est commode, pour l'esprit, de les concevoir
isolées, afin d'en formuler les lois propres. Mais, comme il faut,
en définitive, placer l'appareil, agent de ces fonctions, dans un
être où il se trouvera en rapport avec tous les appareils, rece-
vant leur influence et réagissant sur eux à son tour, nous ne
devons pas oublier que l'étude de ces rapports forme le com-
plément indispensable de l'appareil d'abord abstraitement en-
visagé.
Nous aurons donc à considérer le système nerveux dans l'être
vivant, à le mettre en relation avec les autres organes et à mon-
trer qu'il y a entre eux une harmonie suffisante dans leur
développement respectif comme dans leurs fonctions mu-
tuelles.
Jusqu'où va cette harmonie entre les divers organes? Est-elle
si complète, que l'un d'eux étant donné, on puisse déterminer
tous les autres, ou ces relations n'ont-elles rien d'assez fixe pour
être assujetties à des lois ?
Les zoologistes se sont partagés entre ces deux opinions, trop
préoccupés, les uns de ce qu'ils voyaient, les autres de ce qu'ils
concevaient, oubliant, pour la plupart, ce double caractère de la
science, d'être objective dans ses fondemens, subjective dans
ses movens et dans sa fin. Car il en est de cela comme de toute
notion humaine, qui n'est jamais qu'une image aussi approchée
que possible de la réalité, sans la représenter complètement. La
marche d'un phénomène est toujours plus compliquée que la
loi mentale qui le représente. Mais cette simplicité fictive de la
loi est nécessaire pour que l'image ne soit pas confuse. Il en est
de même, et à plus forte raison des êtres, l'harmonie de tous
leurs organes est loin d'être parfaite, mais nous avons besoin de
nous la représenter telle pour nos déterminations pratiques,
sauf dans les cas spéciaux, à rectifier cette notion par les données
de l'expérience de chacun.
Tout le monde comprendra maintenant comment, dans une
étude aussi difficile et encore aussi obscure que celle du système
nerveux des êtres organisés, nous ayons eu besoin d'éclairer
notre route, en nous faisant d'abord l'idée la plus simple possi-
ble de la manière dont doivent se distribuer les différentes par-
ties fondamenteles du système nerveux central, en avertissant
que nous ne devons pas chercher à en forcer la confirmation à
l'encontre des faits. Dans toute science, on ne procède pas
autrement : lier les faits connus par une hypothèse en rapport
avec eux, et n'attacher à cette hypothèse qu'une valeur provi-
soire et relative.
DU SYSTÈME NERVEUX EN GÉNÉRAL
F.T DK
SES MANIFESTATIONS CHEZ LES ANIMAUX INVERTEBRES.
INFUSOIRES, ACALÈPHES, POLYPES.
Sur les limites du règne végétal et du règne animal, l'obser-
vateur s'arrête parfois indécis, pour déterminer dans laquelle de
ces deux grandes divisions il doit ranger les êtres qui s'agitent
sous son microscope. Parmi ces petits corps qui nagent à l'aide
de cils vibratiles, les uns semblent naître spontanément, mais au
milieu de liquides chargés de détritus organiques, les autres se
détachent par bourgeonnement d'êtres semblables à eux, d'autres
enfin se dégagent des sporules de végétaux cryptogames, se
meuvent comme les premiers et, tant est grande la ressemblance,
qu'on leur a donné le nom d'anthérozoïdes.
Mais, « les seuls caractères que les organismes végétaux infé-
rieurs aient en commun avec les organismes animaux qui doi-
vent être regardés comme de véritables infusoires, sont la struc-
ture cellulaire et la libre motilité. Depuis que Schwan a démon-
tré l'uniformité de structure et de développement des plantes et
des animaux, il n'est plus permis d'être étonné que les orga-
nismes végétaux et animaux inférieurs ressemblent les uns et les
autres, dans leur composition, à une cellule simple. Quant à la
libre motilité, on doit distinguer les rnouvemens volontaires des
infusoires d'avec les rnouvemens involontaires qui sont propres
aux végétaux les plus simples, distinction à laquelle on n'a pas
fait assez d'attention jusqu'ici. En observant avec soin la manière
dont se c omportent les vorticellines, trachelines, kolpoldines, oxy-
trithines, etc., on ne tarde pas à se convaincre que les rnouvemens
de ces infusoires procèdent d'une volonté intérieure. A ces ma-
nifestations libres de leurs volontés, ces animaux joignent la
faculté de produire des contractions et des expansions volon-
taires dans la masse de leurs corps. Les choses se passent autre-
ment dans les rnouvemens des végétaux inférieurs. Ceux-ci ne
sont pas la conséquence d'une volition intérieure, et ne résident
pas dans un parenchyme contractile et expansible; ils dépen-
dent, au contraire, d'organes vibratiles ou d'autres causes spé-
99
La inarche d'une opération cérébrale complète, qui com-
mence par une sensation et qui aboutit à un mouvement, passe
donc par les étapes successives du sentiment de la réflexion, du
commandement et met en jeu les organes qui donneront lieu à
diverses manifestations.
Il y a lieu de penser que l'appareil intellectuel doit être surtout
en rapport avec les organes du monde extérieur, que l'appareil
qui détermine l'action doit être en rapport avec les nerfs du mou-
vement, et enfin que l'appareil affectif se trouve plus ou moins
en rapport avec les deux précédens.
L'animal est un être essentiellement synthétique, toutes ses
parties sont profondément liées entre elles par des actions et des
réactions réciproques. Sans doute, pour instituer l'étude d'un
ordre de fonctions il est commode, pour l'esprit, de les concevoir
isolées, afin d'en formuler les lois propres. Mais, comme il faut,
en définitive, placer l'appareil, agent de ces fonctions, dans un
être où il se trouvera en rapport avec tous les appareils, rece-
vant leur influence et réagissant sur eux à son tour, nous ne
devons pas oublier que l'étude de ces rapports forme le com-
plément indispensable de l'appareil d'abord abstraitement en-
visagé.
Nous aurons donc à considérer le système nerveux dans l'être
vivant, à le mettre en relation avec les autres organes et à mon-
trer qu'il y a entre eux une harmonie suffisante dans leur
développement respectif comme dans leurs fonctions mu-
tuelles.
Jusqu'où va cette harmonie entre les divers organes? Est-elle
si complète, que l'un d'eux étant donné, on puisse déterminer
tous les autres, ou ces relations n'ont-elles rien d'assez fixe pour
être assujetties à des lois ?
Les zoologistes se sont partagés entre ces deux opinions, trop
préoccupés, les uns de ce qu'ils voyaient, les autres de ce qu'ils
concevaient, oubliant, pour la plupart, ce double caractère de la
science, d'être objective dans ses fondemens, subjective dans
ses movens et dans sa fin. Car il en est de cela comme de toute
notion humaine, qui n'est jamais qu'une image aussi approchée
que possible de la réalité, sans la représenter complètement. La
marche d'un phénomène est toujours plus compliquée que la
loi mentale qui le représente. Mais cette simplicité fictive de la
loi est nécessaire pour que l'image ne soit pas confuse. Il en est
de même, et à plus forte raison des êtres, l'harmonie de tous
leurs organes est loin d'être parfaite, mais nous avons besoin de
nous la représenter telle pour nos déterminations pratiques,
sauf dans les cas spéciaux, à rectifier cette notion par les données
de l'expérience de chacun.
Tout le monde comprendra maintenant comment, dans une
étude aussi difficile et encore aussi obscure que celle du système
nerveux des êtres organisés, nous ayons eu besoin d'éclairer
notre route, en nous faisant d'abord l'idée la plus simple possi-
ble de la manière dont doivent se distribuer les différentes par-
ties fondamenteles du système nerveux central, en avertissant
que nous ne devons pas chercher à en forcer la confirmation à
l'encontre des faits. Dans toute science, on ne procède pas
autrement : lier les faits connus par une hypothèse en rapport
avec eux, et n'attacher à cette hypothèse qu'une valeur provi-
soire et relative.
DU SYSTÈME NERVEUX EN GÉNÉRAL
F.T DK
SES MANIFESTATIONS CHEZ LES ANIMAUX INVERTEBRES.
INFUSOIRES, ACALÈPHES, POLYPES.
Sur les limites du règne végétal et du règne animal, l'obser-
vateur s'arrête parfois indécis, pour déterminer dans laquelle de
ces deux grandes divisions il doit ranger les êtres qui s'agitent
sous son microscope. Parmi ces petits corps qui nagent à l'aide
de cils vibratiles, les uns semblent naître spontanément, mais au
milieu de liquides chargés de détritus organiques, les autres se
détachent par bourgeonnement d'êtres semblables à eux, d'autres
enfin se dégagent des sporules de végétaux cryptogames, se
meuvent comme les premiers et, tant est grande la ressemblance,
qu'on leur a donné le nom d'anthérozoïdes.
Mais, « les seuls caractères que les organismes végétaux infé-
rieurs aient en commun avec les organismes animaux qui doi-
vent être regardés comme de véritables infusoires, sont la struc-
ture cellulaire et la libre motilité. Depuis que Schwan a démon-
tré l'uniformité de structure et de développement des plantes et
des animaux, il n'est plus permis d'être étonné que les orga-
nismes végétaux et animaux inférieurs ressemblent les uns et les
autres, dans leur composition, à une cellule simple. Quant à la
libre motilité, on doit distinguer les rnouvemens volontaires des
infusoires d'avec les rnouvemens involontaires qui sont propres
aux végétaux les plus simples, distinction à laquelle on n'a pas
fait assez d'attention jusqu'ici. En observant avec soin la manière
dont se c omportent les vorticellines, trachelines, kolpoldines, oxy-
trithines, etc., on ne tarde pas à se convaincre que les rnouvemens
de ces infusoires procèdent d'une volonté intérieure. A ces ma-
nifestations libres de leurs volontés, ces animaux joignent la
faculté de produire des contractions et des expansions volon-
taires dans la masse de leurs corps. Les choses se passent autre-
ment dans les rnouvemens des végétaux inférieurs. Ceux-ci ne
sont pas la conséquence d'une volition intérieure, et ne résident
pas dans un parenchyme contractile et expansible; ils dépen-
dent, au contraire, d'organes vibratiles ou d'autres causes spé-