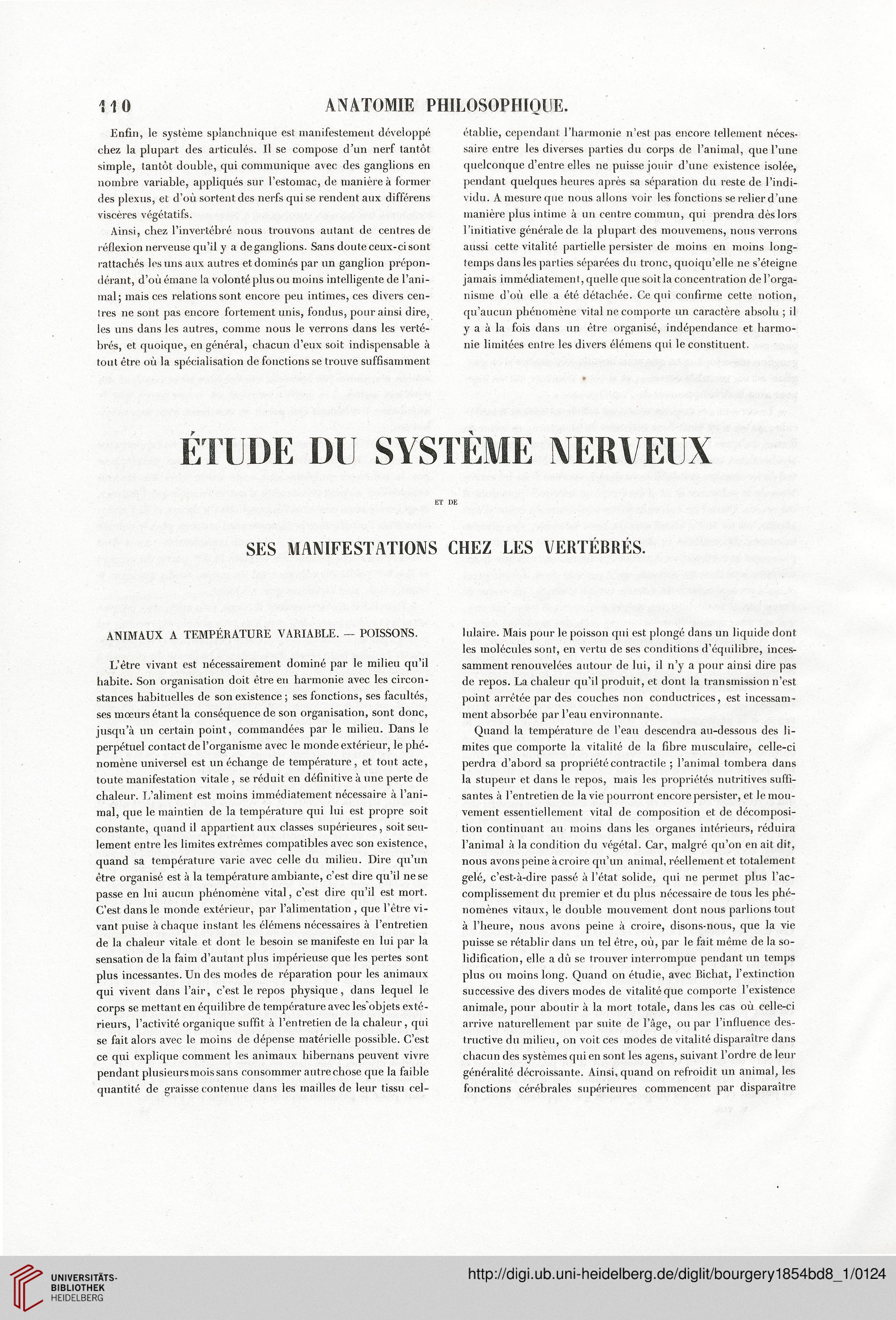110
ANATOMIE PHILOSOPHIQUE.
Enfin, le système splanchnique est manifestement développé
chez la plupart des articulés. Il se compose d'un nerf tantôt
simple, tantôt double, qui communique avec des ganglions en
nombre variable, appliqués sur l'estomac, de manière à former
des plexus, et d'où sortent des nerfs qui se rendent aux différens
viscères végétatifs.
Ainsi, chez l'invertébré nous trouvons autant de centres de
réflexion nerveuse qu'il y a de ganglions. Sans doute ceux-ci sont
rattachés les lins aux autres et dominés par un ganglion prépon-
dérant, d'où émane la volonté plus ou moins intelligente de l'ani-
mal; mais ces relations sont encore peu intimes, ces divers cen-
Ires ne sont pas encore fortement unis, fondus, pour ainsi dire,
les uns dans les autres, comme nous le verrons dans les verté-
brés, et quoique, en général, chacun d'eux soit indispensable à
tout être où la spécialisation de fonctions se trouve suffisamment
établie, cependant l'harmonie n'est pas encore tellement néces-
saire entre les diverses parties du corps de l'animal, que l'une
quelconque d'entre elles ne puisse jouir d'une existence isolée,
pendant quelques heures après sa séparation du reste de l'indi-
vidu. A mesure que nous allons voir les fonctions se relier d'une
manière plus intime à un centre commun, qui prendra dès lors
l'initiative générale de la plupart des mouvemens, nous verrons
aussi cette vitalité partielle persister de moins en moins long-
temps dans les parties séparées du tronc, quoiqu'elle ne s'éteigne
jamais immédiatement, quelle que soit la concentration de l'orga-
nisme d'où elle a été détachée. Ce qui confirme cette notion,
qu'aucun phénomène vital ne comporte un caractère absolu ; il
y a à la fois dans un être organisé, indépendance et harmo-
nie limitées entre les divers élémens qui le constituent.
ETUDE DU SYSTEME NERVEUX
ET DE
SES MANIFESTATIONS CHEZ LES VERTÉBRÉS.
ANIMAUX A TEMPÉRATURE VARIARLE. — POISSONS.
L'être vivant est nécessairement dominé par le milieu qu'il
habite. Son organisation doit être en harmonie avec les circon-
stances habituelles de son existence ; ses fonctions, ses facultés,
ses moeurs étant la conséquence de son organisation, sont donc,
jusqu'à un certain point, commandées par le milieu. Dans le
perpétuel contact de l'organisme avec le monde extérieur, le phé-
nomène universel est un échange de température, et tout acte,
toute manifestation vitale , se réduit en définitive à une perte de
chaleur. L'aliment est moins immédiatement nécessaire à l'ani-
mal, que le maintien de la température qui lui est propre soit
constante, quand il appartient aux classes supérieures, soit seu-
lement entre les limites extrêmes compatibles avec son existence,
quand sa température varie avec celle du milieu. Dire qu'un
être organisé est à la température ambiante, c'est dire qu'il ne se
passe en lui aucun phénomène vital, c'est dire qu'il est mort.
C'est dans le monde extérieur, par l'alimentation , que l'être vi-
vant puise à chaque instant les élémens nécessaires à l'entretien
de la chaleur vitale et dont le besoin se manifeste en lui par la
sensation de la faim d'autant plus impérieuse que les pertes sont
plus incessantes. Un des modes de réparation pour les animaux
qui vivent dans l'air, c'est le repos physique, dans lequel le
corps se mettant en équilibre de température avec les'objets exté-
rieurs, l'activité organique suffit à l'entretien de la chaleur, qui
se fait alors avec le moins de dépense matérielle possible. C'est
ce qui explique comment les animaux hibernans peuvent vivre
pendant plusieurs mois sans consommer autre chose que la faible
quantité de graisse contenue clans les mailles de leur tissu cel-
lulaire. Mais pour le poisson qui est plongé dans un liquide dont
les molécules sont, en vertu de ses conditions d'équilibre, inces-
samment renouvelées autour de lui, il n'y a pour ainsi dire pas
de repos. La chaleur qu'il produit, et dont la transmission n'est
point arrêtée par des couches non conductrices, est incessam-
ment absorbée par l'eau environnante.
Quand la température de l'eau descendra au-dessous des li-
mites que comporte la vitalité de la fibre musculaire, celle-ci
perdra d'abord sa propriété contractile ; l'animal tombera dans
la stupeur et dans le repos, mais les propriétés nutritives suffi-
santes à l'entretien de la vie pourront encore persister, et le mou-
vement essentiellement vital de composition et de décomposi-
tion continuant au moins dans les organes intérieurs, réduira
l'animal à la condition du végétal. Car, malgré qu'on en ait dit,
nous avons peine à croire qu'un animal, réellement et totalement
gelé, c'est-à-dire passé à l'état solide, qui ne permet plus l'ac-
complissement du premier et du plus nécessaire de tous les phé-
nomènes vitaux, le double mouvement dont nous parlions tout
à l'heure, nous avons peine à croire, disons-nous, que la vie
puisse se rétablir dans un tel être, où, par le fait même de la so-
lidification, elle a dû se trouver interrompue pendant un temps
plus ou moins long. Quand on étudie, avec Richat, l'extinction
successive des divers modes de vitalité que comporte l'existence
animale, pour aboutir à la mort totale, dans les cas où celle-ci
arrive naturellement par suite de l'âge, ou par l'influence des-
tructive du milieu, on voit ces modes de vitalité disparaître dans
chacun des systèmes qui en sont les agens, suivant l'ordre de leur
généralité décroissante. Ainsi, quand on refroidit un animal, les
fonctions cérébrales supérieures commencent par disparaître
ANATOMIE PHILOSOPHIQUE.
Enfin, le système splanchnique est manifestement développé
chez la plupart des articulés. Il se compose d'un nerf tantôt
simple, tantôt double, qui communique avec des ganglions en
nombre variable, appliqués sur l'estomac, de manière à former
des plexus, et d'où sortent des nerfs qui se rendent aux différens
viscères végétatifs.
Ainsi, chez l'invertébré nous trouvons autant de centres de
réflexion nerveuse qu'il y a de ganglions. Sans doute ceux-ci sont
rattachés les lins aux autres et dominés par un ganglion prépon-
dérant, d'où émane la volonté plus ou moins intelligente de l'ani-
mal; mais ces relations sont encore peu intimes, ces divers cen-
Ires ne sont pas encore fortement unis, fondus, pour ainsi dire,
les uns dans les autres, comme nous le verrons dans les verté-
brés, et quoique, en général, chacun d'eux soit indispensable à
tout être où la spécialisation de fonctions se trouve suffisamment
établie, cependant l'harmonie n'est pas encore tellement néces-
saire entre les diverses parties du corps de l'animal, que l'une
quelconque d'entre elles ne puisse jouir d'une existence isolée,
pendant quelques heures après sa séparation du reste de l'indi-
vidu. A mesure que nous allons voir les fonctions se relier d'une
manière plus intime à un centre commun, qui prendra dès lors
l'initiative générale de la plupart des mouvemens, nous verrons
aussi cette vitalité partielle persister de moins en moins long-
temps dans les parties séparées du tronc, quoiqu'elle ne s'éteigne
jamais immédiatement, quelle que soit la concentration de l'orga-
nisme d'où elle a été détachée. Ce qui confirme cette notion,
qu'aucun phénomène vital ne comporte un caractère absolu ; il
y a à la fois dans un être organisé, indépendance et harmo-
nie limitées entre les divers élémens qui le constituent.
ETUDE DU SYSTEME NERVEUX
ET DE
SES MANIFESTATIONS CHEZ LES VERTÉBRÉS.
ANIMAUX A TEMPÉRATURE VARIARLE. — POISSONS.
L'être vivant est nécessairement dominé par le milieu qu'il
habite. Son organisation doit être en harmonie avec les circon-
stances habituelles de son existence ; ses fonctions, ses facultés,
ses moeurs étant la conséquence de son organisation, sont donc,
jusqu'à un certain point, commandées par le milieu. Dans le
perpétuel contact de l'organisme avec le monde extérieur, le phé-
nomène universel est un échange de température, et tout acte,
toute manifestation vitale , se réduit en définitive à une perte de
chaleur. L'aliment est moins immédiatement nécessaire à l'ani-
mal, que le maintien de la température qui lui est propre soit
constante, quand il appartient aux classes supérieures, soit seu-
lement entre les limites extrêmes compatibles avec son existence,
quand sa température varie avec celle du milieu. Dire qu'un
être organisé est à la température ambiante, c'est dire qu'il ne se
passe en lui aucun phénomène vital, c'est dire qu'il est mort.
C'est dans le monde extérieur, par l'alimentation , que l'être vi-
vant puise à chaque instant les élémens nécessaires à l'entretien
de la chaleur vitale et dont le besoin se manifeste en lui par la
sensation de la faim d'autant plus impérieuse que les pertes sont
plus incessantes. Un des modes de réparation pour les animaux
qui vivent dans l'air, c'est le repos physique, dans lequel le
corps se mettant en équilibre de température avec les'objets exté-
rieurs, l'activité organique suffit à l'entretien de la chaleur, qui
se fait alors avec le moins de dépense matérielle possible. C'est
ce qui explique comment les animaux hibernans peuvent vivre
pendant plusieurs mois sans consommer autre chose que la faible
quantité de graisse contenue clans les mailles de leur tissu cel-
lulaire. Mais pour le poisson qui est plongé dans un liquide dont
les molécules sont, en vertu de ses conditions d'équilibre, inces-
samment renouvelées autour de lui, il n'y a pour ainsi dire pas
de repos. La chaleur qu'il produit, et dont la transmission n'est
point arrêtée par des couches non conductrices, est incessam-
ment absorbée par l'eau environnante.
Quand la température de l'eau descendra au-dessous des li-
mites que comporte la vitalité de la fibre musculaire, celle-ci
perdra d'abord sa propriété contractile ; l'animal tombera dans
la stupeur et dans le repos, mais les propriétés nutritives suffi-
santes à l'entretien de la vie pourront encore persister, et le mou-
vement essentiellement vital de composition et de décomposi-
tion continuant au moins dans les organes intérieurs, réduira
l'animal à la condition du végétal. Car, malgré qu'on en ait dit,
nous avons peine à croire qu'un animal, réellement et totalement
gelé, c'est-à-dire passé à l'état solide, qui ne permet plus l'ac-
complissement du premier et du plus nécessaire de tous les phé-
nomènes vitaux, le double mouvement dont nous parlions tout
à l'heure, nous avons peine à croire, disons-nous, que la vie
puisse se rétablir dans un tel être, où, par le fait même de la so-
lidification, elle a dû se trouver interrompue pendant un temps
plus ou moins long. Quand on étudie, avec Richat, l'extinction
successive des divers modes de vitalité que comporte l'existence
animale, pour aboutir à la mort totale, dans les cas où celle-ci
arrive naturellement par suite de l'âge, ou par l'influence des-
tructive du milieu, on voit ces modes de vitalité disparaître dans
chacun des systèmes qui en sont les agens, suivant l'ordre de leur
généralité décroissante. Ainsi, quand on refroidit un animal, les
fonctions cérébrales supérieures commencent par disparaître