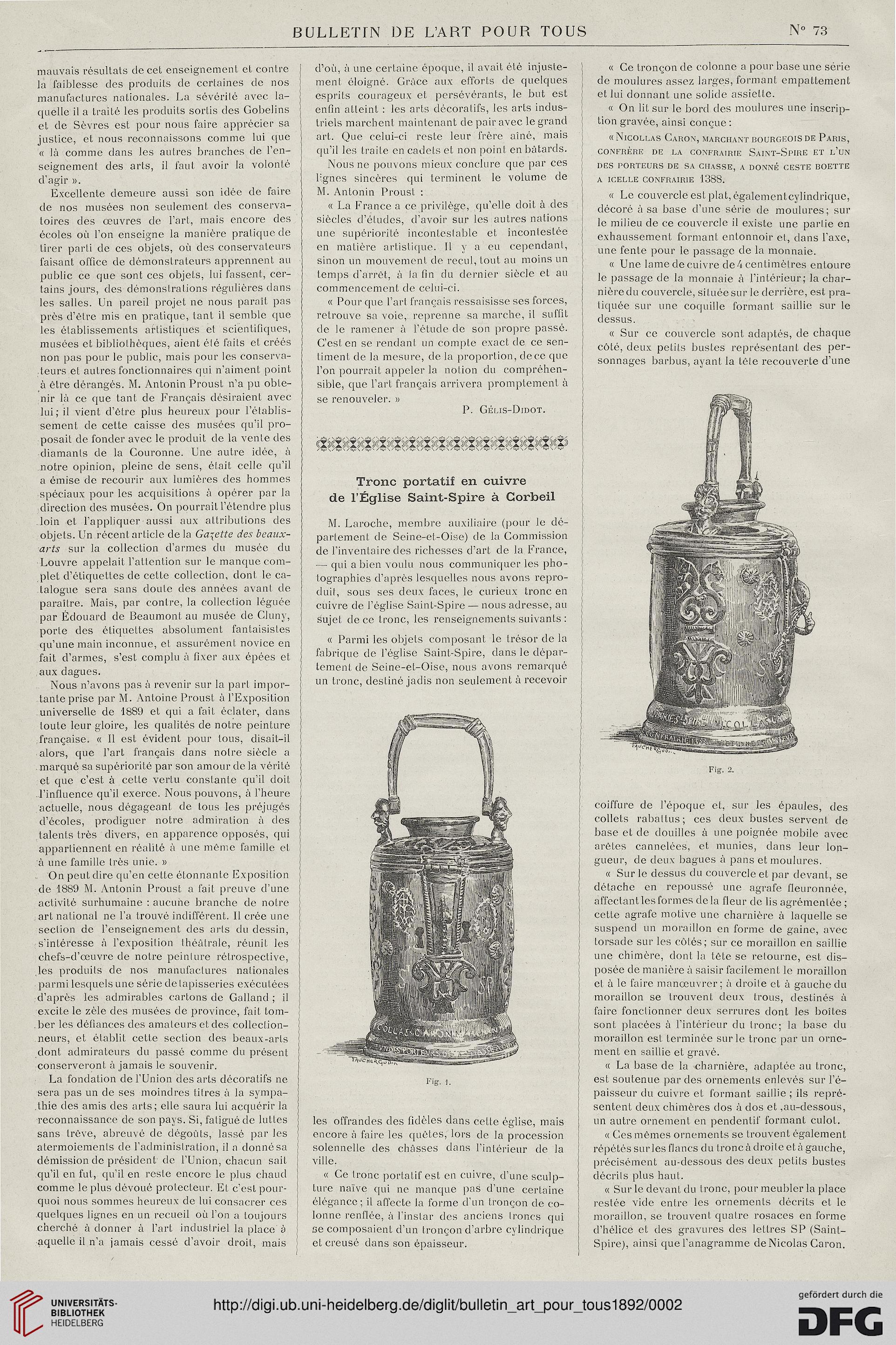BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
N° 73
mauvais résultats de cet enseignement et contre I
la faiblesse des produits de certaines de nos
manufactures nationales. La sévérité avec la-
quelle il a traité les produits sortis des Gobelins
et de Sèvres est pour nous faire apprécier sa
justice, et nous reconnaissons comme lui que
« là comme dans les autres branches de l'en-
seignement des arts, il faut avoir la volonté
d'agir ».
Excellente demeure aussi son idée de faire
de nos musées non seulement des conserva-
toires des œuvres de l'art, mais encore des
écoles où l'on enseigne la manière pratique de
tirer parti de ces objets, où des conservateurs
faisant office de démonstrateurs apprennent au
public ce que sont ces objets, lui fassent, cer-
tains jours, des démonslrations régulières clans
les salles. Un pareil projet ne nous paraît pas
près d'être mis en pratique, tant il semble que
les établissements artistiques et scientifiques,
musées et bibliothèques, aient élé faits et créés
non pas pour le public, mais pour les conserva-
teurs et autres fonctionnaires qui n'aiment point
à être dérangés. M. Antonin Proust n'a pu obte-
nir là ce que tant de Français désiraient avec
lui; il vient d'être plus heureux pour l'établis-
sement de cette caisse des musées qu'il pro-
posait de fonder avec le produit de la vente des
diamants de la Couronne. Une autre idée, à
notre opinion, pleine de sens, était celle qu'il
a émise de recourir aux lumières des hommes
spéciaux pour les acquisitions à opérer par la
direction des musées. On pourrait l'étendre plus
loin et l'appliquer aussi aux attributions des
objets. Un récent article de la Galette des beaux-
arts sur la collection d'armes du musée du
Louvre appelait l'attention sur le manque com-
plet d'étiquettes de cette collection, dont le ca-
talogue sera sans doute des années avant de
paraître. Mais, par contre, la collection léguée
par Edouard de Beaumont au musée de Cluny,
porle des étiquettes absolument fantaisistes
qu'une main inconnue, et assurément novice en
fait d'armes, s'est complu à fixer aux épées et
aux dagues.
Nous n'avons pas à revenir sur la part impor-
tante prise par M. Antoine Proust à l'Exposition
universelle de 1889 et qui a fait éclater, dans
toute leur gloire, les qualités de notre peinture
française. « Il est évident pour tous, disait-il
alors, que l'art français dans notre siècle a
. marqué sa supériorité par son amour de la vérité
et que c'est à cette vertu constante qu'il doit
l'influence qu'il exerce. Nous pouvons, à l'heure
actuelle, nous dégageant de tous les préjugés
d'écoles, prodiguer notre admiration à des
talents très divers, en apparence opposés, qui
appartiennent en réalité à une même famille et
à une famille très unie. »
On peut dire qu'en cette étonnante Exposition
de 1889 M. Antonin Proust a fait preuve d'une
activité surhumaine : aucune branche de notre
. art national ne l'a trouvé indifférent. Il crée une
section de l'enseignement des arts du dessin,
s'intéresse à l'exposition théâtrale, réunit les
chefs-d'œuvre de notre peinture rétrospective,
les produits de nos manufactures nationales
parmi lesquels une série de tapisseries exécutées
d'après les admirables cartons de Galland ; il
excite le zèle des musées de province, fait tom-
, ber les défiances des amateurs et des collection-
neurs, et établit cette section des beaux-arts
dont admirateurs du passé comme du présent
conserveront à jamais le souvenir.
La fondation de l'Union des arts décoratifs ne
sera pas un de ses moindres titres à la sympa-
thie des amis des arts; elle saura lui acquérir la
reconnaissance de son pays. Si, fatigué de luttes
sans trêve, abreuvé de dégoûts, lassé par les
atermoiements de l'administration, il a donné sa
démission de président de l'Union, chacun sait
qu'il en fut, qu'il en reste encore le plus chaud
comme le plus dévoué protecteur. Et c'est pour-
quoi nous sommes heureux de lui consacrer ces
quelques lignes en un recueil où l'on a toujours
cherché à donner à l'art industriel la place à
aquelle il n'a jamais cessé d'avoir droit, mais
d'où, à une certaine époque, il avait élé injuste-
ment éloigné. Grâce aux efforts de quelques
esprits courageux et persévérants, le but est
enfin atteint : les arts décoratifs, les arts indus-
triels marchent maintenant de pair avec le grand
art. Que celui-ci reste leur frère aîné, mais
qu'il les traite en cadets et non point en bâtards.
Nous ne pouvons mieux conclure que par ces
lignes sincères qui terminent le volume de
M. Antonin Proust :
« La France a ce privilège, qu'elle doit à des
siècles d'études, d'avoir sur les autres nations
une supériorité incontestable et incontestée
en matière artistique. Il y a eu cependant,
sinon un mouvement de recul, tout au moins un
temps d'arrêt, à ta fin du dernier siècle et au
commencement de celui-ci.
« Pour que l'art français ressaisisse ses forces,
retrouve sa voie, reprenne sa marche, il suffit
de le ramener à l'étude de son propre passé.
C'est en se rendant un compte exact de ce sen-
timent de la mesure, de la proportion, de ce que
l'on pourrait appeler la notion du compréhen-
sible, que l'art français arrivera promptement à
se renouveler. »
P. Gélis-Didot.
Tronc portatif en cuivre
de l'Église Saint-Spire à Gorbeil
M. Laroche, membre auxiliaire (pour le dé-
partement de Seine-el-Oise) de la Commission
de l'inventaire des richesses d'art de la France,
— qui a bien voulu nous communiquer les pho-
tographies d'après lesquelles nous avons repro-
duit, sous ses deux faces, le curieux tronc en
cuivre de l'église Saint-Spire — nous adresse, au
sujet de ce tronc, les renseignements suivants :
« Parmi les objets composant le trésor de la
fabrique de l'église Saint-Spire, dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise, nous avons remarque
un tronc, destiné jadis non seulement à recevoir
Fig. i.
les offrandes des fidèles dans cette église, mais
encore à faire les quêtes, lors de la procession
solennelle des châsses dans l'intérieur de la
ville.
« Ce tronc portatif est en cuivre, d'une sculp-
ture naïve qui ne manque pas d'une certaine
élégance; il affecte la forme d'un tronçon de co-
lonne renflée, à l'instar des anciens troncs qui
se composaient d'un tronçon d'arbre cylindrique
et creusé dans son épaisseur.
« Ce tronçon de colonne a pour base une série
de moulures assez larges, formant empattement
et lui donnant une solide assiette.
« On lit sur le bord des moulures une inscrip-
| tion gravée, ainsi conçue :
«Nicollas Caron, marchantrourgeois de Paris,
j confrère de la confra1rie SaINT-SpIRE et l'un
des porteurs de sa chasse, a donné geste doette
i a icelle confrairie 1388.
« Le couvercle est plat, égalementcylindrique,
décoré à sa base d'une série de moulures; sur
le milieu de ce couvercle il existe une partie en
exhaussement formant entonnoir et, dans l'axe,
une fente pour le passage de la monnaie.
« Une lame de cuivre de 4 centimètres entoure
le passage de la monnaie à l'intérieur; la char-
nière du couvercle, située sur le derrière, est pra-
tiquée sur une coquille formant saillie sur le
dessus.
« Sur ce couvercle sont adaptés, de chaque
côté, deux petits bustes représentant des per-
sonnages barbus, ayant la tôle recouverte d'une
Ftg. 2.
coiffure de l'époque et, sur les épaules, des
collets rabaltus; ces deux bustes servent de
base et de douilles à une poignée mobile avec
arêtes cannelées, et munies, dans leur lon-
gueur, de deux bagues à pans et moulures.
« Sur le dessus du couvercle et par devant, se
détache en repoussé une agrafe fleuronnée,
affectant les formes delà fleur de lis agrémentée ;
cette agrafe motive une charnière à laquelle se
suspend un moraillon en forme de gaine, avec
torsade sur les côtés; sur ce moraillon en saillie
une chimère, dont la tète se retourne, est dis-
posée de manière à saisir facilement le moraillon
et à le faire manœuvrer; à droite et à gauche du
moraillon se trouvent deux trous, destinés à
faire fonctionner deux serrures dont les boîtes
sont placées à l'intérieur du tronc; la base du
moraillon est terminée sur le tronc par un orne-
ment en saillie et gravé.
« La base de la charnière, adaptée au tronc,
est soutenue par des ornements enlevés sur l'é-
paisseur du cuivre et formant saillie ; ils repré-
sentent deux chimères dos à dos et,au-dessous,
un autre ornement en pendentif formant culot.
« Ces mêmes ornements se trouvent également
répétés sur les flancs du troncàdroileetàgauche,
précisément au-dessous des deux petits bustes
décrits plus haut.
« Sur le devant du tronc, pour meubler la place
restée vide entre les ornements décrits et le
moraillon, se trouvent quatre rosaces en forme
d'hélice et des gravures des lettres SP (Saint-
Spire), ainsi que l'anagramme de Nicolas Caron.
N° 73
mauvais résultats de cet enseignement et contre I
la faiblesse des produits de certaines de nos
manufactures nationales. La sévérité avec la-
quelle il a traité les produits sortis des Gobelins
et de Sèvres est pour nous faire apprécier sa
justice, et nous reconnaissons comme lui que
« là comme dans les autres branches de l'en-
seignement des arts, il faut avoir la volonté
d'agir ».
Excellente demeure aussi son idée de faire
de nos musées non seulement des conserva-
toires des œuvres de l'art, mais encore des
écoles où l'on enseigne la manière pratique de
tirer parti de ces objets, où des conservateurs
faisant office de démonstrateurs apprennent au
public ce que sont ces objets, lui fassent, cer-
tains jours, des démonslrations régulières clans
les salles. Un pareil projet ne nous paraît pas
près d'être mis en pratique, tant il semble que
les établissements artistiques et scientifiques,
musées et bibliothèques, aient élé faits et créés
non pas pour le public, mais pour les conserva-
teurs et autres fonctionnaires qui n'aiment point
à être dérangés. M. Antonin Proust n'a pu obte-
nir là ce que tant de Français désiraient avec
lui; il vient d'être plus heureux pour l'établis-
sement de cette caisse des musées qu'il pro-
posait de fonder avec le produit de la vente des
diamants de la Couronne. Une autre idée, à
notre opinion, pleine de sens, était celle qu'il
a émise de recourir aux lumières des hommes
spéciaux pour les acquisitions à opérer par la
direction des musées. On pourrait l'étendre plus
loin et l'appliquer aussi aux attributions des
objets. Un récent article de la Galette des beaux-
arts sur la collection d'armes du musée du
Louvre appelait l'attention sur le manque com-
plet d'étiquettes de cette collection, dont le ca-
talogue sera sans doute des années avant de
paraître. Mais, par contre, la collection léguée
par Edouard de Beaumont au musée de Cluny,
porle des étiquettes absolument fantaisistes
qu'une main inconnue, et assurément novice en
fait d'armes, s'est complu à fixer aux épées et
aux dagues.
Nous n'avons pas à revenir sur la part impor-
tante prise par M. Antoine Proust à l'Exposition
universelle de 1889 et qui a fait éclater, dans
toute leur gloire, les qualités de notre peinture
française. « Il est évident pour tous, disait-il
alors, que l'art français dans notre siècle a
. marqué sa supériorité par son amour de la vérité
et que c'est à cette vertu constante qu'il doit
l'influence qu'il exerce. Nous pouvons, à l'heure
actuelle, nous dégageant de tous les préjugés
d'écoles, prodiguer notre admiration à des
talents très divers, en apparence opposés, qui
appartiennent en réalité à une même famille et
à une famille très unie. »
On peut dire qu'en cette étonnante Exposition
de 1889 M. Antonin Proust a fait preuve d'une
activité surhumaine : aucune branche de notre
. art national ne l'a trouvé indifférent. Il crée une
section de l'enseignement des arts du dessin,
s'intéresse à l'exposition théâtrale, réunit les
chefs-d'œuvre de notre peinture rétrospective,
les produits de nos manufactures nationales
parmi lesquels une série de tapisseries exécutées
d'après les admirables cartons de Galland ; il
excite le zèle des musées de province, fait tom-
, ber les défiances des amateurs et des collection-
neurs, et établit cette section des beaux-arts
dont admirateurs du passé comme du présent
conserveront à jamais le souvenir.
La fondation de l'Union des arts décoratifs ne
sera pas un de ses moindres titres à la sympa-
thie des amis des arts; elle saura lui acquérir la
reconnaissance de son pays. Si, fatigué de luttes
sans trêve, abreuvé de dégoûts, lassé par les
atermoiements de l'administration, il a donné sa
démission de président de l'Union, chacun sait
qu'il en fut, qu'il en reste encore le plus chaud
comme le plus dévoué protecteur. Et c'est pour-
quoi nous sommes heureux de lui consacrer ces
quelques lignes en un recueil où l'on a toujours
cherché à donner à l'art industriel la place à
aquelle il n'a jamais cessé d'avoir droit, mais
d'où, à une certaine époque, il avait élé injuste-
ment éloigné. Grâce aux efforts de quelques
esprits courageux et persévérants, le but est
enfin atteint : les arts décoratifs, les arts indus-
triels marchent maintenant de pair avec le grand
art. Que celui-ci reste leur frère aîné, mais
qu'il les traite en cadets et non point en bâtards.
Nous ne pouvons mieux conclure que par ces
lignes sincères qui terminent le volume de
M. Antonin Proust :
« La France a ce privilège, qu'elle doit à des
siècles d'études, d'avoir sur les autres nations
une supériorité incontestable et incontestée
en matière artistique. Il y a eu cependant,
sinon un mouvement de recul, tout au moins un
temps d'arrêt, à ta fin du dernier siècle et au
commencement de celui-ci.
« Pour que l'art français ressaisisse ses forces,
retrouve sa voie, reprenne sa marche, il suffit
de le ramener à l'étude de son propre passé.
C'est en se rendant un compte exact de ce sen-
timent de la mesure, de la proportion, de ce que
l'on pourrait appeler la notion du compréhen-
sible, que l'art français arrivera promptement à
se renouveler. »
P. Gélis-Didot.
Tronc portatif en cuivre
de l'Église Saint-Spire à Gorbeil
M. Laroche, membre auxiliaire (pour le dé-
partement de Seine-el-Oise) de la Commission
de l'inventaire des richesses d'art de la France,
— qui a bien voulu nous communiquer les pho-
tographies d'après lesquelles nous avons repro-
duit, sous ses deux faces, le curieux tronc en
cuivre de l'église Saint-Spire — nous adresse, au
sujet de ce tronc, les renseignements suivants :
« Parmi les objets composant le trésor de la
fabrique de l'église Saint-Spire, dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise, nous avons remarque
un tronc, destiné jadis non seulement à recevoir
Fig. i.
les offrandes des fidèles dans cette église, mais
encore à faire les quêtes, lors de la procession
solennelle des châsses dans l'intérieur de la
ville.
« Ce tronc portatif est en cuivre, d'une sculp-
ture naïve qui ne manque pas d'une certaine
élégance; il affecte la forme d'un tronçon de co-
lonne renflée, à l'instar des anciens troncs qui
se composaient d'un tronçon d'arbre cylindrique
et creusé dans son épaisseur.
« Ce tronçon de colonne a pour base une série
de moulures assez larges, formant empattement
et lui donnant une solide assiette.
« On lit sur le bord des moulures une inscrip-
| tion gravée, ainsi conçue :
«Nicollas Caron, marchantrourgeois de Paris,
j confrère de la confra1rie SaINT-SpIRE et l'un
des porteurs de sa chasse, a donné geste doette
i a icelle confrairie 1388.
« Le couvercle est plat, égalementcylindrique,
décoré à sa base d'une série de moulures; sur
le milieu de ce couvercle il existe une partie en
exhaussement formant entonnoir et, dans l'axe,
une fente pour le passage de la monnaie.
« Une lame de cuivre de 4 centimètres entoure
le passage de la monnaie à l'intérieur; la char-
nière du couvercle, située sur le derrière, est pra-
tiquée sur une coquille formant saillie sur le
dessus.
« Sur ce couvercle sont adaptés, de chaque
côté, deux petits bustes représentant des per-
sonnages barbus, ayant la tôle recouverte d'une
Ftg. 2.
coiffure de l'époque et, sur les épaules, des
collets rabaltus; ces deux bustes servent de
base et de douilles à une poignée mobile avec
arêtes cannelées, et munies, dans leur lon-
gueur, de deux bagues à pans et moulures.
« Sur le dessus du couvercle et par devant, se
détache en repoussé une agrafe fleuronnée,
affectant les formes delà fleur de lis agrémentée ;
cette agrafe motive une charnière à laquelle se
suspend un moraillon en forme de gaine, avec
torsade sur les côtés; sur ce moraillon en saillie
une chimère, dont la tète se retourne, est dis-
posée de manière à saisir facilement le moraillon
et à le faire manœuvrer; à droite et à gauche du
moraillon se trouvent deux trous, destinés à
faire fonctionner deux serrures dont les boîtes
sont placées à l'intérieur du tronc; la base du
moraillon est terminée sur le tronc par un orne-
ment en saillie et gravé.
« La base de la charnière, adaptée au tronc,
est soutenue par des ornements enlevés sur l'é-
paisseur du cuivre et formant saillie ; ils repré-
sentent deux chimères dos à dos et,au-dessous,
un autre ornement en pendentif formant culot.
« Ces mêmes ornements se trouvent également
répétés sur les flancs du troncàdroileetàgauche,
précisément au-dessous des deux petits bustes
décrits plus haut.
« Sur le devant du tronc, pour meubler la place
restée vide entre les ornements décrits et le
moraillon, se trouvent quatre rosaces en forme
d'hélice et des gravures des lettres SP (Saint-
Spire), ainsi que l'anagramme de Nicolas Caron.