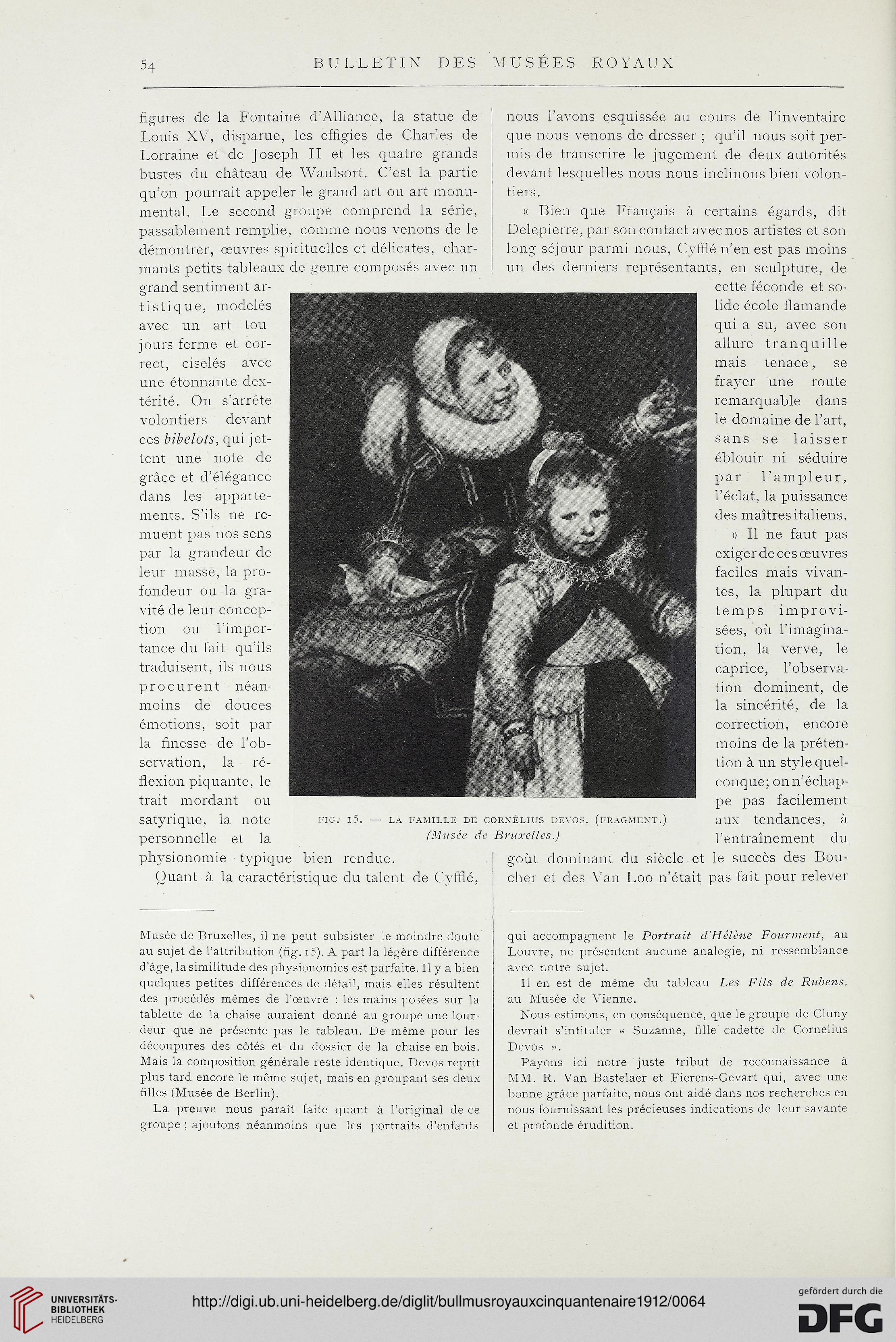54
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
figures de la Fontaine d’Alliance, la statue de
Louis XV, disparue, les effigies de Charles de
Lorraine et de Joseph II et les quatre grands
bustes du château de Waulsort. C’est la partie
qu’on pourrait appeler le grand art ou art monu-
mental. Le second groupe comprend la série,
passablement remplie, comme nous venons de le
démontrer, œuvres spirituelles et délicates, char-
mants petits tableaux de genre composés avec un
grand sentiment ar-
tistique, modelés
avec un art tou
jours ferme et cor-
rect, ciselés avec
une étonnante dex-
térité. On s’arrête
volontiers devant
ces bibelots, qui jet-
tent une note de
grâce et d’élégance
dans les apparte-
ments. S'ils ne re-
muent pas nos sens
par la grandeur de
leur masse, la pro-
fondeur ou la gra-
vité de leur concep-
tion ou l’impor-
tance du fait qu’ils
traduisent, ils nous
procurent néan-
moins de douces
émotions, soit par
la finesse de l’ob-
servation, la ré-
flexion piquante, le
trait mordant ou
satyrique, la note
personnelle et la
physionomie typique bien rendue.
Quant à la caractéristique du talent de Cyfflé,
nous l'avons esquissée au cours de l’inventaire
que nous venons de dresser ; qu’il nous soit per-
mis de transcrire le jugement de deux autorités
devant lesquelles nous nous inclinons bien volon-
tiers.
« Bien que Français à certains égards, dit
Delepierre, par son contact avec nos artistes et son
long séjour parmi nous, Cyfflé n’en est pas moins
un des derniers représentants, en sculpture, de
cette féconde et so-
lide école flamande
qui a su, avec son
allure tranquille
mais tenace, se
frayer une route
remarquable dans
le domaine de l’art,
sans se laisser
éblouir ni séduire
par l’ampleur,
l’éclat, la puissance
des maîtres italiens,
» Il ne faut pas
exiger de ces œuvres
faciles mais vivan-
tes, la plupart du
temps improvi-
sées, où l'imagina-
tion, la verve, le
caprice, l’observa-
tion dominent, de
la sincérité, de la
correction, encore
moins de la préten-
tion à un style quel-
conque; on n’échap-
pe pas facilement
aux tendances, à
l’entraînement du
goût dominant du siècle et le succès des Bou-
cher et des Yan Loo n’était pas fait pour relever
FIG: l5. — LA FAMILLE DE CORNÉLIUS DEYOS. (FRAGMENT.)
(Musée de Bruxelles.)
Musée de Bruxelles, il ne peut subsister le moindre doute
au sujet de l’attribution (fig. 15). A part la légère différence
d’àge, la similitude des physionomies est parfaite. Il y a bien
quelques petites différences de détail, mais elles résultent
des procédés mêmes de l’œuvre : les mains posées sur la
tablette de la chaise auraient donné au groupe une lour-
deur que ne présente pas le tableau. De même pour les
découpures des côtés et du dossier de la chaise en bois.
Mais la composition générale reste identique. Devos reprit
plus tard encore le même sujet, mais en groupant ses deux
filles (Musée de Berlin).
La preuve nous paraît faite quant à l’original de ce
groupe ; ajoutons néanmoins que les portraits d’enfants
qui accompagnent le Portrait d’Hélène Fourment, au
Louvre, ne présentent aucune analogie, ni ressemblance
avec notre sujet.
Il en est de même du tableau Les Fils de Rubens,
au Musée de Vienne.
Nous estimons, en conséquence, que le groupe de Cluny
devrait s’intituler « Suzanne, fille cadette de Cornélius
Devos ».
Payons ici notre juste tribut de reconnaissance à
MM. R. Van Bastelaer et Fierens-Gevart qui, avec une
bonne grâce parfaite, nous ont aidé dans nos recherches en
nous fournissant les précieuses indications de leur savante
et profonde érudition.
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX
figures de la Fontaine d’Alliance, la statue de
Louis XV, disparue, les effigies de Charles de
Lorraine et de Joseph II et les quatre grands
bustes du château de Waulsort. C’est la partie
qu’on pourrait appeler le grand art ou art monu-
mental. Le second groupe comprend la série,
passablement remplie, comme nous venons de le
démontrer, œuvres spirituelles et délicates, char-
mants petits tableaux de genre composés avec un
grand sentiment ar-
tistique, modelés
avec un art tou
jours ferme et cor-
rect, ciselés avec
une étonnante dex-
térité. On s’arrête
volontiers devant
ces bibelots, qui jet-
tent une note de
grâce et d’élégance
dans les apparte-
ments. S'ils ne re-
muent pas nos sens
par la grandeur de
leur masse, la pro-
fondeur ou la gra-
vité de leur concep-
tion ou l’impor-
tance du fait qu’ils
traduisent, ils nous
procurent néan-
moins de douces
émotions, soit par
la finesse de l’ob-
servation, la ré-
flexion piquante, le
trait mordant ou
satyrique, la note
personnelle et la
physionomie typique bien rendue.
Quant à la caractéristique du talent de Cyfflé,
nous l'avons esquissée au cours de l’inventaire
que nous venons de dresser ; qu’il nous soit per-
mis de transcrire le jugement de deux autorités
devant lesquelles nous nous inclinons bien volon-
tiers.
« Bien que Français à certains égards, dit
Delepierre, par son contact avec nos artistes et son
long séjour parmi nous, Cyfflé n’en est pas moins
un des derniers représentants, en sculpture, de
cette féconde et so-
lide école flamande
qui a su, avec son
allure tranquille
mais tenace, se
frayer une route
remarquable dans
le domaine de l’art,
sans se laisser
éblouir ni séduire
par l’ampleur,
l’éclat, la puissance
des maîtres italiens,
» Il ne faut pas
exiger de ces œuvres
faciles mais vivan-
tes, la plupart du
temps improvi-
sées, où l'imagina-
tion, la verve, le
caprice, l’observa-
tion dominent, de
la sincérité, de la
correction, encore
moins de la préten-
tion à un style quel-
conque; on n’échap-
pe pas facilement
aux tendances, à
l’entraînement du
goût dominant du siècle et le succès des Bou-
cher et des Yan Loo n’était pas fait pour relever
FIG: l5. — LA FAMILLE DE CORNÉLIUS DEYOS. (FRAGMENT.)
(Musée de Bruxelles.)
Musée de Bruxelles, il ne peut subsister le moindre doute
au sujet de l’attribution (fig. 15). A part la légère différence
d’àge, la similitude des physionomies est parfaite. Il y a bien
quelques petites différences de détail, mais elles résultent
des procédés mêmes de l’œuvre : les mains posées sur la
tablette de la chaise auraient donné au groupe une lour-
deur que ne présente pas le tableau. De même pour les
découpures des côtés et du dossier de la chaise en bois.
Mais la composition générale reste identique. Devos reprit
plus tard encore le même sujet, mais en groupant ses deux
filles (Musée de Berlin).
La preuve nous paraît faite quant à l’original de ce
groupe ; ajoutons néanmoins que les portraits d’enfants
qui accompagnent le Portrait d’Hélène Fourment, au
Louvre, ne présentent aucune analogie, ni ressemblance
avec notre sujet.
Il en est de même du tableau Les Fils de Rubens,
au Musée de Vienne.
Nous estimons, en conséquence, que le groupe de Cluny
devrait s’intituler « Suzanne, fille cadette de Cornélius
Devos ».
Payons ici notre juste tribut de reconnaissance à
MM. R. Van Bastelaer et Fierens-Gevart qui, avec une
bonne grâce parfaite, nous ont aidé dans nos recherches en
nous fournissant les précieuses indications de leur savante
et profonde érudition.