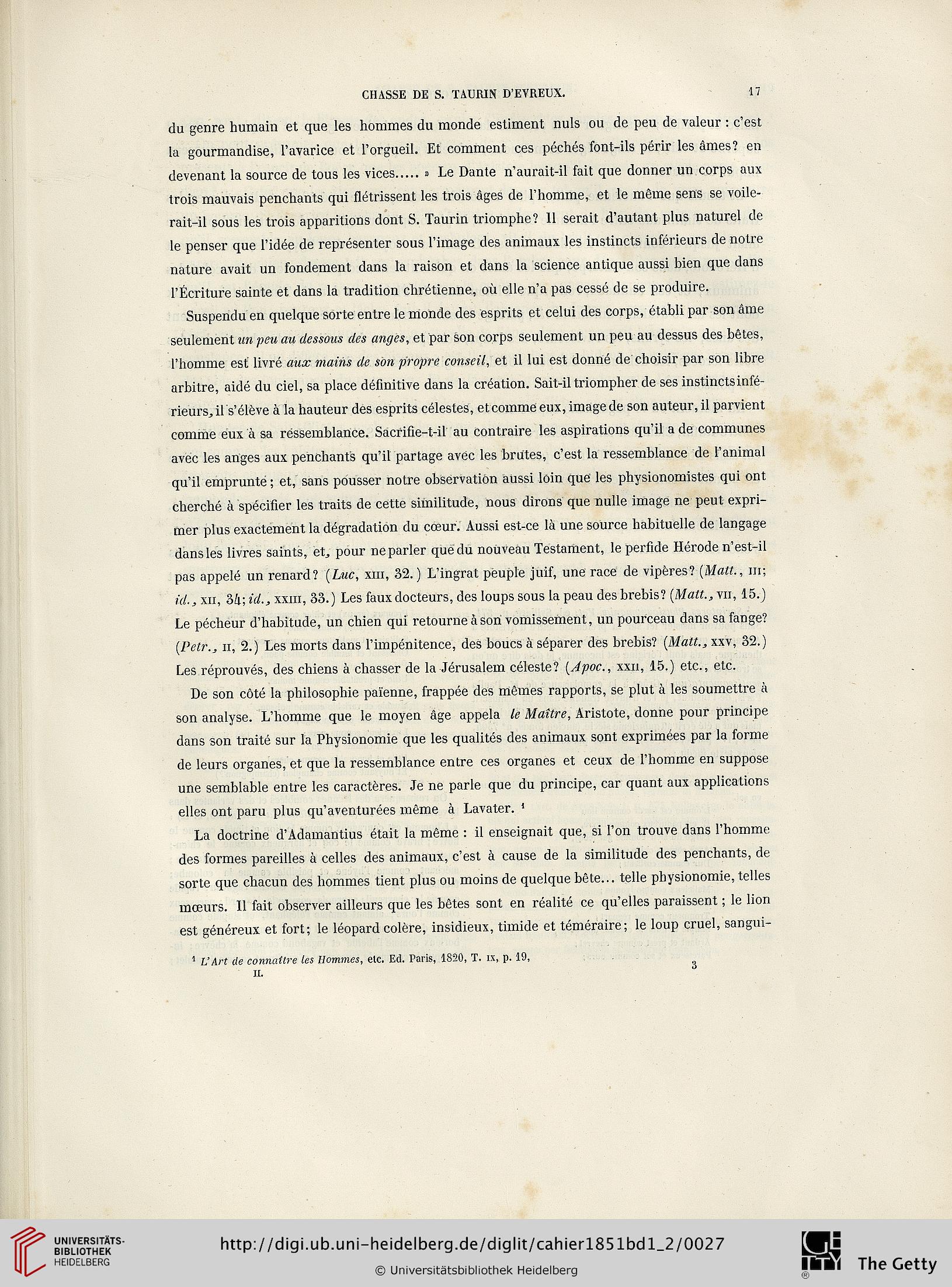CHASSE DE S. TAURIN D'EVREUX.
17
du genre humain et que les hommes du monde estiment nuis ou de peu de valeur : c'est
la gourmandise, l'avarice et l'orgueil. Et comment ces péchés font-ils périr les âmes? en
devenant la source de tous les vices.D Le Dante n'aurait-il fait que donner un corps aux
trois mauvais penchants qui flétrissent les trois âges de l'homme, et le même sens se voile-
rait-il sous les trois apparitions dont S. Taurin triomphe? 11 serait d'autant plus naturel de
le penser que l'idée de représenter sous l'image des animaux les instincts inférieurs de notre
nature avait un fondement dans la raison et dans la science antique aussi bien que dans
l'Écriture sainte et dans la tradition chrétienne, où elle n'a pas cessé de se produire.
Suspendu en quelque sorte entre le monde des esprits et celui des corps, établi par son âme
seulement ^ et par son corps seulement un peu au dessus des bêtes,
l'homme est livré %M.27 3073 et il lui est donné de choisir par son libre
arbitre, aidé du ciel, sa place définitive dans la création. Sait-il triompher de ses instinctsinfé-
rieurs„ il s'élève à la hauteur des esprits célestes, et comme eux, image de son auteur, il parvient
comme eux à sa ressemblance. Sacrifie-t-il au contraire les aspirations qu'il a de communes
avec les anges aux penchants qu'il partage avec les brutes, c'est la ressemblance de l'animal
qu'il emprunte ; et, sans pousser notre observation aussi loin que les physionomistes qui ont
cherché à spécifier les traits de cette similitude, nous dirons que nulle image ne peut expri-
mer plus exactement la dégradation du cœur. Aussi est-ce là une source habituelle de langage
dans les livres saints, et,, pour ne parler que du nouveau Testament, le perfide Hérode n'est-il
pas appelé un renard? xm, 32.) L'ingrat peuple juif, une race de vipères? , 111;
ù/.„ xii, 3à; ùL., xxiii, 33.) Les faux docteurs, des loups sous la peau des brebis? vu, 15.)
Le pécheur d'habitude, un chien qui retourne à son vomissement, un pourceau dans sa fange?
11, 2.) Les morts dans l'impénitence, des boucs à séparer des brebis? xxv, 32.)
Les réprouvés, des chiens à chasser de la Jérusalem céleste? (^oc., xxn, 15.) etc., etc.
De son côté la philosophie païenne, frappée des mêmes rapports, se plut à les soumettre à
son analyse. L'homme que le moyen âge appela /d Aristote, donne pour principe
dans son traité sur la Physionomie que les qualités des animaux sont exprimées par la forme
de leurs organes, et que la ressemblance entre ces organes et ceux de l'homme en suppose
une semblable entre les caractères. Je ne parle que du principe, car quant aux applications
elles ont paru plus qu'aventurées même à Lavater. *
La doctrine d'Adamantius était la même : il enseignait que, si l'on trouve dans l'homme
des formes pareilles à celles des animaux, c'est à cause de la similitude des penchants, de
sorte que chacun des hommes tient plus ou moins de quelque bête... telle physionomie, telles
mœurs. Il fait observer ailleurs que les bêtes sont en réalité ce qu'elles paraissent ; le lion
est généreux et fort; le léopard colère, insidieux, timide et téméraire; le loup cruel, sangui-
1 de co?MM?0'e /e5 Nom??ïe.s, etc. Ed. Paris, 1820, T. ix, p. 19,
17
du genre humain et que les hommes du monde estiment nuis ou de peu de valeur : c'est
la gourmandise, l'avarice et l'orgueil. Et comment ces péchés font-ils périr les âmes? en
devenant la source de tous les vices.D Le Dante n'aurait-il fait que donner un corps aux
trois mauvais penchants qui flétrissent les trois âges de l'homme, et le même sens se voile-
rait-il sous les trois apparitions dont S. Taurin triomphe? 11 serait d'autant plus naturel de
le penser que l'idée de représenter sous l'image des animaux les instincts inférieurs de notre
nature avait un fondement dans la raison et dans la science antique aussi bien que dans
l'Écriture sainte et dans la tradition chrétienne, où elle n'a pas cessé de se produire.
Suspendu en quelque sorte entre le monde des esprits et celui des corps, établi par son âme
seulement ^ et par son corps seulement un peu au dessus des bêtes,
l'homme est livré %M.27 3073 et il lui est donné de choisir par son libre
arbitre, aidé du ciel, sa place définitive dans la création. Sait-il triompher de ses instinctsinfé-
rieurs„ il s'élève à la hauteur des esprits célestes, et comme eux, image de son auteur, il parvient
comme eux à sa ressemblance. Sacrifie-t-il au contraire les aspirations qu'il a de communes
avec les anges aux penchants qu'il partage avec les brutes, c'est la ressemblance de l'animal
qu'il emprunte ; et, sans pousser notre observation aussi loin que les physionomistes qui ont
cherché à spécifier les traits de cette similitude, nous dirons que nulle image ne peut expri-
mer plus exactement la dégradation du cœur. Aussi est-ce là une source habituelle de langage
dans les livres saints, et,, pour ne parler que du nouveau Testament, le perfide Hérode n'est-il
pas appelé un renard? xm, 32.) L'ingrat peuple juif, une race de vipères? , 111;
ù/.„ xii, 3à; ùL., xxiii, 33.) Les faux docteurs, des loups sous la peau des brebis? vu, 15.)
Le pécheur d'habitude, un chien qui retourne à son vomissement, un pourceau dans sa fange?
11, 2.) Les morts dans l'impénitence, des boucs à séparer des brebis? xxv, 32.)
Les réprouvés, des chiens à chasser de la Jérusalem céleste? (^oc., xxn, 15.) etc., etc.
De son côté la philosophie païenne, frappée des mêmes rapports, se plut à les soumettre à
son analyse. L'homme que le moyen âge appela /d Aristote, donne pour principe
dans son traité sur la Physionomie que les qualités des animaux sont exprimées par la forme
de leurs organes, et que la ressemblance entre ces organes et ceux de l'homme en suppose
une semblable entre les caractères. Je ne parle que du principe, car quant aux applications
elles ont paru plus qu'aventurées même à Lavater. *
La doctrine d'Adamantius était la même : il enseignait que, si l'on trouve dans l'homme
des formes pareilles à celles des animaux, c'est à cause de la similitude des penchants, de
sorte que chacun des hommes tient plus ou moins de quelque bête... telle physionomie, telles
mœurs. Il fait observer ailleurs que les bêtes sont en réalité ce qu'elles paraissent ; le lion
est généreux et fort; le léopard colère, insidieux, timide et téméraire; le loup cruel, sangui-
1 de co?MM?0'e /e5 Nom??ïe.s, etc. Ed. Paris, 1820, T. ix, p. 19,