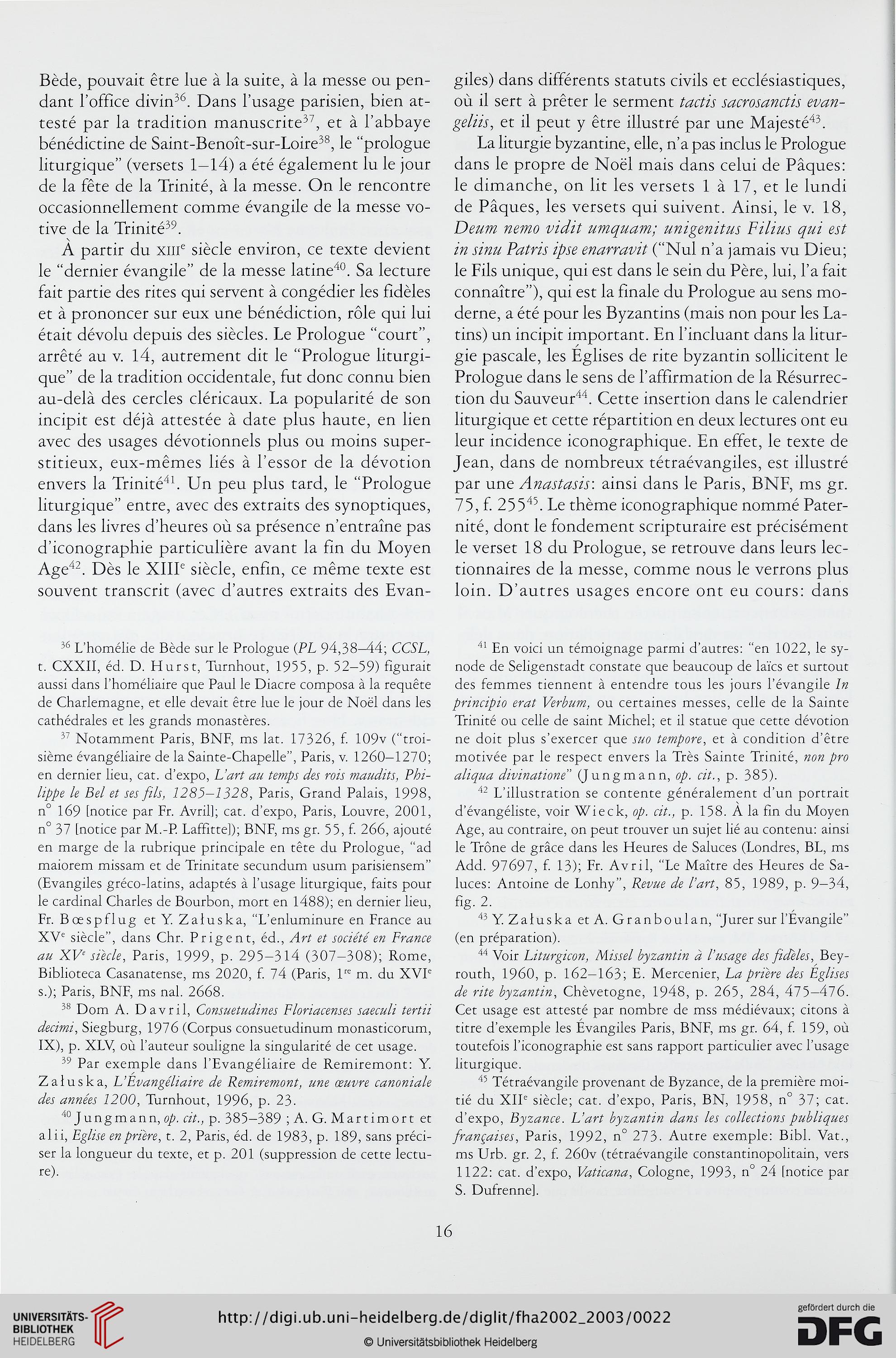Bede, pouvait etre lue a la suitę, a la messe ou pen-
dant 1’offlce divin36. Dans 1’usage parisien, bien at-
teste par la tradition manuscrite37, et a 1’abbaye
benedictine de Saint-Benoit-sur-Loire38, le “prologue
liturgiąue” (yersets 1—14) a ete egalement lu le jour
de la fete de la Trinite, a la messe. On le rencontre
occasionnellement comme evangile de la messe vo-
tive de la Trinite39.
A partir du xme siecle environ, ce texte devient
le “dernier evangile” de la messe latine40. Sa lecture
fait partie des rites qui servent a congedier les fideles
et a prononcer sur eux une benediction, role qui lui
etait devolu depuis des siecles. Le Prologue “court”,
arrete au v. 14, autrement dit le “Prologue liturgi-
que” de la tradition occidentale, lut donc connu bien
au-dela des cercles clericaux. La popularite de son
incipit est deja attestee a datę plus haute, en lien
avec des usages devotionnels plus ou moins super-
stitieux, eux-memes lies a 1’essor de la devotion
envers la Trinite41. Un peu plus tard, le “Prologue
liturgique” entre, avec des extraits des synoptiques,
dans les livres d’heures ou sa presence n’entraine pas
d’iconographie particuliere avant la fin du Moyen
Age42. Des le XIIIe siecle, enfin, ce menie texte est
souvent transcrit (avec d’autres extraits des Evan-
36 Lhomelie de Bede sur le Prologue (PL 94,38-44; CCSL,
t. CXXII, ed. D. Hurst, Turnhout, 1955, p. 52—59) figurait
aussi dans 1’homeliaire que Paul le Diacre composa a la requete
de Charlemagne, et elle devait etre lue le jour de Noel dans les
cathedrales et les grands monasteres.
37 Notamment Paris, BNF, ms lat. 17326, 1. 109v (“rroi-
sieme evangeliaire de la Sainte-Chapelle”, Paris, v. 1260—1270;
en dernier lieu, cat. d’expo, L'art au temps des rois maudits, Phi-
lippe le Bel et ses flis, 1285—1328, Paris, Grand Palais, 1998,
nu 169 [notice par Fr. Avril]; cat. d’expo, Paris, Louvre, 2001,
n° 37 [notice par M.-P. Laffittel); BNF, ms gr. 55, f. 266, ajoute
en marge de la rubrique principale en tete du Prologue, “ad
maiorem missam et de Trinitate secundum usum parisiensem”
(Evangiles greco-latins, adaptes a 1'usage liturgique, faits pour
le Cardinal Charles de Bourbon, mort en 1488); en dernier lieu,
Fr. Boespflug et Y. Załuska, “Lenluminure en France au
XVe siecle”, dans Chr. Prigent, ed., Art et societe en France
au XVe siecle, Paris, 1999, p- 295—314 (307—308); Romę,
Biblioteca Casanatense, ms 2020, f. 74 (Paris, lre m. du XVIe
s.); Paris, BNF, ms nal. 2668.
38 Dom A. Davril, Consuetudines Floriacenses saeculi tertii
decimi, Siegburg, 1976 (Corpus consuetudinum monasticorum,
IX), p. XLV, ou 1’auteur souligne la singularite de cet usage.
39 Par exemple dans l’Evangeliaire de Remiremont: Y.
Załuska, L'Evangeliaire de Remiremont, une ceuvre canoniale
des annees 1200, Turnhout, 1996, p. 23.
40 Jungmann, op. cit., p. 385-389 ; A. G. Mart im ort et
alii, Eglise enpriere, t. 2, Paris, ed. de 1983, p. 189, sans preci-
ser la longueur du texte, et p. 201 (suppression de cette lectu-
re).
giles) dans differents statuts civils et ecclesiastiques,
ou il sert a preter le serment tactis sacrosanctis evan-
geliis, et il peut y etre illustre par une Majeste43.
La liturgie byzantine, elle, na pas inclus le Prologue
dans le propre de Noel mais dans celui de Paques:
le dimanche, on lit les yersets 1 a 17, et le lundi
de Paques, les yersets qui suivent. Ainsi, le v. 18,
Deum nemo vidit umąuam; unigenitus Filius ąui est
in sinn Patris ipse enarravit (“Nul n’a jamais vu Dieu;
le Fils unique, qui est dans le sein du Pere, lui, La fait
connaitre”), qui est la finale du Prologue au sens mo-
dernę, a ete pour les Byzantins (mais non pour les La-
tins) un incipit important. En Lincluant dans la litur-
gie pascale, les Eglises de rite byzantin sollicitent le
Prologue dans le sens de 1’affirmation de la Resurrec-
tion du Sauveur44. Cette insertion dans le calendrier
liturgique et cette repartition en deux lectures ont eu
leur incidence iconographique. En effet, le texte de
Jean, dans de nombreux tetraeyangiles, est illustre
par une Anastasis: ainsi dans le Paris, BNF, ms gr.
75, f. 25545. Le theme iconographique nomme Pater-
nite, dont le fondement scripturaire est precisement
le verset 18 du Prologue, se retrouve dans leurs lec-
tionnaires de la messe, comme nous le yerrons plus
loin. D’autres usages encore ont eu cours: dans
41 En voici un temoignage parmi d’autres: “en 1022, le sy-
node de Seligenstadt constate que beaucoup de laics et surtout
des femmes tiennent a entendre tous les jours l’evangile In
principio erat Verbum, ou certaines messes, celle de la Sainte
Trinite ou celle de saint Michel; et il statuę que cette devotion
ne doit plus s’exercer que suo tempore, et a condition d’etre
motivee par le respect envers la Tres Sainte Trinite, non pro
aliąua divinatione” (Jungmann, op. cit., p. 385).
42 Lhllustration se contente generalement d’un portrait
d’evangeliste, voir Wieck, op. cit., p. 158. A la fin du Moyen
Age, au contraire, on peut trouver un sujet lie au contenu: ainsi
le Tróne de grace dans les Heures de Saluces (Londres, BL, ms
Add. 97697, f. 13); Fr. Avril, “Le Maitre des Heures de Sa-
luces: Antoine de Lonhy”, Revue de Part, 85, 1989, p. 9—34,
fig. 2.
43 Y. Załuska et A. Granboulan, “Jurer sur l’Evangile”
(en preparation).
44 Voir Liturgicon, Missel byzantin a Pusage des fideles, Bey-
routh, 1960, p. 162—163; E. Mercenier, La priere des Eglises
de rite byzantin, Chevetogne, 1948, p. 265, 284, 475—476.
Cet usage est atteste par nombre de mss medievaux; citons a
titre d’exemple les Evangiles Paris, BNF, ms gr. 64, f. 159, ou
toutefois Ficonographie est sans rapport particulier avec 1’usage
liturgique.
45 Tetraevangile provenant de Byzance, de la premiere moi-
tie du XIT siecle; cat. d’expo, Paris, BN, 1958, n° 37; cat.
d’expo, Byzance. L'art byzantin dans les collections publiąues
franęaises, Paris, 1992, n° 273. Autre exemple: Bibl. Vat.,
ms Urb. gr. 2, f. 260v (tetraevangile constantinopohtain, vers
1122: cat. d’expo, Vaticana, Cologne, 1993, n° 24 [notice par
S. Dufrenne],
16
dant 1’offlce divin36. Dans 1’usage parisien, bien at-
teste par la tradition manuscrite37, et a 1’abbaye
benedictine de Saint-Benoit-sur-Loire38, le “prologue
liturgiąue” (yersets 1—14) a ete egalement lu le jour
de la fete de la Trinite, a la messe. On le rencontre
occasionnellement comme evangile de la messe vo-
tive de la Trinite39.
A partir du xme siecle environ, ce texte devient
le “dernier evangile” de la messe latine40. Sa lecture
fait partie des rites qui servent a congedier les fideles
et a prononcer sur eux une benediction, role qui lui
etait devolu depuis des siecles. Le Prologue “court”,
arrete au v. 14, autrement dit le “Prologue liturgi-
que” de la tradition occidentale, lut donc connu bien
au-dela des cercles clericaux. La popularite de son
incipit est deja attestee a datę plus haute, en lien
avec des usages devotionnels plus ou moins super-
stitieux, eux-memes lies a 1’essor de la devotion
envers la Trinite41. Un peu plus tard, le “Prologue
liturgique” entre, avec des extraits des synoptiques,
dans les livres d’heures ou sa presence n’entraine pas
d’iconographie particuliere avant la fin du Moyen
Age42. Des le XIIIe siecle, enfin, ce menie texte est
souvent transcrit (avec d’autres extraits des Evan-
36 Lhomelie de Bede sur le Prologue (PL 94,38-44; CCSL,
t. CXXII, ed. D. Hurst, Turnhout, 1955, p. 52—59) figurait
aussi dans 1’homeliaire que Paul le Diacre composa a la requete
de Charlemagne, et elle devait etre lue le jour de Noel dans les
cathedrales et les grands monasteres.
37 Notamment Paris, BNF, ms lat. 17326, 1. 109v (“rroi-
sieme evangeliaire de la Sainte-Chapelle”, Paris, v. 1260—1270;
en dernier lieu, cat. d’expo, L'art au temps des rois maudits, Phi-
lippe le Bel et ses flis, 1285—1328, Paris, Grand Palais, 1998,
nu 169 [notice par Fr. Avril]; cat. d’expo, Paris, Louvre, 2001,
n° 37 [notice par M.-P. Laffittel); BNF, ms gr. 55, f. 266, ajoute
en marge de la rubrique principale en tete du Prologue, “ad
maiorem missam et de Trinitate secundum usum parisiensem”
(Evangiles greco-latins, adaptes a 1'usage liturgique, faits pour
le Cardinal Charles de Bourbon, mort en 1488); en dernier lieu,
Fr. Boespflug et Y. Załuska, “Lenluminure en France au
XVe siecle”, dans Chr. Prigent, ed., Art et societe en France
au XVe siecle, Paris, 1999, p- 295—314 (307—308); Romę,
Biblioteca Casanatense, ms 2020, f. 74 (Paris, lre m. du XVIe
s.); Paris, BNF, ms nal. 2668.
38 Dom A. Davril, Consuetudines Floriacenses saeculi tertii
decimi, Siegburg, 1976 (Corpus consuetudinum monasticorum,
IX), p. XLV, ou 1’auteur souligne la singularite de cet usage.
39 Par exemple dans l’Evangeliaire de Remiremont: Y.
Załuska, L'Evangeliaire de Remiremont, une ceuvre canoniale
des annees 1200, Turnhout, 1996, p. 23.
40 Jungmann, op. cit., p. 385-389 ; A. G. Mart im ort et
alii, Eglise enpriere, t. 2, Paris, ed. de 1983, p. 189, sans preci-
ser la longueur du texte, et p. 201 (suppression de cette lectu-
re).
giles) dans differents statuts civils et ecclesiastiques,
ou il sert a preter le serment tactis sacrosanctis evan-
geliis, et il peut y etre illustre par une Majeste43.
La liturgie byzantine, elle, na pas inclus le Prologue
dans le propre de Noel mais dans celui de Paques:
le dimanche, on lit les yersets 1 a 17, et le lundi
de Paques, les yersets qui suivent. Ainsi, le v. 18,
Deum nemo vidit umąuam; unigenitus Filius ąui est
in sinn Patris ipse enarravit (“Nul n’a jamais vu Dieu;
le Fils unique, qui est dans le sein du Pere, lui, La fait
connaitre”), qui est la finale du Prologue au sens mo-
dernę, a ete pour les Byzantins (mais non pour les La-
tins) un incipit important. En Lincluant dans la litur-
gie pascale, les Eglises de rite byzantin sollicitent le
Prologue dans le sens de 1’affirmation de la Resurrec-
tion du Sauveur44. Cette insertion dans le calendrier
liturgique et cette repartition en deux lectures ont eu
leur incidence iconographique. En effet, le texte de
Jean, dans de nombreux tetraeyangiles, est illustre
par une Anastasis: ainsi dans le Paris, BNF, ms gr.
75, f. 25545. Le theme iconographique nomme Pater-
nite, dont le fondement scripturaire est precisement
le verset 18 du Prologue, se retrouve dans leurs lec-
tionnaires de la messe, comme nous le yerrons plus
loin. D’autres usages encore ont eu cours: dans
41 En voici un temoignage parmi d’autres: “en 1022, le sy-
node de Seligenstadt constate que beaucoup de laics et surtout
des femmes tiennent a entendre tous les jours l’evangile In
principio erat Verbum, ou certaines messes, celle de la Sainte
Trinite ou celle de saint Michel; et il statuę que cette devotion
ne doit plus s’exercer que suo tempore, et a condition d’etre
motivee par le respect envers la Tres Sainte Trinite, non pro
aliąua divinatione” (Jungmann, op. cit., p. 385).
42 Lhllustration se contente generalement d’un portrait
d’evangeliste, voir Wieck, op. cit., p. 158. A la fin du Moyen
Age, au contraire, on peut trouver un sujet lie au contenu: ainsi
le Tróne de grace dans les Heures de Saluces (Londres, BL, ms
Add. 97697, f. 13); Fr. Avril, “Le Maitre des Heures de Sa-
luces: Antoine de Lonhy”, Revue de Part, 85, 1989, p. 9—34,
fig. 2.
43 Y. Załuska et A. Granboulan, “Jurer sur l’Evangile”
(en preparation).
44 Voir Liturgicon, Missel byzantin a Pusage des fideles, Bey-
routh, 1960, p. 162—163; E. Mercenier, La priere des Eglises
de rite byzantin, Chevetogne, 1948, p. 265, 284, 475—476.
Cet usage est atteste par nombre de mss medievaux; citons a
titre d’exemple les Evangiles Paris, BNF, ms gr. 64, f. 159, ou
toutefois Ficonographie est sans rapport particulier avec 1’usage
liturgique.
45 Tetraevangile provenant de Byzance, de la premiere moi-
tie du XIT siecle; cat. d’expo, Paris, BN, 1958, n° 37; cat.
d’expo, Byzance. L'art byzantin dans les collections publiąues
franęaises, Paris, 1992, n° 273. Autre exemple: Bibl. Vat.,
ms Urb. gr. 2, f. 260v (tetraevangile constantinopohtain, vers
1122: cat. d’expo, Vaticana, Cologne, 1993, n° 24 [notice par
S. Dufrenne],
16