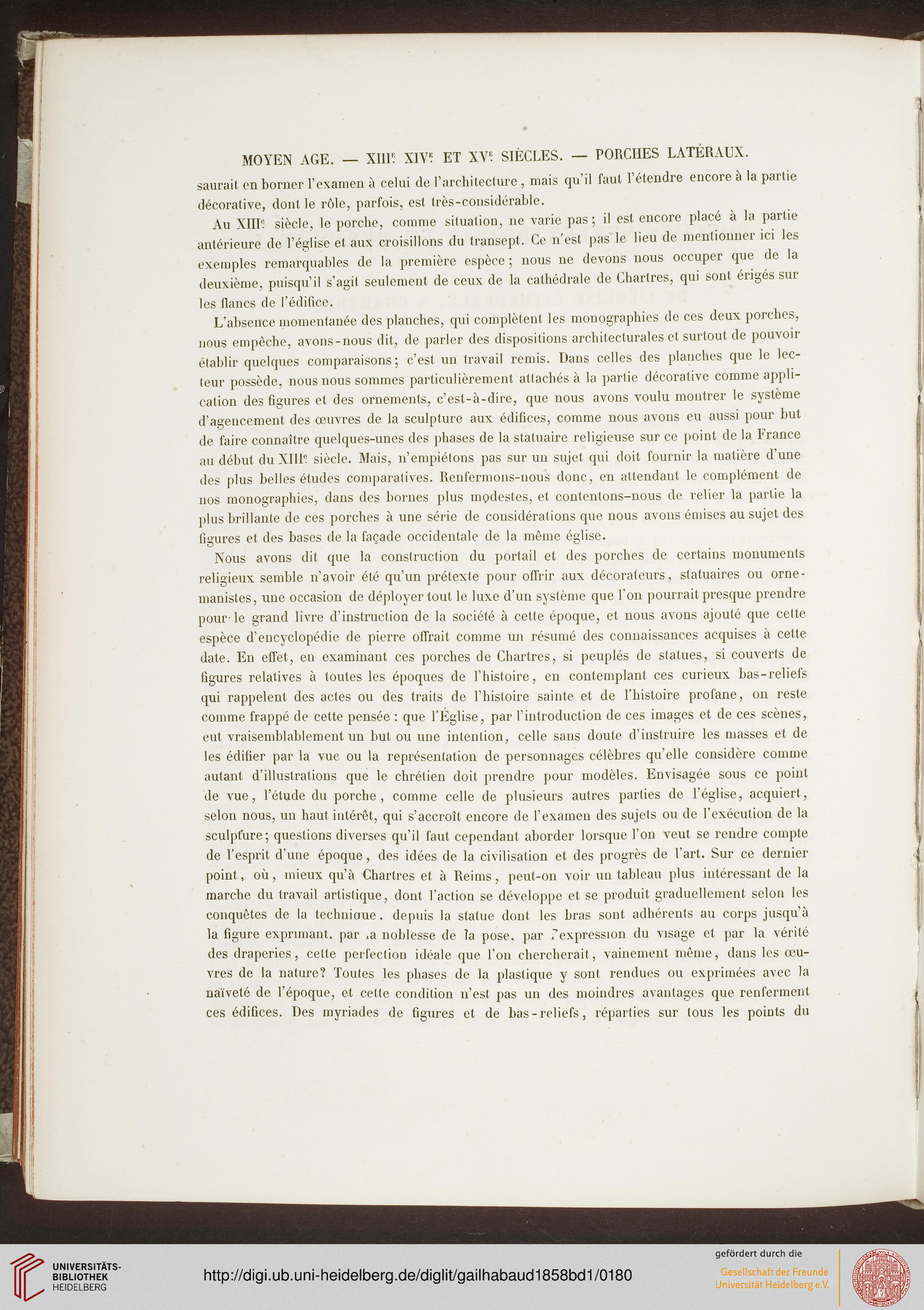MOYEN AGE. — XI1L XIV? ET XVe. SIÈCLES. — PORCHES LATÉRAUX.
saurait en borner l'examen à celui de l'architecture , mais qu'il faut l'étendre encore à la partie
décorative, dont le rôle, parfois, est très-considérable.
Au XIIL siècle, le porche, comme situation, ne varie pas; il est encore placé à la partie
antérieure de l'église et aux croisillons du transept. Ce n'est pas le lieu de mentionner ici les
exemples remarquables de la première espèce ; nous ne devons nous occuper que de la
deuxième, puisqu'il s'agit seulement de ceux de la cathédrale de Chartres, qui sont érigés sur
les flancs de l'édifice.
L'absence momentanée des planches, qui complètent les monographies de ces deux porches,
nous empêche, avons-nous dit, de parler des dispositions architecturales et surtout de pouvoir
établir quelques comparaisons; c'est un travail remis. Dans celles des planches que le lec-
teur possède, nous nous sommes particulièrement attachés à la partie décorative comme appli-
cation des figures et des ornements, c'est-à-dire, que nous avons voulu montrer le système
d'agencement des oeuvres de la sculpture aux édifices, comme nous avons eu aussi pour but
de faire connaître quelques-unes des phases de la statuaire religieuse sur ce point de la France
au début du XIII? siècle. Mais, n'empiétons pas sur un sujet qui doit fournir la matière d'une
des plus belles études comparatives. Renfermons-nous donc, en attendant le complément de
nos monographies, dans des bornes plus modestes, et contentons-nous de relier la partie la
plus brillante de ces porches à une série de considérations que nous avons émises au sujet des
figures et des bases de la façade occidentale de la même église.
Nous avons dit que la construction du portail et des porches de certains monuments
religieux semble n'avoir été qu'un prétexte pour offrir aux décorateurs, statuaires ou orne-
manistes, une occasion de déployer tout le luxe d'un système que l'on pourrait presque prendre
pour-le grand livre d'instruction de la société à cette époque, et nous avons ajouté que cette
espèce d'encyclopédie de pierre offrait comme un résumé des connaissances acquises à cette
date. En effet, en examinant ces porches de Chartres, si peuplés de statues, si couverts de
figures relatives à toutes les époques de l'histoire, en contemplant ces curieux bas-reliefs
qui rappelent des actes ou des traits de l'histoire sainte et de l'histoire profane, on reste
comme frappé de cette pensée : que l'Église, par l'introduction de ces images et de ces scènes,
eut vraisemblablement un but ou une intention, celle sans doute d'instruire les masses et de
les édifier par la vue ou la représentation de personnages célèbres qu'elle considère comme
autant d'illustrations que le chrétien doit prendre pour modèles. Envisagée sous ce point
de vue, l'étude du porche, comme celle de plusieurs autres parties de l'église, acquiert,
selon nous, un haut intérêt, qui s'accroît encore de l'examen des sujets ou de l'exécution de la
sculpture; questions diverses qu'il faut cependant aborder lorsque l'on veut se rendre compte
de l'esprit d'une époque, des idées de la civilisation et des progrès de l'art. Sur ce dernier
point, où, mieux qu'à Chartres et à Reims, peut-on voir un tableau plus intéressant de la
marche du travail artistique, dont l'action se développe et se produit graduellement selon les
conquêtes de la technioue. depuis la statue dont les bras sont adhérents au corps jusqu'à
la figure exprimant, par ,a noblesse de îa pose, par ,**expression du visage et par la vérité
des draperies, cette perfection idéale que l'on chercherait, vainement même, dans les œu-
vres de la nature? Toutes les phases de la plastique y sont rendues ou exprimées avec la
naïveté de l'époque, et cette condition n'est pas un des moindres avantages que renferment
ces édifices. Des myriades de figures et de bas-reliefs, réparties sur tous les points du
saurait en borner l'examen à celui de l'architecture , mais qu'il faut l'étendre encore à la partie
décorative, dont le rôle, parfois, est très-considérable.
Au XIIL siècle, le porche, comme situation, ne varie pas; il est encore placé à la partie
antérieure de l'église et aux croisillons du transept. Ce n'est pas le lieu de mentionner ici les
exemples remarquables de la première espèce ; nous ne devons nous occuper que de la
deuxième, puisqu'il s'agit seulement de ceux de la cathédrale de Chartres, qui sont érigés sur
les flancs de l'édifice.
L'absence momentanée des planches, qui complètent les monographies de ces deux porches,
nous empêche, avons-nous dit, de parler des dispositions architecturales et surtout de pouvoir
établir quelques comparaisons; c'est un travail remis. Dans celles des planches que le lec-
teur possède, nous nous sommes particulièrement attachés à la partie décorative comme appli-
cation des figures et des ornements, c'est-à-dire, que nous avons voulu montrer le système
d'agencement des oeuvres de la sculpture aux édifices, comme nous avons eu aussi pour but
de faire connaître quelques-unes des phases de la statuaire religieuse sur ce point de la France
au début du XIII? siècle. Mais, n'empiétons pas sur un sujet qui doit fournir la matière d'une
des plus belles études comparatives. Renfermons-nous donc, en attendant le complément de
nos monographies, dans des bornes plus modestes, et contentons-nous de relier la partie la
plus brillante de ces porches à une série de considérations que nous avons émises au sujet des
figures et des bases de la façade occidentale de la même église.
Nous avons dit que la construction du portail et des porches de certains monuments
religieux semble n'avoir été qu'un prétexte pour offrir aux décorateurs, statuaires ou orne-
manistes, une occasion de déployer tout le luxe d'un système que l'on pourrait presque prendre
pour-le grand livre d'instruction de la société à cette époque, et nous avons ajouté que cette
espèce d'encyclopédie de pierre offrait comme un résumé des connaissances acquises à cette
date. En effet, en examinant ces porches de Chartres, si peuplés de statues, si couverts de
figures relatives à toutes les époques de l'histoire, en contemplant ces curieux bas-reliefs
qui rappelent des actes ou des traits de l'histoire sainte et de l'histoire profane, on reste
comme frappé de cette pensée : que l'Église, par l'introduction de ces images et de ces scènes,
eut vraisemblablement un but ou une intention, celle sans doute d'instruire les masses et de
les édifier par la vue ou la représentation de personnages célèbres qu'elle considère comme
autant d'illustrations que le chrétien doit prendre pour modèles. Envisagée sous ce point
de vue, l'étude du porche, comme celle de plusieurs autres parties de l'église, acquiert,
selon nous, un haut intérêt, qui s'accroît encore de l'examen des sujets ou de l'exécution de la
sculpture; questions diverses qu'il faut cependant aborder lorsque l'on veut se rendre compte
de l'esprit d'une époque, des idées de la civilisation et des progrès de l'art. Sur ce dernier
point, où, mieux qu'à Chartres et à Reims, peut-on voir un tableau plus intéressant de la
marche du travail artistique, dont l'action se développe et se produit graduellement selon les
conquêtes de la technioue. depuis la statue dont les bras sont adhérents au corps jusqu'à
la figure exprimant, par ,a noblesse de îa pose, par ,**expression du visage et par la vérité
des draperies, cette perfection idéale que l'on chercherait, vainement même, dans les œu-
vres de la nature? Toutes les phases de la plastique y sont rendues ou exprimées avec la
naïveté de l'époque, et cette condition n'est pas un des moindres avantages que renferment
ces édifices. Des myriades de figures et de bas-reliefs, réparties sur tous les points du